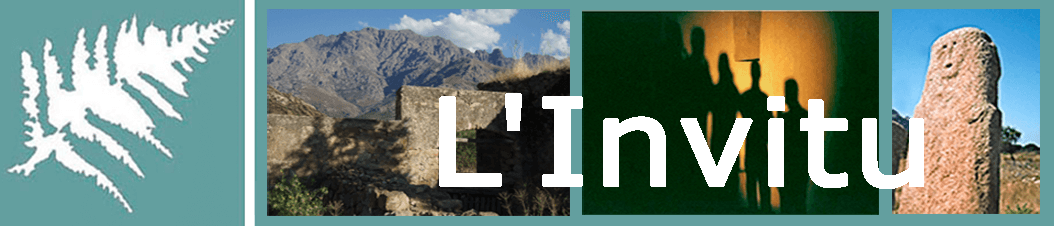Paesi è pievi
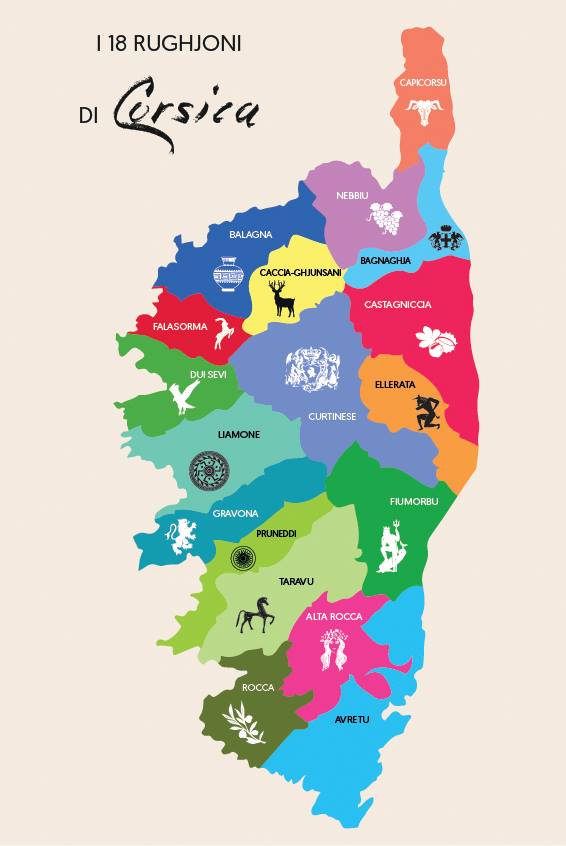
Altagène (Altaghjè)
Arbellara (Arbiddali)
Aregno (Aregnu)
Auddè (Aullène)
Barrettali
Bastelica
Bastia
Bavedda (Bavella)
Belgodère (Belgudè)
Bonifacio (Bunifaziu)
Calenzana (Calinzana)
Calvi
Canari
Carbini
Cargiaca (Carghjaca)
Cassano (Cassani)
Castello di Rostino (Castellu di Rustinu)
Castirla
Cateri (I Catteri)
Centuri
Corbara (Curbara)
Corte (Corti)
Costa
Erbalonga (Erbalunga)
Ersa
Feliceto (Fulicetu)
Fozzano (Fuzzà)
Grossa
Lama
Loreto di Tallano (Laretu di Taddà)
Levie (Livia)
Lumio (Lumiu)
Lunghignano (Lugignanu)
Luri
Macinaggio (Macinaghju)
Manso (Mansu)
Mela
Montegrosso (Montegrossu)
Montemaggiore (Montemaiò)
Morsiglia
Muna
Murato (Muratu)
Muro (Muru)
Nessa (Nesce)
Nonza
Occi (Oggi)
Occhiatana
Ogliastro (Ogliastru)
Olmeto (Ulmetu)
Palasca
Palneca (Palleca)
Pietralba (Petralba)
Pigna
Pino (Pinu)
Propriano (Prupià)
Quenza
Rapale
Rogliano
San Gavinu di Carbini
Sant'Antonino (Sant'Antuninu)
Sartène (Sartè)
Serra di Scopamène (A Sarra di Scupamena)
Sisco (Siscu)
Sollacaro (Suddacarò)
Speloncato (Spiloncatu)
Ste Lucie de Tallano (Santa Lucia di Taddà)
Sta Maria Figaniella
Santa Reparata
Sorbollano (Surbuddà)
Olmiccia (Ulmiccia)
Urtaca
Valle di Rostino (Valle di Rustinu)
Ville di Paraso
Zerubia
Zilia (Ziglia)
Zonza
Zoza

Rocca
La Rocca, fréquemment appelée "U Sartinesu", désigne la basse vallée du Rizzanese et de ses affluents (Chiuvone et Fiumicicoli) ainsi que les vallées du Baraci et de l'Ortolo.
La Rocca comprend les communes de :
- Arbellara
- Belvédère-Campomoro
- Bilia
- Foce
- Fozzano
- Giuncheto
- Granace
- Grossa
- Olmeto
- Propriano, y compris Tivolaggio
- Santa-Maria-Figaniella
- Sartène, y compris Mola, Serraggia et Tizzano
- Viggianello
ainsi qu'une partie de la commune de Sainte-Lucie-de-Tallano (comprenant Orio et Chialza).
Pieve de Sartène
Sartè (Sartène)

La branche maternelle de notre famille étant originaire de Sartène, je me devais de commencer cette rubrique par "la plus corse des villes corses", selon Mérimée.
La commune de Sartène, sous-préfecture, chef-lieu d'arrondissement et "Ville d'art et d'histoire" est la plus grande commune de Corse et l'une des plus vastes de France, puisqu'elle s'étend sur 20 000 hectares, entre Rizzanese et Ortolo.
Belvederi Campumoru (Belvédère Campomoro)
Perché sur un plateau, à proximité d'une côte sauvg eet déchiquetée, Belvedère est dominé par le château Durazzo.
Le petit prot de Campomoro possède une tour génoise située à la pointe de Campomoro.
Son enceinte est fortifiée.
Non loin de là, on peut visiter le site du Dolmen de Tola, ainsi que le menhir de Capo di Lugo et trois coffres mégalithiques.
Bilia
Village à flanc de côteau, au relief couvert de chênes--=lièges et de maquis, Bilia possède quelques vieilles maisons de granit au bel appareil.
Foci (Foce)
Foce abrite les ruines du castellu della Rocca XIIIème siècle), près de la pointe de la Chiaza.
Ghjunchetu (Giuncheto)
Giuncheto est un village preché au sommet d'une colline boisée.
Au lieu-dit San Paolo on peut voir les vestiges de l'abbaye romane San Paolo. Plus loin, dolmen de Cardiccia.
Granacia (Granace)
Granace seniche dans une vallée verdoyante.
Grossa
Grossa s'étale le long d'une colline au-dessus de la vallée de Cristolacce. Autrefois centre de la pieve de Bisogeni, Grossa a été ruiné par les raids barbaresques.
A Grossa, hospitalité rime avec convivialité au quotidien
Publié le mercredi 22 août 2012
Chaque été, Grossa s'offre un bain de jouvence avec le retour des enfants du village. Mais, l'esprit festif, les Grossétains le cultivent toute l'année.
Dernière étape dans le Sartenais-Valinco-Alta Rocca de cette tournée estivale 2012. Et quelle étape ! À Grossa, la convivialité n'est pas un vain mot. La commune avait mis les petits plats dans les grands pour recevoir l'équipe deCorse-Matin.
Un accueil à l'image des habitants : chaleureux. Et pantagruélique avec un magnifique et savoureux buffet offert par la municipalité sur la place de l'église pour accompagner l'apéro de notre partenaire, Pastis 51. On l'affirme, la barre a été mise très haut pour les suivants…
Le maire, Patrick Fouquet, était un peu stressé. Résultat d'une belle unité dans le village, tous les Grossitains étaient mobilisés, fier de montrer ses richesses, sa belle solidarité et son sens de l'accueil. À Grossa, on n'est peut-être pas très nombreux l'hiver (une cinquantaine de résidents) permanents, mais le dynamisme est au rendez-vous. Pour preuve pas moins de quatre associations sur cette petite commune de 18 km2, enclavée entre Sartène, Propriano, Foce-Bilia et Campomoro.
C'est qu'ici toutes les occasions sont bonnes pour se retrouver et faire la fête… Comité des fêtes justement et Grossa in Festa ne manquent pas de rythmer l'été... comme l'hiver. Il n'est pas rare hors saison de trouver des tablées d'une vingtaine de convives. Lundi encore, 110 gourmands, toutes générations confondues, dégustaient ensemble le veau aux olives ! Grossa reprend petit à petit vie ; celle qui l'avait un peu quittée. Et ils sont déjà quelques-uns à avoir fait le choix de se réinstaller au village. Comme ce couple aux carrières bien remplies à Paris. Monsieur est devenu cantonnier ; madame travaille à l'école maternelle de Sartène. Des installations que la mairie espère faciliter avec l'aménagement de quatre logements sociaux dans l'ancien presbytère. La carte communale, nouvelle mouture, a également eu pour conséquence le dépôt de cinq permis de construire.
Et le programme de rénovation routière du CG2A devrait permettre de sécuriser le réseau autour de la commune pour des facilités de travail dans la microrégion. Et la commune affirme son attachement à la petite agence postale… « Il manque quelques commerces aujourd'hui…» Mais déjà, les périodes « vides » rétrécissent, avec un village rempli de mai à fin octobre et à chaque vacances… Quelques blancs à combler donc. Avec son sens de l'hospitalité, Grossa ne peut qu'attirer. Y compris les agriculteurs qui attendent avec impatience l'irrigation de la vallée de Conca.
Pieve de Viggiano
Fuzzà (Fozzano)
Fozzano est un village au cachet particulier, avec une architecture homogène, où les vestiges du Moyen-Âge sont nombreux. Les imposants murs de granit des deux maisons fortifiées furent les témoins de la célèbre vendetta qui opposa le clan des Durazzo (du quartier du haut) à celui des Carabelli (du quartier du bas). Colomba Carabelli inspira Prosper Mérimée pour son roman "Colomba".
La commune prend dès le XVème siècle une position importante dans la vallée de Tavaria, et jusqu’à Campomoro.
Arbiddali (Arbellara)
Encore aujourd’hui, l’origine du nom du village reste inexpliquée.
Pour certains, il s’agirait d’une variation du mot «arbre», ou «aire», alors que certains parlent d’une inscription romaine détruite portant l’abbréviation «Ard Bell Ara», soit «autel érigé en souvenir d’une guerre durement gagnée».
La maison-tour est un type d'habitat médiéval.
Ces tours peuvent être trouvées en grand nombre dans les villages en Corse.
Elles étaient initialement fortifiées lors de leur apparition au xe siècle puis elles perdirent leur rôle défensif, les attributs militaires symbolisant alors la puissance de leurs propriétaires.
Appelée la Turra, c’est une ancienne maison tour de trois étages datant du Moyen-Âge.
Elle fut pillée par les Turcs en 1583.

Photo : Augustin Chiodetti.
Voir aussi : Arbellara
Prupià (Propriano)

Peuplée d’environ 3 200 habitants, cette commune dépasse les 20 000 âmes en été.
Protégé des vents dominants d’ouest, son plan d’eau semble avoir été fréquenté dès l’époque romaine. De nombreuses monnaies, vestiges d’habitations ou sépultures mises au jour, laissent à penser que cette bourgade antique pourrait être Pauca, positionnée sur la carte de Ptolémée au IIème siècle de notre ère.
Sur l'actuel territoire de la commune, des communautés grecques, romaines, pisanes et turques se sont installées.
Au début du XVIème siècle, cette modeste escale (dépendante de la Piève de Fozzano), vide d’habitations et d’habitants pour cause d’insécurité barbaresque accueillait les navires bonifaciens ou ajacciens venus charger le blé, l’orge et l’huile de la plaine di A Varia (aujourd’hui nommé Tavaria).
Le 12 juin 1564, deux navires venant de Provence débarquent ici, avec à leurs bords Sampiero Corso et 70 de ses compagnons, désireux d’enlever la Corse aux Génois.
Vers 1767, à la demande de Pasquale Paoli, on élève une importante tour, Torra Nova, utile à la défense de cette portion du littoral.
Puis Propriano va accélérer son développement, entre 1838 et 1845, avec la construction d’une première jetée de 150 m sur les rochers de Scogliu Longu.
Le développement de l’axe routier d’Ajaccio vers tout le sud de l’île permettra au port de Propriano de supplanter peu à peu celui de Tizzano.
Désenclavée, la cité obtient le 28 juin 1860, par la grâce de Napoléon III, sa séparation d’avec Fozzano et son autonomie communale.
Avec son port de commerce comprenant deux jetées et un quai accostable, elle devient à la fin du XIXème siècle un point de liaison pour les bateaux à vapeur. Avec le développement touristique de la fin des années 50, la cité du Valinco avec ses plages, ses criques, ses loisirs, devient une station balnéaire de renom.
Le blason de la ville : « Au premier d'argent à la tour soudée d'or, au second d'azur au poisson d'argent renversé en pal ; à la vergette de gueules brochant sur la partition. »
Vighjaneddu(Viggianello)
Viggianello est un village groupé en belvédère dont une partie s'étire le longg de la route avec de très belles maisons ancienens.
Pieve d'Istria
Arghjusta Muricciu (Argiusta Moriccio)
Argiusta Moriccio provient de la réunion de deux petits villages qui se font face de part et d’autre d’un vallon dans la région du Taravo.
On y découvre un patrimoine corse traditionnel, et l’occupation de ces lieux remonte à bien plus loin dans le temps.
L’Argiusta s’allonge le long de deux routes bordées de maisons caractéristiques datant de la seconde moitié du XIXe siècle.
La plus ancienne se trouve dans le quartier Pestasali et date du XVI° siècle, on pourra la découvrir dans le quartier Caïtucoli d’où l’on a une très belle vue sur le village de Moca Croce.
Ces demeures typiques corses rivalisent de charme.
Flâner dans les ruelles révèle diverses surprises, comme des arches, une petite place…
Une jolie route descend à Moriccio. Pousser, au détour d’une balade, la porte de l’église paroissiale ornée de trois têtes de Maures, ), grossièrement sculptées, à l’entrée du chœur.
Les raids barbaresques ont laissé un tel souvenir douloureux qu’ils ont marqué l’imaginaire des habitants, au travers de pierres sculptées en figures humaines
souvent apposées sur les murs des édifices.Empruntez le joli sentier pédestre qui mène au monument archéologique de « Foci », datant du bronze moyen,
et qui présente un couloir et des chambres faites de blocs de pierre. Dans les environs vous pourrez aussi découvrir un pont génois, un site archéologique et faire de la randonnée…
Azilone Ampaza
Entouré par les communes de Forciolo, Frasseto et Cardo-Torgia, Azilone-Ampaza est situé à 3 km au sud-est de Santa-Maria-Siché
.Situé à 499 mètres d'altitude, le Ruisseau de Catagnone, le Ruisseau u Fiumicellu, le Ruisseau de Monacore sont les principaux cours d'eau qui traversent la commune
.
La vallée du Panicale, qui abrite les villages d'Ampaza, Azilone, Forciolo et Zigliara, appartient plus globalement à la région du moyen-Taravo.
Les deux villages se font face, avec en contrefond de la vallée un cours d'eau ("a viura"), et sont distants de 4 km.
Les deux villages ont pour origine le hameau de Calcinaghju, au milieu de la vallée, détruit par les mauresques. Dans les systèmes administratifs paolinu et génois, la commune appartenait à la pieve d'Ornano.
A voir à Azilone :
église Santa Maria, et son clocher
Petit cimetière champêtre sur la route d'Ampaza
Lavoir restauré récemment
Maisons typiques en pierres
Castellu Locrari juché sur un chaos granitique à plus de 800 mètres d’altitude dans le maquis, dominant l’ancien chemin qui reliait Azilone à Zevaco
A Ampaza :
Eglise Saint Mathieu, et son clocher hexagonal à campanile : datant de la fin XIXème
Eglise San Salvadori : fondée à la fin du XIIème siècle, consacrée par Manfredu di Calcinaghju, évêque d'Ajaccio, qui y fut baptisé ; elle a subi de très nombreuses restaurations au fil des siècles ; le site est campu santu, champ sacré, considérant le nombre de tombes élevées dans les alentours
Petits cimetières champêtres
Maisons typiques en pierres et ruines de caseddi (petites maisons de campagne en pierre)
Casalabriva
Joli village dont le moulin à huile et les maisons traditionnelles sont serrées sur une colline.
Forciolo
Le village de Forciolo a certainement été fondé vers le 15ème siècle. En effet, si l'on se réfère aux cartouches qui figurent sur les façades des maisons près de l'ancien presbytère,
on y retrouve ces inscriptions MIIIIXXXXXXXX VII, c’est à dire 1480 le 7 décembre.
La maison située en face de celle-ci porte un autre millésime AMIIIIXXVIIIX, 1428 le 15 juillet.
C'est la maison datée la plus ancienne de Corse. Un peu plus haut se trouve une autre maison sur le mur de laquelle on peut lire 1575 die XXV octobris.
Ces maisons appartenant aux familles BOZZI qui avec les FORCIOLI étaient et sont encore les principales familles du village, on peut y ajouter aujourd'hui les BURESI.
L'église de Saint-Pierre de FORCIOLO a certainement été construite à cette époque et améliorée par la suite.
Les chapelles latérales l'ont étés plus tardivement puisque celle dédiée à Saint-Roch coté Ouest est datée de 1691, tandis que celle dédiée à Sainte-Marie à l'Est a dû être édifiée avant
car l'appareillage des pierres n'est pas le même et semble plus ancien. Manifestement cette église à été construite en plusieurs étapes car on peut remarquer aussi que même la toiture a été surélevée.
D'après « l'histoire de la Corse » de Monseigneur DE LA FOATA, c'est entre la seconde moitié du XVIIème siècle et la première du XVIIIème que l'ancienne église du PANICALI (là où l'on cultive le millet) a été entièrement abandonnée et que la paroisse de FORCIOLO a dédié l'église du village d'abord à Sainte-Marie puis à Sainte-Marie et à Saint-Pierre simultanément, puis à Saint-Pierre seul pour conserver l'ancien titre de l'église du PANICALI située sur le territoire de FORCIOLO et qui était à l'origine le lieu de culte des villages de FORCIOLO, AZILONE-AMPAZA, ZIGLIARA ainsi que de l'ancien village de CALCINAJO abandonné en 1584 selon l'historien FILIPPINI à cause de la famine et surtout à cause des invasions Turques qui ravageaient la Corse.
De Saint-Pierre de PANICALI construite au XIIIème siècle, il reste encore aujourd'hui l'abside en très bon état, celle-ci a été consolidée dans ses fondations récemment, la municipalité actuelle envisage des travaux de restauration. Ces travaux sont en cours.
Macà Croci (Moca Croce)
Moca Croce est situé près de Petreto Bicchisano. Cette commune regroupe les anciens hameaux de Moca et de Croce, au centre d’une région sauvage.
Du haut de ce village perché, vous apprécierez la vue sur la vallée en contrebas.
Tout d’abord, prenez la route bordée de tilleuls et de maisons datant de la fin du XIX° siècle. .
On y accède par des ruelles typiques corses. Un monument aux morts et une maison forte « A Torra » qui daterait, dans sa partie la plus ancienne de 1572 sont à voir.
Ensuite, dans le quartier le plus important du village, en contrebas de la départementale, se dresse une autre bâtisse de la même époque (1598) « A Casa di u Moru ». Elle doit son nom à une potence de granit en forme de tête de Maure accrochée à la façade.
Le clocher de l’église Santa Maria Assunta, vous fera voyager du haut de ses trois étages. Ajouré et surmonté d’une lanterne, il est l’un des plus beaux de la région. Au lieu-dit « A Sapara », on peut découvrir l’Abbadia Santa Maria di Cruscaglia. Effectivement, cette chapelle de type roman, restaurée récemment, a été construite pour accompagner un prieuré aujourd’hui entièrement disparu. Elle appartenait au XIV° siècle à une abbaye de Gênes. Un campanile a été rajouté au XVII° ou XVIII° siècle.
Et enfin, à ne pas manquer : a Torra de Ballestra, les vestiges d’un ancien moulin près du pont «d’U Rutò ».
Livesi (Olivese)
Véritable balcon surplombant la vallée du Taravo (266 habitants). En contrebas du village, admirez le pont génois « Di A Trinità » édifié en 1698 initialement pourvu de 3 ou 4 il a la particularité de se présenter en forme de « S ». Dans les alentours la cascade d'"A piscia in Alba", rivière, randonnées
Pitretu Bicchisgià (Petreto Bicchisano)
Petreto Bicchisano, autrefois édifié autour d’un château disparu, ce village se situe sur la RT40.
A mi-chemin entre Propriano et Ajaccio au pied du mont « San Petru » qui culmine à 1400m d’altitude.
Constitué de deux hameaux : Petreto et Bicchisano vous accueille dans le Taravo.
A ce jour, il ne reste aucune trace de ce mythique château. Cependant l’architecture de certaines maisons comme les linteaux sur corbeaux permettent de situer les constructions vers la moitié de XVI siècle.
Par ailleurs, Bicchisano est plutôt une terre agricole, de laboureurs et d’artisans qui prédomine Petreto. C ‘est un haut lieu de productions artisanales : fromages, confitures, biscuiterie…Tout d’abord, rencontrez ces hommes au savoir faire ancestral et laissez-vous tenter par une dégustation des produits corses.Vous êtes invités à découvrir ce village au riche passé patrimonial corse. Retrouvez les artisans et producteurs du Taravo.
Ensuite, à ne pas manquer : Le couvent St François et son Christ en bois sculpté, l’église St Nicolas, reconstruite en 1870, de nombreuses maisons de « maître » du village qui font partie du patrimoine corse. Mais aussi le pont génois d’Abra visible depuis la route à quelques kilomètres en direction d’Ajaccio.
Et enfin, , il est difficile de ne pas aller se promener au site archéologique de Settiva. Certes, moins connu que celui de Cauria ou Filitosa, mais tout aussi intéressant.
Il se trouve sur une colline à quelques centaines de mètres vers Casalabriva et date de l’âge de bronze.
Partez à la recherche de la chambre funéraire aux grandes dalles semi-enterrées,du dolmen ou des menhirs cachés.
Le site est dans un bon état de conservation et invite les visiteurs à remonter le temps.
A sarra di Farru (Serra di Ferro)
Une commune jeune, pas même un siècle et demi d'existence, sur un terrain que les hommes ont fréquenté dès les temps préhistoriques, Rome et le Moyen-Age jusqu'au moment où l'insécurité due à la piraterie et à la malaria contraignirent les populations à n'y séjourner que lors des semailles et des moissons ou de l'hivernage des troupeaux.
Au 18ième siècle, la communauté de Zicavo occupe les terrains de Serra di Ferro et de Porto Pollo. Celle de Ciamannacce, Pietra Rossa Celle de Tasso, Tassinca et celle de Palneca, Stiliccione
Puis des hameaux de peuplement se développent demandant des lieux de culte et la constitution d'une commune à laquelle Serra di Ferro, hameau le plus peuplé et central, donna son nom le 1er février 1878. La commune de Serra di Ferro a été constituée le 1er février 1878, sur le hameau central du Taravo, dépendant de Zicavo.
Cette création visait à donner une administration propre à une population occupant ce territoire dans le cadre d’une économie essentiellement pastorale et secondairement de culture. De ce fait, sa population est composée, à l’origine et aujourd’hui encore de familles provenant des divers villages de la vallée du Taravo, regroupés, selon l’origine, dans les différents hameaux qui composent le territoire communal. L’habitat est composé de maisons individuelles entourées d’un terrain regroupées en hameaux, ou dispersées sur le territoire selon les caractéristiques habituelles de l’habitat pastoral.
Porto-Pollo est le hameau de la commune de Zicavo, Tassinca a été créé par les habitants de Tasso, Stiliccione a été créé par les habitants de Palneca, Pietra Rossa par les habitant de Ciamannace. Ainsi chaque village de l’intérieur avait son pendant en littoral.
Avec moins d’un siècle et demi d’existence, le village de Serra di Ferro est bâti autour de l’église paroissiale Sant’Antonu et du presbytère du XIX° siècle qui abrite actuellement les locaux de la poste. Une belle végétation constituée de chêne vert et d’oliviers, ainsi que des prés entourés de vieux murs derrière lesquels apparaissent quelques « Caseddi », vestiges d’un passé agro-pastoral intense, confèrent à ce petit village surplombant la méditerranée, un charme indéniable.
De nombreux sites préhistoriques se situent aux alentours de Serra di Ferro et y attestent d’une occupation très ancienne. Ces lieux sont caractérisés par leurs qualités en terme de salubrité et d’accès à l’eau.
On y trouve :
- La station de Basi
- Le dolmen de « Tola di U Turmentu »
- La statue menhir « U Paladinu »
- La tour de Capriona
- La tour de Capanedda
Zigliara
Situé en plein centre de la vallée du Taravo, ce charmant petit village offre un bol d’air pur aux visiteurs.
A ne pas manquer : l’ église édifiée au XVIIeme siècle à partir d’un ancien bâtiment comporte un tabernacle restauré et classé qui est l’un des plus beaux de Corse du Sud.
A la sortie du village, une église inachevée qui, faute de moyens financiers, ne comporte ni toit, ni fenêtres.
Sous le village, au lieu-dit Mascareddu, les ruines de la chapelle romane San Simeonu sont caractéristiques du style roman tardif, fin XIII°-XIV° siècle
Site archéologiques de Foce
Suddacarò (Sollacaro)
Au pied du col de Celaccia, Sollacaro est le berceau de notre famille paternelle. Ce village, qui a sur son territoire deux sites préhistoriques de premier plan, Filitosa et Calanchi-Sapara Alta, se compose de plusieurs quartiers : Panconu, Livisanu, i Torri, Casanova, A Teppa, Amedina, Lomellino, Poggionovo et Mezzu in Sù.
Ulmetu (Olmeto)
Perché à 340 m sur le flanc de la Punta di u Buturetu, Olmeto est divisée entre le village et le littoral.
Santa Maria Ficaniedda
Santa Maria Figaniella (Ficaniedda dans l'orthographe locale) ocupe un territoire comprenant le nord-est de l'ancienne pieve de Vighjanu et la partie haute de la vallée du Baracci. Le hameau de Ficaniedda, entre Sta Maria et Fozzano, est célèbre pour son église du XIIe siècle. Au nord, après le hameau des Giacomoni (Vadde d'Alzu), la route atteint le col de Siu.
A Chjave
A Chjave : village abandonné aux secrets enfouis
Niché à 150 m d'altitude, en plein maquis, le village déserté surplombe le golfe du Valinco. C'est sa force et sa faiblesse. Cela, d'abord à cause des invasions venues de la mer, mais aussi et surtout du paludisme, dû à l'embouchure toute proche du Rizzanese. Néanmoins, ce dernier n'aurait pas eu plus d'un siècle d'existence et c'est à la suite de cet échec que les habitants de l'A Chjave ont quitté le lieu pour fonder le village de Tivolaggio, un peu plus haut sur les hauteurs.
Mais sur place, les vestiges du passé sont encore là. En arrivant à l'entrée, après une petite demi-heure de marche, une première maison. Partiellement en ruine et où on peut encore y voir une pierre dépasser du mur extérieur à l'entrée qui servait d'évacuation d'eau.
Un peu plus loin, une deuxième bâtisse et son rempart. Lieu de rassemblement en cas d'invasion qui se dresse accolée au belvédère dominant la baie du Valinco afin de guetter les envahisseurs étrangers, venus prendre ce lieu facilement repérable depuis la côte... et d'autant plus prenable depuis les terres.
Et à proximité, les vestiges d'une église sont encore visibles eux aussi.










La maison des Capponi, dite « Casa Capponi », qui était la famille la plus riche du lieu porte une inscription à l'entrée qui ressemblerait à une date. Toutefois, l'archéologue Grosjean lui-même n'aurait pas réussi à la déchiffrer. On y aurait également retrouvé des boulets de canons, témoignant d'un passé violent.
Désormais, à moins d'un retour dans le passé, la véritable histoire d'A Chjave, semble destinée à rester enfouie dans les entrailles de ce lieu tant convoité autrefois,
et si délaissé de nos jours...

Alta Rocca
L'Alta Rocca est une région de Corse-du-Sud située à l'intérieur de l'île. Elle désigne les moyennes et hautes vallées du Rizzanese et de ses affluents (Chiuvone et Fiumicicoli).
L'Alta Rocca est composée des territoires de trois pièves pour un total de 16 communes :
Tarra cara
Diana Saliceti sillonne avec vous les routes du sud de la Corse entre villes et villages pour découvrir les territoires et leurs acteurs.
Pieve de Tallano
Santa Lucia di Taddà (Ste Lucie de Tallano)
Situé à 460 mètres d'altitude, au milieu d'oliveraies, le village de Santa Lucia di Tallà fut la capitale féodale de la Rocca et de la pieve de Tallano (ou Attallà). Elle fut mise à sac par les Barbaresques en 1583. Ce village est étonnant par l’ensemble architectural que forment les hautes maisons de granit organisées en ruelles étroites. Le quartier de Cudetta (la colline), noyau primitif du village abrite la tour de défense, A Casa Turra, datée du XVIe siècle, qui est classée monument historique. Au centre du village, A piazza di l’Olmu, était autrefois le jardin du curé. On y trouve une imposante fontaine du XIXe siècle et le monument aux morts dont le socle est constitué de diorite orbiculaire.
Altaghjè (Altagene)
Le territoire d'Altaghjè occupe les collines de la haute vallée du ruisseau de
Piève, affluent du Rizzanese, et le massif montagneux du Sarradò
culminant à 1033 mètres.
Composé de différents quartiers, Casanova, Foce, Manchianu, Parata,
Piantuleddu, ce petit village en bout de route appartient historiquement à la Piève de Tallano.
Paysage humanisé de vergers, d'oliviers, et de champs en terrasses
avec jardins toujours bien entretenus.
La commune permet de sympathiques ballades : on peut emprunter
le chemin quittant Altagène par le nord et se promener sur 3 km en
direction de Serra di Scopamena pour profiter d'un intéressant panorama sur le village voisin
de Zoza et sur le Rizzanese. Au nord-est, en hauteur, se trouve le quartier
de Casanova au départ
duquel on accède au plateau de Sarradò.
Au sud-est de la Commune, le lieu-dit “Presa
Tusia” est le site d’un village fondé au cinquième
millénaire avant Jésus-Christ par une communauté agropastorale. On y
observe la présence
d'une allée mégalithique
non couverte ainsi que celle d'un menhir.
Altagène, l'esprit d'un village de l'intérieur, ouvert à tous
Publié le mardi 14 août 2012

Historiquement, Altagène est rattaché à la pieve de Tallano… Mais attention, le petit village de l'intérieur ne doit pas pour autant être associé à un des hameaux du gros bourg de Sainte-Lucie. Son territoire, 5 km2, occupe les collines de la haute vallée du ruisseau de Pieve, affluent du Rizzanese et le massif montagneux de Sarrado, culminant à 1 033 m d'altitude. Un village, perché à 620 m d'altitude, bordé par la nature et découpé en cinq quartiers (Parata, Piantuleddu, Casanova, Foce, Manchianu) que l'on trouve en bout de route… Ici, on ne fait pas pour autant la résistance comme dans Astérix et les villages de Gaulois, mais, sans querelle de clochers, on cultive sa différence, celle d'un village de l'intérieur. Un village de l'Alta-Rocca dans toute son identité particulière. Une identité qui fait la part belle à la convivialité et à l'hospitalité : un vrai village de l'intérieur ouvert sur l'extérieur. « L'esprit corse avant tout », insistent les habitants.
Altagène c'est une cinquantaine d'habitants en hiver, multiplié par six l'été avec le retour des enfants du village. On est loin de la période de l'après-guerre où la commune a abrité jusqu'à six cents personnes, deux ou trois « cantines » et même un tribunal d'instance… Jusque dans les années 60, une école accueillait une quarantaine d'élèves….
Mais on est également loin de la dizaine de personnes seulement qui peuplaient Altagène à la fin des années 80. « Quand je suis arrivé à la mairie en 1995, nous étions moins d'une vingtaine. Depuis des familles se sont installées. Un commerce saisonnier de mai à octobre, un kiné, un agriculteur… Et il y a des demandes en attente pour des installations. L'an dernier, il y avait pas loin de 14 gamins scolarisés, on aurait presque pu rouvrir une école », indique le maire, Toussaint-François Simonpietri, également vice-président de la communauté des communes de l'Alta-Rocca. Un projet de lotissement est d'ailleurs en cours. Tout comme celui de l'assainissement avec des raccordements faits sur la station d'épuration de Tallano.

Deux communes aux destins liés tout de même… Altagène s'adossant à Tallano pour se développer. « Une légende dit que la chapelle Saint-Jean, construite sur le territoire d'Altagène, a été détruite dans la nuit pour être reconstruite sur celui de Tallano… On est proches, on avance de concert, chacun avec nos atouts ».Et ceux d'Altagène ne sont pas négligeables, surtout pour une commune relativement petite. On y fait de la réhabilitation du bâti ancien, du lavoir il y a six ans. Un plateau d'estive a vu l'installation d'un groupement pastoral, avec une bergerie, il y a deux ans et un producteur de fromage… En toute simplicité, sur ses valeurs, Altagène renaît… En bout de route géographiquement, le village a le potentiel pour que son développement ne soit pas, lui, en cul-de-sac… Et toutes les cartes n'ont pas encore été jouées !
Carghjaca (Cargiaca)
Situé à l’extrême nord-ouest du Tallanais, le village est bâti sur les
flancs d’une vallée encaissée où le Rizzanese se resserre en
gorge, donnant au relief des formes accidentées.
Le territoire, à la limite des anciennes pièves de Tallano et de Scopamena, présente des signes d’une certaine prospérité faite de l’exploitation des oliviers et de jardins aménagés sur de riches terres alluviales. Les maisons basses d’origine pastorale alternent le long de la
route avec des "Casone" aux façades ornées de corniches, corbeaux,
linteaux et balcons. En bas du village, les fondations de plusieurs maisons semblent dater du
XVe
siècle.
À l’est du village se dresse un rocher où, suivant la tradition, s’élevait
un château nommé Castellu Della Rocca. La magnifique église paroissiale, restaurée au
XVII
e siècle, est dédiée à l’Apôtre San Paolo. Elle
possède un élégant et haut clocher latéral à lanternon aux pierres de
granit appareillées avec soin.
Le cimetière,
situé au sommet
d’une longue
crête, offre un
vaste panorama.
Au nord de celui-ci, le hameau de
Zizzi devrait son
nom au général
Zizzoli qui, lors
d’une bataille, y
aurait enfoui un trésor.
Zoza
Ce village construit à flanc de coteau présente la particularité d’être
face au nord. L’environnement montagneux, bien que modeste,
réduit sensiblement en hiver l’ensoleillement du village.
Le village de Zoza abrite de grandes maisons allant du simple “caseddu” à la maison de maître crépie avec des balcons, en passant par l’étroite demeure en forme de tour. L’église Santa Margherita, avec son campanile, domine le village. A l’entrée du village, une croix en bois assez imposante, offerte par un artisan local, accueille les visiteurs. Au sud-ouest de la commune, un piton de 455 mètres nommé Punta
Di Casteddu doit son nom à une ancienne tour carrée dont on voit
encore les fondations. Les différents quartiers de Zoza, nommés
Mezza In Su ou Mezza In Ghjo, Correntino, Poggiolo, Mezza In Sopra,
Pretrajolo et Chjerchiaja, abritent de grandes et superbes maisons qui
présentent les variantes de
la région allant du simple
casseddu aménagé en
résidence d’été à la maison de maître crépie avec
des balcons en passant par
l’étroite demeure en forme
de tour. L’église Santa
Margherita, avec son élégant campanile latéral, élancé et ajouré, domine
les jardins en terrasses.
En venant de Santa Lucia, à
l’entrée ouest du village,
une croix en bois assez imposante vous accueille. Celle-ci offerte par
un artisan local, surprend par la présence d’outils suspendus (tenailles, marteau, échelle, clou...), lesquels évoquent la passion du Christ.
En aval du village, à proximité du barrage du Rizzanese, qui fournit près de 40% de la puissance hydroélectrique en Corse, se trouve un site de baignade.
Au niveau du petit parking se trouve un escalier qui permet de rejoindre une deuxième route : c’est à partir de cette dernière que débute un large chemin qui descend jusqu’au Rizzanese.
On rejoint la piscine naturelle qui se trouve à proximité du Ponti
Vecchju après seulement cinq minutes de marche environ.
L’accès n’est pas évident et on risque de glisser à cause de la végétation, et plus notamment à cause de la mousse.
Ce site de baignade est vraiment un très bel endroit : une piscine naturelle assez profonde, une petite cascade derrière le pont, de grandes plaques de granit
, ainsi que les vestiges d’un ancien moulin. Plus loin sur la gauche du pont, d’autres piscines naturelles plus au calme.
Laretu di Taddà (Loreto di Tallano)
Formant la partie occidentale de la piève de Tallano, cette petite
commune s’allonge sur 6 km entre la rive droite du Rizzanese et
les pentes des petites montagnes qui délimitent le Tallanais et le bassin du Baracci correspondant à l'ancienne piève appelée Petite Rocca.
Au centre du territoire communal, le lieu-dit Muratu semble être un
site romain. Plus au nord, en haut du vallon de Giaga, près de la limite
communale avec Fozzano, il existait un village nommé Altanaggia,
protégé par un château bâti au sommet de la Punta D’Arghja Vecchia
qui, du haut de ses 670 mètres, offre un panorama intéressant sur
toute la commune.
Le centre de l’agglomération est composé de très anciennes maisons
typiques, la plus ancienne datant certainement du Moyen-Âge. La plupart d’entre elles sont dotées de magnifiques linteaux, de porches élégants, de voûtes et de splendides portes.
L’église Santu Pietru, construite au début du siècle, remplace un édifice médiéval situé jadis au centre du cimetière qui possède une nef
soutenue par six
colonnes en pierre
de taille de 2 m 50 de
haut.
De Loreto, un sentier
permet de rallier à
pied Tallano. On franchit le Rizzanese par
le Pont de Piombatu,
formé de deux passerelles soutenues
par une pile de pierre.
Mela
Appelé traditionnellement Mela-di-Tallano, le village s’étire en longueur du nord au sud, sur une éminence.
Le point haut, au nord, surplombe des petites montagnes boisées de
chênes et de maquis. C’est un bel environnement verdoyant de pâturages et de cultures en terrasses qui compose ses abords.
Ce petit territoire est coupé au centre par la vallée du Fiumicicoli. Le
hameau de Foce di Mela, aux constructions étagées est situé à une vingtaine de kilomètres du village par la route contre 2 Km à vol d’oiseau.
Le village est constitué de quelques belles maisons anciennes de granit. L’église paroissiale présente un petit clocher carré surmonté d’un
lanternon. Dans le petit cimetière, en léger contrebas de la route,
apparaît le bas des murs des vestiges de l’ancienne église romane
Santa-Maria-Assunta. Pas plus hauts que les herbes au printemps, ils permettent de visauliser le plan et les dimensions de l'édific.
Sur la place du village, les mains expertes de Stéphane Deguilhem ont transformé un orme mort en un cheval de 2,50 mètres de haut !
Ulmiccia (Olmiccia)
Cette commune formant la partie sud-ouest de la piève de Tallano,
occupe la rive gauche de la moyenne vallée du Rizzanese. Son territoire, tout en longueur, est constitué d’une plaine où, depuis près de
deux siècles, la vigne occupe environ 35 hectares.
Entouré de belles oliveraies, ce village est bâti à flanc de coteau entre
330 et 380 mètres d’altitude.
À 800 mètres au sud-ouest du village d’Olmiccia, près du sommet
d’une de ses collines, existait le village de Frassetu, ruiné au
XVIe
siècle. Les cabanes de berger qui l’ont remplacé bénéficient d’un magnifique panorama.
Les différents quartiers sont nommés : Cori Vecchju, Cori Di Ghjaddu,
Ribba Tortone.
L’église Sant’Ippolito e San Cassianu, sanctuaire roman élevé au
XIVe
siècle a été réaménagée en 1896. Autrefois, la commune possédait 4 moulins, l’un d’entre eux, le “Risé”, fermé vers 1950, utilisait les eaux du Rizzanese.
Pieve de Carbini
San Gavinu di Carbini
San Gavinu di Carbini est une vaste commune qui s'étend de la
plaine à la montagne où l'on trouve San Gavinu et les hameaux :
Gualdariccio, Giglio, Sapara Maiò dans un environnement de forêts
de chênes verts et de châtaigniers et, en plaine littorale, les hameaux
de Gialla, Arragio
et Ribba, liés par
plusieurs siècles
de transhumance.
éparpillé sur une
vaste colline boisée, San Gavinu
renferme de vieilles maisons en
granit du
XVIIe
siècle.
De nombreuses
curiosités composent le territoire
de San Gavino :
Le menhir et
l'abri-sous-roche de Paccionitoli, la cascade du barrage de l'Ospedale...
Sur le Pianu Di I Stantari, subsistent plusieurs restes d'alignements de menhirs. Le site préhistorique du Casteddu Saliseu fut utilisé par les seigneurs Biancolacci pour s'y fortifier vers l'an 1 000
jusqu'au
XIVe
siècle.
L'église paroissiale d'origine romane possède des particularités dont
certaines restent encore énigmatiques. Le casteddu d’Araghju présente l’aspect d’une enceinte circulaire fortifiée de 40 mètres de diamètre.
Voir aussi : San-Gavino-di-Carbini
Carbini
Carbini, qui occupe le
haut bassin du Fiumicicoli, est composé d’un
ensemble de collines
assez verdoyantes dominées au Sud par la Punta
di a Vacca Morta et son
contrefort d’Accinto. En
arrivant par la route de
Sotta, vous rencontrerez
les hameaux récents de
Foce d’Olmo, de Noci,
puis d’Orone.
Au cours de son histoire, le village a beaucoup souffert : il fut entièrement rasé lors des incursions barbaresques et fut au cœur de la sanglante croisade contre les Giovannali,
un mouvement religieux réprimé au
XIVe
siècle.
L’église pisane de Carbini comporte
une nef unique, flanquée d’un campanile isolé au nord-est de l’abside. Une
seconde église de même style mais
plus petite, dédiée à San Quilico existait à côté de San Giovanni. On en voit
les vestiges au sol.
Selon la tradition locale, le campanile
de San Giovanni serait l’œuvre de
Maestro Maternato, l’architecte pisan
qui réalisa le pont du Rizzanese.
L'article de Wikipedia : Carbini
Livia (Levie)
Cette vaste
commune
s'étire sur une
longueur de
17 km, entre la
vallée du Rizzanese et le
Pianu de Levie
au nord, et la
montagne de
Cagna au Sud.
Elle se définit
de nos jours
comme le centre administratif de l'Alta
Rocca.
Né au
XVe
siècle du rassemblement de plusieurs villages, Levie en
garde, aujourd'hui encore, des quartiers bien définis où se trouvent
des bâtisses à l'architecture remarquable : Santa Cruci, au sud, A
Sorba, U Casonu à l'ouest, Castaldaccia, Insuritu, Pantanu au nord,
Ulmiccia et A Navaghja à l'est.
Comme tout l'intérieur de l'île, la seconde moitié du
XXe
siècle a
marqué un net ralentissement de l'activité de la micro région et du village.
Aujourd'hui, l'amélioration du réseau routier et des moyens de communication ont permis d'enrayer la baisse démographique.
Levie abrite le Musée de l'Alta Rocca.

La page Wikipedia : Levie ;
Zonza
Véritable carrefour de l’Alta Rocca, la commune de Zonza se singularise par une partie montagneuse qui égale en richesse la partie
maritime. Elle est un lieu de villégiature apprécié pour ses hôtels et
ses restaurants.
Construite en terrasse peu à peu depuis le
XVIIe
siècle, c’est en hauteur
que l’on trouve ses plus vieilles maisons de granit, bâties sur des
blocs rocheux qui dominent la vallée de l’Asinao au milieu des châtaigniers, des pins et des chênes verts. L’église Santa Maria Assunta, de
style néogothique, est bien différente de l’ancienne paroisse locale :
San Cesario, dont on voit encore les ruines à 800 mètres du village. La
chapelle romane Santa Barbara paraît plus ancienne.
Au nord, les aiguilles de Bavella composent un étonnant site de haute
montagne. Un arrêt au col permet d’admirer la couleur changeante
des grandes murailles rocheuses émergeant des pins laricio, et
l’âpreté du paysage. Un sentier permet aussi de rejoindre en une
heure le Col de Velacu. Au sud-est, vous atteindrez l’Ospedale en traversant la forêt domaniale. Une piste conduit aux bergeries du plateau de Luviu, témoins des transhumances d’autrefois qui empruntaient la vallée de Cavu.
Au Col d’Illarata, un point
de vue fantastique vous
permettra d’apercevoir
par temps clair, le Golfe
de Porto-Vecchio et la
vallée de l’Ortolo.
Zonza
possède une façade
maritime très prisée.
Situé à 2 km de Sainte
Lucie de Porto-Vecchio, le
golfe de Pinarellu abrite
de longues plages de
sable blanc bordées de
généreuses pinèdes.
La page Wikipedia : Zonza.
Pieve de Scopamene
Auddè (Aullène)
Aullène est un village de montagne de tradition pastorale dont le territoire s'insère dans la partie haute d'une vallée parallèle et méridionale à celle du Taravu.
Avec ses 850 mètres d'altitude, le village d'Aullène s'enroule autour de deux poghji (promontoire) dominés par la Punta d'Ariola, un sommet de 1449 mètres.
Les lignes de crête, dont le sommet principal Punta di Sistaja culmine à 1724 mètres, constituent les limites naturelles du village à l'est, au nord et à l'ouest tandis que le Col de la Tana borne le territoire au sud-sud-ouest.
Le Chiuvone, qui prend sa source sur le plateau du Cuscionu, marque la frontière nord-nord-est de la commune et longe le village avant de poursuivre sa course vers le sud-sud-ouest en direction du Valinco.
Le village d'Aullène, situé au cœur de l'Alta-Rocca, est fortement marqué par une vieille tradition pastorale avec les villages de Monaccia d’Aullène et Ghjanuciu au pied de la montagne de Cagna. Il n’est pas rare de retrouver les mêmes familles dans les trois villages.
Dans l’église paroissiale Santu Nicolau, la chaire à prêcher du XVIIIe siècle en menuiserie sculptée est classée auprès des Monuments historiques.
À la chapelle rurale Santu Antiochu on peut assister, chaque premier dimanche du mois d'août, à la représentation du Saint en procession depuis l'église, célébrant ainsi la "Transfiguration" tout en contribuant à la fête du village qui fut jadis l'une des plus importantes foires aux bestiaux de Corse.
Au nord-est du centre du village, au lieu-dit "Castellare" se trouve un petit sommet sur lequel fut érigée, probablement au XIe siècle, une place forte. On accède à l'emplacement du château par les vestiges d'un fort ancien escalier de pierre, une vraie curiosité !
En contre-bas du « Castellare", sur le dôme planté de châtaigners autour duquel s'enroule une partie du village "Campanaju", aurait été construit au XIIIe siècle la place forte de Sinucello Della Rocca, celui qui parvint un très court temps à unifier l'île dans sa presque totalité.
Surbuddà (Sorbollano)
Le village est bâti sur le flanc d’un coteau bien orienté au midi. Il se
compose de 9 quartiers : Casi Subrani, Costa Di Soli, Valdarello, Matelot, Poghju, Chedi
Anghjulellu, Chedi
Filippi, Chedi Bartolo et Chedi Petru
portant les patronymes des premiers habitants.
Au sud et en dessous de l’église, le
quartier médiéval
de Contra Paisolu
renferme les plus
anciennes maisons du village.
L’église paroissiale Sant’Andrea est dotée d’un haut clocher et remplace un ancien édifice roman de taille plus modeste. La tradition nous conte que
celle-ci aurait dû être construite en dehors du village, et qu’un soir,
des boeufs auraient porté les pierres au centre du village, à son
emplacement actuel.
La fontaine de granite blanc est très élégante.
De merveilleuses terrasses sont couvertes de jardins potagers. Cette
verdoyante commune, composée de collines entrecoupées de nombreux vallons, est dominée au nord par plusieurs sites accidentés.
Elle renferme également une route sinueuse s’élevant parfois en corniche au-dessus du Rizzanese et du Codi. De nombreux sentiers bien
tracés vous permettront de parcourir les paysages de ce beau village.
A Sarra di Scupamena (Serra di Scopamene)
Le territoire communal s’étend tout en longueur et propose une
très grande diversité de reliefs et de paysages.
Au sud, il se développe au-delà du Rizzanese qui arrose la commune,
au nord à une quinzaine de kilomètres, il renferme la haute et étroite
vallée du Codi. L’intersection des deux cours d’eau formera la retenue
du barrage. Le village de Serra comporte trois hameaux, celui d’Acqua
Fritta, de Vangonu et celui de Chiesa. Tous trois renferment de belles
maisons en granit, d’architecture altière.
Le moulin situé à l’entrée du village offre un excellent témoignage du
passé castanéicole de la région. Le quartier de Chiesa, qui constituait
le village jusqu’au
XIIIe
siècle et renferme l’église San Niculao, offre un
vaste panorama sur la vallée du Rizzanese. L’église est dotée d’un clocher carré à créneaux et d’une façade honorant Saint-François d’Assise
par des scènes de sa vie en fer forgé. Elle possède aussi un bénitier en
marbre en forme de calice datant de 1677, une statue de Saint Antoine
en marbre blanc et six vitraux représentant St Nicolas, une Vierge à l’enfant, St Pierre, St Joseph et St Jacques. Face au village, se trouve la
Punta di Cuciurpula (1 164 m) connue pour son casteddu du 13-16e
siècle
qui a fait sa renommée. Ce sommet granitique aux trois pointes, très
caractéristiques
dans le paysage
avec ses amas de
blocs, ses tafoni,
ses abris sous
roche, ses charbonnières qui
attestent vraisemblablement de l’occupation de ce site
par les hommes
préhistoriques et
plus récemment
par les éleveurs et
les résistants.
Zerubia
En dessous de Serra-di-Scopamene , à l'ouest de Quenza , au-dessus de Sainte-Lucie-de-Tallano, Zerubia compte dix fois moins d’habitants qu’il y a 100 ans.
C’est le plus petit village de la Communauté de Communes.
Situé à 815 mètres d'altitude, Zérubia est entouré de montagnes couvertes de châtaigneraies. La crête occidentale est traversée par la route au col de la Tapa (975 m). Le Rizzanese, le Chiuvone et le Baraci sont les principaux cours d'eau qui traversent la commune de Zérubia.
Datant du 15ème siècle, le village comporte plusieurs fours à pain, des séchoirs à châtaignes… Ce village possède 19 bâtiments inscrits au registre des monuments historiques. Perchée sur un plateau à 820 mètres, l'église Santa Trinité domine l'ensemble des maisons.
Des bergeries sont encore là, vestiges d'un passé pas si lointain pourtant. Le pastoralisme qui fut sa richesse y est encore pratiqué. Jadis, Zérubia entretenait des relations pastorales traditionnelles avec Pianotolli-Caldarello.
Au mois d'août, le village organise un grand bal puis une fête des enfants et enfin un grand repas convivial sur la place du village.
Quenza
Quenza s’étale sur un important territoire. À l’ouest le plateau du
Cuscionu, coupé de petites vallées, au nord et à l’est de hauts
sommets dont la chaîne de Bavella et ses célèbres Aiguilles de granit
rouge, au nord-ouest l’Incudine.
De nombreux cours
d’eau torrentiels, fontaines et sources drainent
des paysages grandioses. C’est une nature
variée et sauvage qui
reçoit nombre de randonneurs et de montagnards.
La forêt de Bavella comporte de superbes peuplements de et chêne-vert et accueille une
réserve de mouflons,
tandis que le plateau du
Cuscionu qui recevait de nombreux bergers venus transhumer, abrite
un parc à cerfs.
Le village regroupe des maisons de pierre au cachet très particulier,
comme la maison du
XVIe
siècle avec son piumbatoghu sur le pignon,
la tour de défense de la même époque ou le château Florentin
avec sa tour crénelée. En contrebas du village, la chapelle
romane Santa Maria, datée de l’An Mille est classée monument historique. L’église paroissiale St Georges présente en façade quelques
blocs de serpentine verte d’origine romane.
Quenza, la terre des Seigneurs privilégie le naturel
Corse Matin, 20 août 2012

Quenza, un paradis au cœur de 10 000 ha d'une nature grandiose.
Dès neuf heures, sous un soleil déjà ardent, jeunes et moins jeunes étaient tous sur le pont, ou plutôt sur la place de l'église pour une journée chaleureuse. Les chasseurs rentraient d'une battue fructueuse. Une ambiance idyllique pour un village où le sens de la fête n'est pas un vain mot.
Les générations passées se souviennent d'ailleurs de la discothèque où venait danser tout l'Alta-Rocca. Elle a disparu, mais l'esprit est resté ; celui d'une convivialité contagieuse. Visiblement heureux de se retrouver, les habitants ne manquent pas d'enthousiasme quand il s'agit de mettre en avant les charmes de leur village…
Et de charme, cette magnifique commune de la terre des Seigneurs n'en manque pas. Avec un véritable cadeau des dieux, ce patrimoine naturel inestimable que le maire, Antoine-Sylvestre Pietri aimerait tant mettre en valeur. Car si du point de vue architectural et du patrimoine religieux notamment, Quenza a été gâtée, ses 10 000 hectares de superficie, domaine de chasse majestueux, englobant les plus beaux sites de Corse avec le massif de Bavella et le plateau du Cuscionu sont un luxe naturel. « Et ce qui nous tient vraiment à cœur c'est le développement d'une vraie dynamique autour des sports nature, comme le ski de fond, les raquettes et randonnées, sur le plateau. Pour qu'il revive. Dans les années 60, l'ambiance était phénoménale… La structure refinancée est désormais ouverte, pour l'instant avec un agent du PNRC, mais il y a un vrai potentiel à mettre en avant, en préservant des emplois locaux ».
Un rêve pour le maire qui serait évidemment un complément économique pour les 150 habitants vivant à l'année sur la commune. Village déjà dynamique avec pas moins de trois sociétés de TP, un commerce à l'année, un hôtel renommé et plusieurs bars et restaurants, gîte, un atelier de sculpture etc. Plusieurs éleveurs perpétuent la tradition avec une charcuterie savoureuse notamment. Le premier parc à cerfs pour la reproduction est aussi sur la commune… « Nous voulons faire rayonner tout ce potentiel… »
La commune qui possède désormais sa nouvelle station d'épuration et travaille à son réseau d'assainissement, peaufine ainsi également ses atours avec une réfection prochaine de ses deux lavoirs et quatre fontaines… Des projets à la hauteur de toutes ces richesses qui font Quenza. Avec la plus belle, celle du cœur de ses habitants.

Avretu et Bonifaziu
Avretu, toujours utilisé sans l'article défini en corse, fait référence à la zone de plaines située au pied de la Cagna sur les actuelles communes de Figari et de Sotta, s'étendant au nord jusqu'à la Cagna, à l'ouest jusqu'à Roccapina, au sud jusqu'au massif de collines de la Trinité qui le sépare de l'arrière-pays de Bonifacio et à l'est jusqu'aux abords de Porto-Vecchio. Avretu (ou le Freto) correspond à l'ancien canton de Figari (qui a existé entre 1973 et 2015). Cette micro-région comprend d'est en ouest, les communes de Sotta ; Figari ; Pianottoli-Caldarello ; Monacia-d'Aullène.
Son tissu d'habitat est principalement constitué de petits villages et hameaux pastoraux éparpillés dans la plaine, vestiges de la transhumance d'autrefois entre le Freto et l'Alta Rocca, en particulier la piève de Scopamène.
"Avretu" est le nom corse le plus usité pour désigner cette microrégion, comme en témoigne l'existence de la revue locale A Pian d'Avretu (créée en 1991) et du
groupe de polyphonies Avretu, tous deux fondés par des habitants de la région.
Cependant, cette orthographe ne fait pas consensus.
On relève également quelques occurrences des formes aphérésées Fretu et plus rarement Frettu. La première est à rapprocher de la graphie toscanisée la plus répandue, Freto, ancienne pieve, attestée dès le XIVe siècle dans les écrits du chroniqueur Giovanni della Grossa.
On peut rapprocher l'origine du nom de cette micro-région par le sens latin du mot fretum qui signifie bras de mer, détroit, plus précisément originellement, endroit où les eaux bouillonnent, sont agitées. Cela correspond bien à la situation géographique des lieux à l'extrême-sud de la Corse et au caractère périlleux des Bouches de Bonifacio.
L'expression "Pian d'Avretu" (où pian est issu de l'apocope du mot piana signifiant "plaine") décrit un périmètre bien plus large et sert encore aujourd'hui pour
désigner la plaine située entre Monacia-d'Aullène et Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio.
Désertée des suites du paludisme et des incursions barbaresques, elle n'est déjà plus mentionnée à la fin du Moyen âge.
Le territoire correspondant se repeuplera progressivement à partir de la fin du XVIIIe siècle par la sédentarisation de bergers originaires des pièves de Carbini et Scopamène.
Pieve de Bonifacio
Bunifaziu (Bonifacio)
La ville de Bunifaziu est située à l'extrême sud de la Corse. La Sardaigne n'est qu'à 14 km, distance qui constitue le détroit de Bonifacio. La ville est bâtie sur une presqu'île d'environ 1500 m de longueur sur 200 m de largeur, rattachée à la terre par l'isthme de Saint Roch. La ville est scindée en trois parties : La Haute Ville, La Marine et les alentours (la campagne).
La Haute-Ville a été conçue sur la presqu'île de calcaire et de nombreuses habitations surplombent les falaises.
La haute ville
Bonifacio, la Cité des falaises est entourée de fortifications qui ont protégé au fil des siècles la haute ville des attaques des assaillants.
Pour accéder à la citadelle de Bonifacio depuis le port, deux possibilités s'offrent aux visiteurs par les anciens pont-levis. Par la route ou à pied par la montée Rastello puis la montée Saint Roch, les visiteurs atteignent le pont-levis de la Porte de Gênes, construit en 1588.
La haute ville offre des points de vue imprenables sur les falaises de calcaire rongées par la mer, le "Grain de Sable", les bouches de Bonifacio et la Sardaigne juste en face.
A travers les ruelles étroites surplombées de nombreux aqueducs, les hautes maisons aux façades blanches se dressent à l'infini et nous plongent dans les vestiges d'un passé millénaire. En période de siège, les aqueducs servaient à recueillir et à acheminer les eaux de pluie vers la Cisterna, la réserve en eau potable.
Plusieurs églises parmi lesquelles Sainte Marie Majeure, principal et plus ancien édifice de Bonifacio, Saint Dominique, Saint François ou Saint Jean-Baptiste témoignent de la profonde piété des bonifaciens, toujours présente lors des processions religieuses des différentes confréries pendant la semaine Sainte.
La Maison du Podestat, ancienne demeure qui représentait l'autorité de la république de Gênes dans la ville, la Maison qui hébergea Bonaparte en 1793 dans la rue des Deux Empereurs, Charles Quint et Napoléon Bonaparte, les couvents, les phares ... nombreux sont les monuments à visiter.
L’Escalier du Roy d’Aragon, visible depuis la mer est situé à l’extrémité sud du promontoire, les Jardins de Carotolla, les arches de l'Archivolto ... sont autant de lieux à découvrir.
La Marine dispose d'un port de commerce hébergeant les plaisanciers et permettant d'accueillir de nombreux bateaux. On peut notamment embarquer pour les îles Lavezzi.
A voir sur le site :
De nombreuses promenades et randonnées autour de Bonifacio.
Et la galerie photo.
Figari
Munaccia d'Auddè (Monaccia d'Aullène)
Sotta
Piannottuli Caldareddu
Pieve de Porto Vecchio
Conca
Bavedda (Bavella)

Lecci
Portivechju
Sari Sulenzara

Prunelli (ou Pruneddi)
Le Prunelli occupe la vallée du fleuve éponyme. Il culmine au Monte Renoso (2 352 m) et a pour capitale Bastelica.
Le Prunelli désigne l'ensemble des territoires situés dans le bassin versant du fleuve Prunelli, c'est-à-dire l'ancienne pieve de Sampiero (région de Bastelica), à laquelle sont ajoutées les communes de Pietrosella et Coti-Chiavari ainsi que la partie littorale des communes de Grosseto-Prugna (Porticcio) et Albitreccia (Molini), toutes d'anciennes terres de transhumance hivernale des habitants de la vallée du Taravo.
La région du Prunelli désigne, en descendant vers la mer, les territoires des communes de :
- Bastelica (Basterga)
- Tolla (Todda)
- Ocana (Òcana)
- Cauro (Cavru)
- Eccica-Suarella (Èccica è Suaredda)
- Bastelicaccia (A Bastirgaccia)
- Pietrosella (Pitrusedda)
- Coti-Chiavari (Coti è Chjàvari).
Pieve de Cauro
Bastelica
Bastelica ouvre en grand la porte de ses beaux quartiers
Publié le samedi 18 août 2012
Ils nous ont remis les clés. Nous ont confié leur village comme on donne son cœur. Ils nous ont remis les clés de leur fief, un bastion noble. Avec des quartiers où les habitants vivent dans des espaces ouverts les uns sur les autres.
Ils nous ont montré la route. D'un village où le patrimoine architectural scelle, à chaque détour, l'itinéraire historique d'un héros, Sampiero Corso.
Ils nous ont ouvert les portes, les habitants de Bastelica. D'un même pas. En tête, leur maire, Jean-Baptiste Giffon, premier magistrat d'un village de montagne où il faut concilier écoute et détermination. Bastelica, village perché à 800 m d'altitude, justement récompensé cette année. Honoré par le congrès national des élus de la montagne qui viendra y asseoir ses réflexions les 26 et 27 octobre prochains. 350 congressistes y sont attendus.
« Mon combat quotidien ? Maintenir les services de proximité, poste, école, services médicaux d'autant que la commune assure de multiples compétences, adduction d'eau potable, assainissement, déneigement avec le conseil général, gestion de la station de ski, action sociale… »,énumère le maire.
Mais le jeu en vaut la chandelle. Car la commune qui s'étend sur 12 500 ha possède une situation privilégiée au centre de l'île à 35 km du bassin de vie ajaccien. Centre de gravité encore plus vrai depuis la réfection en 2011 de la route qui descend le col de Scalella.
La vie du village repose sur un triptyque : agroalimentaire, tourisme, éducation. « Nous avons créé un centre d'immersion linguistique, avec des thématiques plurielles, qui servira de classe de découverte pour les écoles de Corse et sera opérationnel au premier semestre 2013 ».
En projet encore, une station d'épuration toute neuve début 2013 avec les réseaux afférents (pour un coût de 5 millions d'euros), l'élaboration d'une carte communale dès la rentrée ; de nouveaux investissements pour la station d'Ese ; la restauration de l'église.
Ils ont nous ont remis les clés, les habitants de Bastelica. Nous leur avons rendu, une fois notre visite terminée. Mais nous avons gardé un peu de leur cœur. Comme un supplément d'âme.
Bastelicaccia
Cavru (Cauro)
Cuttoli Curtichjatu
Ocana
I Peri
Tolla

Balagna
La Balagne correspondait aux cinq pièves suivantes :
Tuani, avec sept villages, parmi lesquels Belgodère, Occhiatana, Speloncato ;
Aregnu, qui contient seize villages, dont les principaux sont : Corbara, Monticello, Sant'Antonino et Santa-Reparata ;
Sant'Andria, qui renferme cinq villages dont Feliceto ;
Pino, dans laquelle se trouve Montemaggiore, village riche et bien peuplé ;
Olmia, où se trouvent les villages de Calenzana et de Moncale.
Pieve d'Olmia
Calvi
Un peu d'histoire
Calvi (le nom viendrait de "Calvo”, du latin "chauve", ou bien de “Sinus Casalvi” voulant dire baie, ou peut-être encore de “Cales”, ville de Campanie) s'est construit sur la Punta San Francesco, entre le golfe de la Revellata et le golfe de Calvi. C'est dans la deuxième moitié du XIIIe siècle qu'a été édifiée la Haute ville, à l'est de la Punta San Francesco. Selon la légende d'Ugo Colonna, existait au Moyen Âge « Cordovella, ville fortifiée, bâtie à l'endroit où est aujourd'hui Calvi ».
Calinzana (Calenzana)
La commune de Calinzana est la plus étendue de Haute-Corse (183 km2). Elle s'étend jusqu'à la mer, avec la plage de Crovani et vers la montagne : les sommets de a Muvrella (2 148 m), du Capu di u Carrozzu (2 139 m), du capu Ladroncellu (2 145 m) et du Monte Corona (2 144 m) sont sur le territoire de la commune, de même que le vallon du Marzulinu. Elle comprenait même au XIXe siècle Galeria, la vallée du Fangu, Mansu et Moncale. La ville s'est développée autour du quartier de Torra. A l'extrême-nord-est, au milieu des oliviers, Santa Restituta abrite une châsse renfermant les reliques, un magnifique baptistère et une statue en bois polychrome de la "Santa".
Dans le village, la pro-cathédrale San Biasgiu a été construite entre 1691 et 1714.
Pieve de Sant'Andria
I Catteri (Cateri)
Cerné d'oliviers et de cultures en terrasses, Cateri (en corse, I Cateri signifie littéralement "les portails") présente des ruelles pavées et des passages voûtés. Son église Santa Maria Assunta (XVIIe siècle) dite aussi Notre-Dame des Anges, est assez originale : elle est dotée d'un clocher absidial à arcades unique en Corse et d'une haute coupole hexagonale surmontée d'un lanternon. Il semble que ce soit à partir des plans de la cathédrale Saint-Pierre de Rome qu’elle a été construite. On peut y voir deux tableaux du XVIIe siècle particulièrement remarquables.Avapessa
Avapessa, un village riche de ses terres
Par: Manon Reinhardt
Publié le: 16 août 2021
Dans: Corse Matin
Situé en Haute-Balagne et au cœur de la plaine de Reginu, Avapessa est un petit village qui s'étend sur 330 hectares. Ce sont 80 habitants qui y vivent toute l'année.
Entre terre et mer, ce lieu que l'on appelait autrefois Acqua Spessa abrite de nombreux secrets. En effet, le village s'est construit sur une vaste oliveraie séculaire.
Au rythme des siècles, la tradition de l'oléiculture a toujours été ancrée dans les gènes de cette commune rurale qui s'est dotée d'un moulin moderne. Fort de son huile d'olive produite sur place, Avapessa est en vérité un immense paradis vert. L'élevage ovin y est aussi tout aussi important.
Et ce village balanin offre encore bien des merveilles. Sur trois hectares de terrain, locaux comme touristes peuvent explorer le jardin botanique de Robert Kran.
Passionné par les arbres fruitiers, il propose des visites guidées, des stages d'apprentissage autour de la conservation et traitement des agrumes ainsi que des formations sur les méthodes de culture. Il s'agit d'une véritable expérience sensorielle.
La gourmandise reste le maître-mot. Ce jardinier dont la recherche a duré de nombreuses années souhaite transmettre, dans le respect de l'écosystème, le plaisir de récupérer les fruits directement sur leurs arbres. Une culture traditionnelle qui constitue une grande richesse pour ce petit village.
Dans les années 1970, Avapessa s'est lancé le défi de la modernisation. L'objectif était de mettre en place une politique de tourisme vert afin d'attirer les visiteurs.
C'est alors que de nombreux établissements ont fait leur apparition au sein de la commune. Gîtes ruraux, restaurant communal, camping à la ferme, le village offre désormais une belle attractivité.
Le clocher de l'église paroissiale Santa Maria qui surplombe les habitations fait également grandement partie de son patrimoine rural. Ses olives et ses parfums de nature demeurent cependant ses principaux atouts.
Nesce (Nessa)
Aux portes de la haute Balagne, entre châtaigniers et oliviers à Nessa
Par: Manon Reinhardt
Publié le: 20 août 2021
Dans: Corse Matin

Situé dans la vallée du Reginu et à la frontière du Parc naturel régional de la Corse, Nessa est un village discret mais riche de ses charmes. Il fait partie des 19 communes du canton de Belgodère, dans l'ancienne pieve de Santo Andrea. Un petit coin de paradis où le tourisme n'est pourtant pas très important. C'est dans un paysage à couper le souffle que la commune a été construite, entre châtaigniers et oliviers, à 350 mètres d'altitude.
Une centaine d'habitants y vivent à l'année et rendent ce village convivial.
Ici, les locaux se retrouvent quotidiennement dans les endroits emblématiques comme l'église paroissiale Saint-Joseph et apportent une grande harmonie. Avec son hameau surplombé par les sommets, Nessa est un lieu typique de la Corse. établi au creux du versant, le village compte parmi ses voisins les communes de Speloncato et de Feliceto.
Au cœur du site, des ruelles pittoresques ornées de pavés. Nessa a la particularité d'abriter certaines maisons où les roches sont toujours apparentes. Un lieu idéal pour trouver quiétude et tranquillité. De nombreux parcours de randonnée pédestre démarrent et passent dans cette commune où la végétalisation est généreuse. Notamment, les amateurs de marche peuvent réaliser une grande boucle jusqu'à Pioggiola, dans le Guissani.
Nessa porte également un petit bout de l'histoire insulaire. Don Gregorio Salvini, historien et l'un des pères fondateurs de l'Université de Corse, est né dans ce village en 1696. Auteur du livre La Giustificazione delle Rivoluzione di Corsica, il est devenu par la suite le mentor de Pascal Paoli. Sa tombe se trouve au pied de l'église du village.
Cette commune balanine s'impose comme un véritable havre de paix.
Pieve d'Aregnu
Aregnu (Aregno)
Le village d'Aregnu (570 hab., 930 ha), 12 km au SO de L'île-Rousse. est surtout réputé pour son église classée de la Trinité, polychrome et ornée de fresques et de sculptures, à toit de lauzes (teghje), ainsi que pour ses vergers d'orangers et de citronniers, et pour ses amandiers (foire annuelle).
Curbara (Corbara)
Curbara est l'une des cinq communes du canton de L'île-Rousse ou bassin de vie de L'île-Rousse qui comprend les autres communes de L'île-Rousse, Corbara, Monticello, Pigna, et Santa-Reparata-di-Balagna.
Curbara faisait partie de la piève d'Aregnu devenue pieve de Sant'Angelo jusqu'à la Révolution puis fut le chef-lieu du canton d'Ile-Rousse de 1789 à 1828.
Lavatoghju (Lavatoggio)
Le village est bâti sous le col de Salvi (509 m) qui le sépare de la commune de Montegrosso. Il est aujourd’hui, avec son hameau de Croce, résolument tourné vers la plaine d’Aregno, alors qu’à l’origine, les premières constructions se sont développées sur le mont Bracaghju, surveillant la plaine de la Figarella (pieve di u pinu) et dominant le fertile plateau de la Stella.
L’existence du village de (Lavatoio) Lavatoghju est attestée dès le XVe siècle. Il fait partie de la pieve d’Aregno.
A voir : le lavoir sous l'église, la chapelle San-Cervone, édifice roman situé au cimetière, originellement village médiéval disparu, l'église paroissiale Saint-Laurent, située au coeur du village ou encore la chapelle Notre-Dame de la Stella, au pied du mont Bracaghju, à la croisée des chemins entre Occi, Lumio et Lavatoggio. Les bases du château du seigneur de Bracaghju, perché à 556 mètres d'altitude, sont toujours visibles.
Lumiu (Lumio) et Oggi (Occi)
Ce beau
village, situé à mi-chemin entre L 'ile Rousse et Calvi,
surplombe la baie de Calvi.
Il s'étale en belvédère face
au golfe de Calvi, avec ses maisons à arcades et ses ruelles abruptes et voûtées.
Au centre du village,à l'extrémité‚ d'une place surplombant la route
nationale, s'élève l'Eglise St Antoine construite en 1590. Devenue trop petite pour
abriter la paroisse, elle fut transformée en
confrérie.
Une nouvelle église fut construite par les villageois eux-mêmes: l'Eglise paroissiale Ste Marie.
D'un baroque dépouillé, elle date de 1800. L'actuel clocher en pierres de taille, haut de 36m, date de 1880.
Santa Reparata (Santa Riparata di Balagna)
Santa-Reparata-di-Balagna est l’un des plus grands villages de Balagne. Il est situé un peu au-dessus de L’Île-Rousse et offre un magnifique panorama sur la côte ainsi que sur les
montagnes en toile de fond.
Depuis le XIXe siècle, la commune ne possède plus de façade maritime, celle-ci ayant été cédée à la commune de L'Île-Rousse pour sa création en 1825.
Santa Reparata est séparée de sa voisine Corbara à l'ouest par un petit chaînon montagneux dont le plus haut sommet est Cima Sant'Angelo (562 m - Corbara) et à l'est, de Monticello
par la colline de Sainte-Suzanne (337 m - Monticello).
Au sud, son territoire occupe une infime partie de la plaine du Regino jusqu'au lac de Codole qu'elle partage avec Feliceto et Speloncato et dont elle possède la majeure partie.
La commune est centrée autour de l'église paroissiale Santa Reparata, située à une altitude de 267 mètres, et comprend les hameaux de :
U Poghju, le plus important de la commune, à proximité de l'église paroissiale ;
Alzia, à l'ouest de Poggio, le plus haut de la commune à 330 mètres d'altitude et où se trouvent deux des trois réservoirs en eau de la commune ;
San Bernardinu à l'est et en contrebas du Poghju, composé de quelques maisons et la chapelle San Bernardinu sur la route de Monticellu. S'y trouve le troisième réservoir en eau du village ;
Palmentu, situé à 500 mètres au nord-ouest du Poghju ;
Occiglioni, groupé autour de l'église San Roccu, au nord de Palmentu ;
I Palazzi, hameau de construction récente situé en plaine.
Poghju
Le hameau du Poghju est bâti à 267 mètres d'altitude, sur une arête montagneuse orientée d'est en ouest.
Il est entouré d'oliviers. Le bas du hameau se situe au carrefour des routes D 13 et D 263 où se trouve l'église paroissiale Santa-Réparate.
Les habitations aux murs enduits, aux façades austères et aux toits recouverts de tuiles rouges, sont alignées sur la crête, jusqu'au hameau de San Bernardinu. Il domine le hameau de Palmento.
Palmento
Hameau situé au nord-ouest, entre le village et Occiglioni, en contrebas de ceux-ci, sur la route D 263.
Son nom vient des anciens pressoirs à vin qui y étaient installés et qui par la suite, ont été remplacés par des fabriques d'huile.
Une dernière de ces fabriques est visible dans une maison ruinée près de la chapelle de A Nunziata située en bordure de route.
Palmentu est un antique hameau composé de quelques maisons de maître et d'habitations enserrées autour d'une remarquable tour médiévale ruinée, millénaire selon les dires.
On y circule à pied dans des venelles, sous de remarquables et longs passages voûtés.
Au numéro 16, sur le linteau de granit au-dessus de la porte est gravé « 1797 ». Un peu plus loin, est une fontaine traditionnelle.
Occiglioni.
Hameau situé au nord-ouest de la commune, sur la route D 263.
Autrefois un village, il aurait été construit à l'emplacement de l'ancienne cité d'Agilla selon les historiens locaux.
Le bâti est ancien, les maisons groupées autour de l'église paroissiale San Roccu et de son étroite placette.
On y circule difficilement en automobile dans des ruelles étroites et pavées, avec des passages sous voûte. Sur le linteau de granit au-dessus d'une porte est gravé « 1825 ».
L'Isula (Île-Rousse)
L'Île-Rousse: les îles de la Pietra regorgent de trésors historiques
Par: Stéphane Pergola
Publié le: 22 octobre 2022
Dans: Société / Patrimoine
Lorsque les promeneurs se baladent sur les îles de la Pietra, à L'Île-Rousse, ils n'imaginent peut-être pas les trésors historiques qu'elles renferment. Depuis les différentes campagnes de fouilles archéologiques des années 1980 à nos jours, le passé préhistorique se précise hautement grâce aux travaux initiés par Michel-Claude Weiss. Avant d'arriver sur ce site, longeant la route, les plus anciens pourraient se souvenir de la bâtisse du poids public.
Elle se trouvait à l'entrée de L'Isula Grande, île de la Pietra, entre les actuels Brasserie du Port et Hôtel de la Pietra. Elle fut construite à la fin du XIXe siècle par les Ponts et chaussées et détruite vers 1960. C'était une maisonnette de forme carrée qui disposait à l'arrière d'une petite dépendance. Au pied de la façade principale se trouvait le pont-bascule dont l'usage était essentiellement agricole : pesée des charrettes de foin, paille, etc.

La maison Santini
Sur l'îlot de Saletta, le premier en venant de la ville, une des trois redoutes génoises, celle à l'est, a servi de base à la construction à la fin du XIXe siècle d'une maison. Il s'agit de celle de Giovan Simone Santini, capitaine de port, originaire de Canari, dont le descendant direct est notre concitoyen Gérard Martinetti, agent immobilier à la retraite. Par la suite, cette bâtisse est devenue le restaurant l'Abri des Flots.
Le port et la tour
En continuant notre parcours, notre regard s'arrête au pied de la tour génoise où se trouve de nos jours un parking au bord de l'eau. Autrefois, les blocs de porphyre extraits de ce site à partir de 1840 ont servi à construire les fondations de la jetée de la Punta Tonnina. Celle-ci constituait le premier quai du port de la cité paoline.

Illustrations © Service historique de la Défense - cote 24 S 3
La tour a été construite en 1531 selon les recommandations et le suivi du commissaire génois Sebastiano Doria. Elle était gardée par deux soldats qui étaient payés en pain par les habitants de Santa Reparata, Monticello et Corbara. à l'est de cette tour, se trouvait une batterie dont le mur d'enceinte avait une forme quasi-stellaire. Les vestiges de celle-ci étaient encore attestés en 1873 sur le cadastre napoléonien.
De forme ronde, haute d'environ douze mètres, la tour se divisait en deux parties : en bas, le lieu de vie avec une petite caserne extérieure et en haut, le poste de guet pour les gardiens. Sa porte d'entrée au sud a été bouchée. Projet commun de la municipalité de Pierre Pasquini et de la Drac, cette tour a été rénovée entre 1974 et 1977.
La chapelle
Située entre la tour et l'hôtel de la Pietra, plus aucun élément visible ne laisse penser que se dressait la chapelle de Sant'Agata. à l'époque pisane et génoise en Corse, cet édifice s'élevait sur l'île de la Pietra à l'est, alors territoire de Santa Reparata di Balagna. D'après l'étude de l'archéologue Geneviève Moracchini-Mazel, elle a été probablement construite au tout début du XIe siècle. Elle se situait sur un replat en contrebas de la tour génoise. La nef de cet édifice mesurait huit mètres environ. Elle semble appartenir à l'abbaye de la Gorgone en Toscane, car en 1482 encore, elle était confirmée dans la propriété de la principale crique de pêche de l'Isola d'Oro et ses revenus reconnus au curé piévan de Santa Reparata, qui était déjà en 1095, propriété de la Gorgone. Elle disparaît probablement durant le XVIe siècle quand les Génois occupent militairement les îles.
La villa Gregorj
Nous voici maintenant devant l'hôtel de la Pietra inauguré en 1960. En 1840, à la place de cet hôtel, les services des Ponts et Chaussées avaient bâti un grand logement pour les ouvriers qui ont construit le port de L'île-Rousse. Grande bâtisse acquise vers 1856 par les frères banquiers Gregorj, Louis, Vincent et Jacques qui la transforment en villa. Les banquiers possèdent cet îlot et celui de Saletta. Ils sont propriétaires également d'un terrain de neuf hectares et demi situé sous le sémaphore à Fornole. Ces propriétés appartiennent par succession à leur descendante directe Jeanne Gregorj (1899-1998) épouse de Jean Glaenzer (1897-1969), très riche négociant en art. Le couple Glaenzer n'eut pas d'enfant, mais sa fortune a été léguée à quelqu'un qui ne fait pas partie du cercle familial : Christophe Dalmasso. Fin tragique pour ce dernier car il fut assassiné mystérieusement en 2003.
La villa Gregorj devient en 1884 un lazaret pour les malades du choléra puis en 1893, la fromagerie de Louis Rigal. Elle fut rasée en 1958 par la SETCO afin de construire l'hôtel.
La douane
Par ailleurs, il faut signaler que l'administration douanière avait installé, au pied du phare, dans l'anse de Funtanaccia, un poste abri à la fin du Second Empire. Si la douane se trouvait dans la vieille ville, il fallait bâtir un poste abri dans cette anse, qui forme un port naturel, afin de surveiller l'entrée du port.
Devant cette maisonnette, une cale de débarquement fut aménagée.
Le phare
Sur l'emplacement du phare, une redoute génoise ruinée est indiquée sur les cartes du XVIIIe siècle. En 1854, les Ponts et Chaussées établissent le projet de l'établissement d'un phare sur le point culminant de l'île de la Pietra sur les vestiges militaires. Le phare est construit entre 1855 et 1857 à partir des plans de l'architecte Léonce Reynaud. C'est par un ancien chemin au milieu des rochers, désormais goudronné qu'on accède à l'édifice. Il culmine à soixante-quatre mètres au-dessus du niveau de la mer. Le phare a permis d'éclairer le port afin que puissent accoster, de nuit, les bateaux qui auparavant mouillaient au large et attendaient le lever du jour pour entrer dans le port.
Depuis 2010, les îles appartiennent au Conservatoire du Littoral qui est en train de les aménager pour notre plus grande satisfaction de les voir préserver. Par ailleurs, le service des archives historiques de la Défense a inauguré en 2006 le fonds de Maurice Rollet de l'Isle, ingénieur hydrographe de la Marine, dont des magnifiques dessins représentent L'île-Rousse en 1890 et 1891. Ces illustrations historiques sont reproduites ici. Bien des pages restent à écrire sur les îles de la cité paoline.
Algajola (Algaiola)
Algajola serait bâtie sur les fondations de la cité phénicienne d'Argha.
Ancienne résidence des gouverneurs génois de Calvi, Algajola fut prise par les Turcs en 1643.
Les génois fortifièrent la ville en 1664. On peut encore voir les vestiges de la citadelle et du château-fort.
Pigna
Pigna, en corse, signifie "meule de blé", souvenir de l'époque génoise où la Balagne était une riche région agricole. Le village fut édifié par Consalvo Romano en l'an 816. Au début du XVIIIe siècle, Pigna faisait partie des seize villages qui composaient la pieve d'Aregno. Après avoir suivi le déclin du monde rural, Pigna, dans les années 60, a relevé le défi de la vie. C'est de ce petit village aux volets bleus qu'a démarré, en 1964, la Corsicada, association coopérative qui a entrepris non seulement de redonner vie aux métiers d'autrefois, mais aussi d'innover en matière artisanale. Pigna abrite une communauté d'artisans et de musiciens et compte un berger, trois agriculteurs, un potier, un graveur, un taille-doucier, un maçon, un luthier, un flûtier, un fabricant de vins arômatiques, une boutique d'artisanat et agro-alimentaire, plusieurs chambres d'hôtes, cinq restaurants, deux auberges, et l'on y dénombre aujourd'hui plus d'enfants que de vieillards.
Le village a été entièrement restauré selon les techniques anciennes que les maçons se sont réappropriées : terre glaise alliée au tuf.
Sant'Antoninu
Culminant à 500 m d'altitude, au coeur de la Balagne, ce village en nid d'aigle à proximité d'île-Rousse et de Calvi, est curieux par son site de crête et son plan à peu près circulaire.
Le village domine la plaine d'Aregno d'un côté, une partie de celle du Reginu de l'autre. Il est composé de 75 demeures environ, soudées les unes aux autres, et qui s'enroulent autour d'un piton granitique formant un embryon de labyrinthe pour mieux résister à l'éventuel envahisseur. De par sa position, on dit qu'il est visible de toute part en Balagne.
Ce fut l'un des fiefs de la famille des Savelli, comtes de Balagne qui abritaient, dans leur forteresse, la population lorsque les voiles barbaresques pointaient à l'horizon. La mer n'est qu'à 3 km à vol d'oiseau.
Montegrossu
Montegrossu regroupe depuis 1972 les villages de Montemaiò, Lugignani et Cassani.
Le lieu était déjà habité sous l'Antiquité. Il est cité par Ptolémée et on a retrouvé une nécropole du IVème siècle près de Lunghignano.
Montemaiò (Montemaggiore)
Ce village et sa belle église se voient de loin, avec en fond le Monte Grosso. L'église baroque Sant'Agustinu renferme un admirable maître-autel en marbres polychromes surmontée d'une Immaculée Conception et d'un superbe tableau : La Vierge et l'Enfant remettant la couronne de roses à Santa Catarina et à San Dumenicu.Mérimée évoque dans "Les Ames du Purgatoire" un Don Juan de Magnara né à Séville fils d'un Calvais et d'une habitante de Montemaiò...
Il aurait appartenu à la famille de Leca, qui descendrait d'Ugo Colonna.
Non loin du village se trouve l'église St Rainier datée du XIIème siècle. Les ornements de sa façade sont un mystère car sans lien avec l'iconographie religieuse de l'époque. Un peu plus loin, au lieu-dit San Martino, on peut voir les ruines d'une nécopole et d'une chapelle pisane.
Lugignani (Lunghignano)
A mi-pente du Capu di Bestia (804 m), ce village moyenâgeux est entouré d'oliviers. Son église San Vitu date du XVIIIe siècle. Entre le village et Montemaiò, on trouve l'église San Ranieru de style pisan.Cassano (Cassani)
Sur un promontoire à 300 m d'altitude, Cassano était une commune à part entière disposant d'un territoire de 3 km² avant sa fusion en 1972 avec Montemaiò et Lunghignanu.
Le village constitue aujourd'hui l'un des 3 hameaux de la commune de Montegrosso.
Au XIXème siècle, les 500 habitants (on en compte aujourd'hui seulement une centaine) vivaient d'élevage, d'artisanat et d'agriculture (céréales, vin et huile d'olives).
La particularité de Cassano, provient de l'architecture de sa place en forme d'étoile qui dessert toutes les ruelles du village.
Autour de cette place si particulière, on peut admirer de grandes, imposantes et anciennes bâtisses dotées de porches.
L’église de l’Annonciation (Santa Maria Annunziata), datée du XVIIéme siècle et récemment restaurée, possède un clocher à étages.
Elle peut sembler banale et sans intérêt de prime abord, si on se limite à admirer la façade. Pourtant, l’intérieur est d’une rare beauté.
Riche en mobilier religieux et précieux, l’église met en avant un patrimoine intéressant qui vaut le coup d’œil.
Ne manquez pas le triptyque du XVIe siècle, à l’origine exposé dans la chapelle Saint-Alban, dans le cimetière de Cassano.
Eglise Saint-Alban : située à 300 m. en contrebas du village, cet édifice transformé renferme une statue de Saint Alban (patron du village) fêté chaque année le 22 juin.
Jouxtant l'église paroissiale, la chapelle de la confrérie Saint-Antoine-Abbé est datée, d'après le linteau au dessus de sa porte, de 1651.
Elle loge actuellement la confrérie du village Saint Philippe Neri.
Pieve d'Ostriconi
Lama
Dominé par le monte Astu (1 535 m), Lama fut créé au XIIIe siècle mais s'est développé au 17e siècle par son immense oliveraie. Après le terrible incendie de 1971 qui ravagera 36 000 arbres souvent multi-centenaires, l'oliveraie renâit aujourd'hui. La particularité architecturale de Lam est le mariage réussi de deux styles différents : le centre médiéval, composé de maisons collées les unes aux autres et de ruelles étroites, et les grandes maisons bourgeoises des riches oléiculteurs. Mais Lama est surtout célèbre pour son tourisme rural de qualité et pour son festival du Film Européen.
Petralba (Pietralba)
Ce beau village de Balagne est dominé par la Cima di Grimaseta (1 509 m). Il est constitué de la réunion de U Pedanu et de U Tetu. A l'ouest de Pedanu (lieu-dit Corti) se trouve la chapelle de San Michele (12e siècle) d'où l'on a une vue magnifique sur la vallée du Canale.Pieve de Pinu
Muru (Muro)
Historiquement chef-lieu de la pieve de Sant'Andréa, Muro se trouve sur les contreforts nord du Monte Grosso, et fait partie des « villages balcons » de la vallée du Reginu.
Outre le village, Muro comporte deux hameaux : Poggiali et Murato.
Depuis 1973 Muro n'est plus chef-lieu d'un canton de 9 communes (Algajola, Aregno, Avapessa, Cateri, Feliceto, Lavatoggio, Muro, Nessa et Speloncato), mais l'une des 19 communes du canton de Belgodère.
L'église paroissiale de la Santissima Annunziata située au nord, domine le bourg. En face d'elle, de l'autre côté de la petite Piazza di a Ghjesgia, se trouve la confrérie.
De style baroque, elle a été construite au milieu du XVIIe siècle, puis reconstruite au XIXe siècle après l'effondrement de la coupole survenu le 4 mars 1778 pendant l'office des Cendres, faisant 60 morts.
Son plan en croix latine avec nef unique s'inspirerait de l'Annunziata de Gênes. Les dimensions sont imposantes : 31 mètres de long, 12,5 mètres de large, 22 mètres de haut pour la façade, 25 pour le clocher.
La façade est exceptionnelle : sa hauteur est soulignée par des fausses colonnades et plusieurs corniches peintes en blanc tranchant sur le fond rose de l'ensemble. Elle est décorée de plusieurs statues. Au-dessus de la porte d'entrée, dans des niches à fond bleu, un Sacré-Cœur entouré de Marie et Joseph ; plus haut, encadrant une verrière de l'Annonciation, les saints patrons de la paroisse Jean l'évangéliste et Jacques le majeur ; plus haut encore et à l'extérieur du volume principal, les saints apôtres Pierre et Paul ; tout en haut, sous un fronton triangulaire, une colombe rayonnante est sculptée en bas-relief.
L'intérieur est richement décoré dans le style baroque : dorures, nombreux tableaux dans les chapelles latérales dont une Annonciation du XVIIe siècle, peintures en trompe-l'œil sur la voûte de la coupole, autel et chaire en marbre blanc, colonnes torses autour des autels secondaires, etc.
L'orgue daté de 1796, commandé par Tommaso Pagnini, prêtre et facteur d'orgue de Lucca (Italie), a été restauré à l'identique en 1982 par J-F Muno.
L'édifice est non classé, mais renferme toutefois des œuvres remarquables.
Fulicetu, U Fulgetu (Feliceto)
Coincé entre le barrage de Codole et les sommets du San Parteu (1 680 m) et la cima di a Forca (1 622 m), Feliceto est composé de plusieurs quartiers : Corti, Paese, Torre, E Strambulacce et Pinu. Sur la hauteur, a Falcunaghja et la "maison du bandit".
Ziglia (Zilia)
Cette commune de près de 200 habitants en comptait plus de 700 au milieu du XIXe siècle.
A l'époque, l'agriculture (céréales, oliviers, châtaigniers) et l'élevage dominaient.
Aujourd'hui, c'est essentiellement la viticulture avec le domaine d'Alzipratu et la source thermale fermée depuis plus d’un siècle, mais l’eau de Zilia est puisée à plus de 80 mètres de profondeur.
Cette eau est aujourd’hui reconnue comme produit alimentaire de montagne en raison de sa qualité constante et son insensibilité aux variations météorologiques.
On la trouve sur toutes les tables de Corse, que ce soit en eau plate ou gazeuse.
Le village est composé des quartiers de Case Suprana et d'Aghja Vecchja.
Pieve de Tuani
Belgudè (Belgodère)
Entouré par les communes de Occhiatana, Palasca et Olmi-Cappella, Belgodère est situé à 38 km au Sud-Ouest de Bastia, la plus grande ville à proximité.
La commune de Belgodère (Belgudè en Corse) s'étend sur 13 km² et compte 487 habitants.
Le ruisseau de Cava marque la limite avec Olmi-Cappella, juste au sud des ruines de la chapelle San Antonio à 803 m d'altitude.
Belgodère est un balcon sur la vallée du Regino, du nom du petit fleuve côtier qui l'arrose et qui a son embouchure au pied de la tour de Lozari. Sur son cours, un barrage de retenue d'eau, le lac de Codole, que se partagent les communes de Feliceto, Santa-Reparata-di-Balagna et Speloncato, permet de satisfaire les besoins en eau des agglomérations en période estivale.
Pieve de Canale
Palasca
Palasca est situé à 2 km à l'Est de Belgodère. Avec Lama, Urtaca, Pietralba et Novella, c'est l'une des cinq communes de la vallée de l'Ostriconi. Le village actuel est construit au creux de la montagne, à une altitude moyenne de 400 mètres, avec des maisons de caractère. Sa population longtemps regroupée au village même, se répartit aujourd'hui dans les hameaux de Lozari et de l'Ostriconi qui se développent rapidement en raison d'un tourisme sans cesse croissant.
Jadis, existait le village E Spelonche avec la chapelle San Giusto delle Spelonche à environ 6 km au Nord-ouest du village. Il a probablement été déserté au XVIe siècle en raison de l'épidémie de peste qui a ravagé l'île. De nos jours il n'en reste que des vestiges.
A Costa (Costa)
Costa est située en Balagne, dans l'ancienne pieve de Tuani. Elle se trouve dans le canton de Belgodère enclavée entre deux communes : Ville-di-Paraso et Occhiatana.
Son territoire est une bande de terre qui s'étend sur le flanc septentrional du Monte Negrone (1 175 m), à l'est de la chaîne de montagnes parmi les plus hautes de Corse ceinturant la Balagne et qui est aussi la limite septentrionale du Parc naturel régional de Corse.
Ville di Paraso (E Ville di Parasu)
Occhiatana
Spiluncatu (Speloncato)
Speloncato est une commune de Balagne, l'une des dix-neuf communes du Canton de Belgodère, adhérente à la Communauté de communes di E Cinque Pieve di Balagna, en limite du Parc naturel régional de Corse.
La commune s'étage sur près de 1 300 m de dénivelée, depuis la plaine du Reginu au nord, jusqu'au Monte Tolu au sud, lui conférant une orientation générale nord.
La chaine du Monte Tolu marque la limite du Parc naturel régional de Corse à l'intérieur duquel se trouve la vallée voisine du Giunssani. En amont du hameau de Reginu, le fleuve Reginu est barré par la retenue d'eau de Codole, une réserve d'eau de plus de 6 millions de m³ destinés à l'irrigation agricole et à l'approvisionnement domestique en saison estivale. Seule la partie orientale du barrage appartient à la commune, la partie Sud appartenant à Feliceto et le reste à Santa-Reparata-di-Balagna.
Article détaillé : Lac de Codole.

Caccia-Ghjunsani
Le Caccia-Ghjunsani est composé des huit communes suivantes :
- Asco (Ascu)
- Castifao (Castifau)
- Moltifao (Moltifau)
- Mausoléo (U Musuleu)
- Olmi-Cappella (Olmi e Cappella)
- Pioggiola (Pioggiula)
- Popolasca (Pulasca)
- Vallica (A Vallica)
Pieve du Ghjussani
Mausoleo
Mausoleo est un village très ancien. Il aurait été fondé par une tribu ibérique au IIéme siècle avant notre ère. Le village actuel date de la fin du XIVème siècle.
En son centre, sur le mont Cima, un énorme monolithe se trouve en équilibre.
Olmi è Cappella (Olmi-Cappella)
Ces petits ponts génois cachés dans le maquis de Balagne
Par J.-F.P.
Publié le 16/07/22 dans Corse Matin

J.-F.P.
La température diminue avec l'altitude et, au moment de partir en randonnée, quelques degrés de moins font toute la différence. Pour fuir la chaleur et découvrir un patrimoine vernaculaire très bien conservé, le Ghjunsani est la destination idéale. Cette haute vallée de l'arrière-pays balanin, perchée à une altitude moyenne de 800 mètres, possède des chemins balisés et entretenus.
Sous les villages, il s'agit essentiellement d'anciens sentiers muletiers, reconnaissables à leur pavement, leurs murs de soutènement en pierre sèche et leur dénivelé modéré. D'un village à l'autre, ces autoroutes de jadis enjambent des ruisseaux et des rivières sur des vieux ponts voûtés, dits "génois". Des trésors d'une autre époque encore si bien conservés.

"Jusqu'aux alentours du XVIIe siècle, en période hivernale, les hautes eaux ne permettaient pas le franchissement des rivières du Giussani, contextualise un panneau d'information touristique, installé en bord de chemin. Les communications et échanges commerciaux s'en trouvaient considérablement perturbés. Aussi les populations demandèrent à l'autorité génoise de remédier à cet obstacle. À cette époque furent construits les ponts sur les rivières de Francioni et de Tartagine. Tous furent financés par les communautés villageoises. En conséquence, l'impôt de vingt sous, acquitté par chaque famille, fut augmenté temporairement pour permettre la réalisation de ces ouvrages."
Une boucle au départ de l'église d'Olmi

Quatre siècles après leur construction, ces ouvrages de pierre et de chaux sont nombreux dans la vallée. Parfois étroits, pour permettre aux mules de passer, parfois plus larges, pour s'y aventurer en charrette, ils rendent aujourd'hui service aux promeneurs. À eux seuls, ces ponts valent le détour.
"L'appellation de pont génois provient à la fois de leur technique de construction, une arche unique en forme de dos-d'âne, reposant sur deux culées et un tablier resserré, et par le fait qu'ils ont été bâtis sous domination génoise, poursuit le descriptif. Généralement installés au plus étroit du cours de la rivière, ces ponts sont remarquables par leur solidité et leur résistance aux crues. L'arche repose sur les rochers bordant les rives, ce qui évitait la coûteuse construction de piliers. La maçonnerie du pont est entièrement montée en pierres de granite local liées à la chaux. Les galets de rivière étaient utilisés pour le pavement du tablier."

Les accès sont multiples, pour rejoindre ces ponts, mais le plus commode est au départ de l'église d'Olmi. Un sentier en boucle, de 8 kilomètres pour 400 mètres de dénivelé, permet d'en emprunter plusieurs. Le chemin descend d'abord vers le hameau de Forcili, à Pioggiola, avant de poursuivre vers Mausoleu. Du village, redescendre vers la rivière pour l'enjamber et regagner le point de départ. Sur cette dernière portion, l'état de conservation des murs et du pavement est surprenant.
Pour la baignade, privilégiez les chemins menant à la Tartagine, rivière où affluent les différents ruisseaux. Sous Vallica, elle est assez accessible et offre les meilleurs spots pour se mettre à l'eau. Pour son altitude, sa forêt ombragée, ses chemins ancestraux, ses moulins en ruine, ses ponts inébranlables et ses vasques d'eau claire, le Ghjunsani vaut le détour.
Vallica (A Vallica)
Pieve de Caccia
Asco
Le village d'Ascu est resté enclavé jusqu'au milieu du XXème siècle : la route fut construite en 1937, celle menant aux gorges en 1968!
A la sortie du village on peut voir un pont génois situé sur l'ancienne route reliant la vallée au Niolu.
Castifau (Castifao)
Moltifau (Moltifao)
Castiglione
Ulasca (Popolasca)
Pedigrisgiu
U Pratu di Ghjuvellina

Falasorma
Le Falasorma (Filosorma) est constitué du golfe de Galéria, de la vallée du Fango et du littoral environnant, limité au nord par la Pointe de la Revellata et au sud par la presqu'île de Scandola.
Le Fango, petit fleuve côtier qui prend sa source sur le versant occidental du Capu Tafunatu, a un cours long de 24 km et un bassin versant de 235 km2.
Bien que situé sur le versant occidental de la chaîne centrale à l'endroit même où celle-ci est le plus élevé
(Punta Minuta, Paglia Orba), le Filosorma appartient à l'En-Decà-des-Monts (en corse Cismonte) et est administrativement rattaché à la Haute-Corse (et anciennement englobé dans la commune de Calenzana).
Le Filosorma possède une importante façade maritime quasiment inhabitée. Celle-ci s'étend depuis la baie de Nichiareto, qui marque la fin de la Balagne, jusqu'à la Scandola, aux confins des Deux-Sevi et du golfe de Porto. Le territoire du Filosorma va de l'altitude zéro (niveau de la mer) jusqu'aux 2 556 mètres de la Punta Minuta, point culminant de la région. La haute vallée du Fango, fermée par les reliefs de la chaîne centrale qui la séparent de la Caccia et du Niolo, compte de nombreux sommets parmi les plus hauts de l'île : outre la Punta Minuta, on compte aussi la Paglia Orba (2 525 mètres), le Capu Tafunatu (2 335 mètres), la Punta Missoghiu (2 201 mètres), la Muvrella (2 148 mètres), le Capu a e Ghiarghiole (2 105 mètres) et le Capu a u Ceppu (1 951 mètres).
Mansu


Liamone
Le Liamone occupe les vallées du fleuve éponyme (microrégions du Sorroinsu et de la Cinarca)et de ses principaux affluents : Grosso (microrégion du Sorroinsu) et Cruzzini (microrégion du Cruzini). Il culmine à la Maniccia (2 496 m) et a pour capitale Vico.Muna
Source : https://www.orizzonte.fr/corse/patrimoine/muna/
En Corse du Sud se cache un petit village qui fut progressivement abandonné suite à la première guerre mondiale. Situé à quelques km de Murzu et de Rosazia, il se reconnait à ses maisons de pierre construites en escalier sur la montagne de la Spusata. Déserté hors saison, il reprend vie en été, au passage des touristes venus retracer le passé. Empruntons ensemble la route menant au hameau de Muna.
Un lieu désert chargé de souvenirs
C’est à 50m d’altitude que repose le village de Muna dans la région de la Cinarca. Outre une vue panoramique unique, il offre un retour vers le passé et la possibilité de rendre hommage aux habitants disparus via une plaque commémorative installée sur le mur de l’Eglise. Car il faut savoir que Muna n’a pas toujours été inhabité : avant sa complète désertion, le hameau vivait en totale autonomie grâce à ses nombreuses ressources (oliviers, troupeaux d’ovins, châtaigniers, arbres à pains…) et l’exploitation forestière. Le bois, exporté ensuite via le fleuve du Liamone, servait, entre autres, à la fabrication de mâts de bateaux.
Mais c’était sans compter sur la guerre de 14-18 qui allait causer la mort de milliers de soldats insulaires, laissant seuls de nombreuses femmes et enfants. De plus en plus silencieux, Muna commença à s’éteindre petit à petit jusqu’en 1974 où le dernier habitant décida finalement de quitter les lieux, dès lors, sans vie.
Toutefois, si vous passez un jour par Muna, n’hésitez pas à tendre légèrement l’oreille : vous entendrez sûrement les murmures des femmes s’affairant à leurs tâches quotidiennes ou les rires des enfants courant dans les ruelles étroites. Et ce, grâce aux pierres, gardiennes de l’histoire.
La fin de l’isolement ?
Aujourd’hui, Muna reste un village désert durant l’hiver mais se voit renaître à l’arrivée des beaux jours. Des travaux ont effectivement été réalisés afin de transformer de vieilles maisons en gîtes ruraux pouvant accueillir les touristes mais aussi les descendants de ceux qui ont, un jour, vécu ici. Pour favoriser la seconde vie de Muna, la commune a fait en sorte que certaines habitations disposent de l’eau courante.
Muna enveloppe ainsi ses visiteurs d’un présent côtoyant respectueusement le passé : les vestiges des pavés, les maisons typiques corses, le four à pain, l’ancien moulin ou encore l’église datant du 17e siècle sont autant de trésors que les Corses, fiers de l’héritage de leurs ancêtres, ont choisi de préserver.
Comment s’y rendre ?
Autrefois, le petit village de Muna n’était accessible que par un sentier muletier. Abrupt et accidenté, ce dernier flirtait avec le torrent du Liamone sur 12 km, se révélant alors extrêmement dangereux. De quoi décourager les éventuels visiteurs… Mais des personnalités comme le chanteur Antoine Ciosi ont permis de faire bouger les choses et d’éviter que Muna ne reste abandonné à jamais. En 1987, le sentier muletier s’est alors vu remplacé par une route départementale goudronnée, pour plus de sécurité.
Il vous faudra donc prendre la D81 jusqu’à Sagone puis la D70 en direction de Vico. Une fois arrivé(e) au village de Vico, vous emprunterez la D23 qui mène à Murzo. Au niveau de l’église, vous tournerez à droite pour vous rendre à Muna. Sur la D4, vous aurez le privilège de passer par Bocca a Verghiu, une route quelque peu étroite et qui longe sur 7 km les gorges du Liamone. Paysages magnifiques et sensations incroyables sont garantis au milieu des falaises vertigineuses !
Après toutes ces aventures, il ne vous restera plus qu’à vous garer sur un petit parking situé sur la gauche au niveau des boîtes aux lettres et à lacer vos chaussures de marche pour faire revivre Muna le temps d’une promenade…
Image en Une : Pierre Bona

Bagnaghja
La Bagnaghja correspond, du nord au sud, au territoire des anciennes pièves de Lota, Orto, Marana et Costera, soit l'ancien fief des seigneurs de Bagnaia.
Elle comprend les communautés suivantes :
Lota- Santa-Maria-di-Lota
- San-Martino-di-Lota
- Ville-di-Pietrabugno
- Cardo
- Bastia
- Furiani
- Biguglia
- Borgo
- Lucciana
- Vignale
- Scolca
- Volpajola
- Campitello
- Bigorno
- Lento
Les habitants de la Bagnaja sont les Bagnaninchi.
La documentation écrite révèle l'existence, dès la fin du XIe siècle, d'un grand nombre d'édifices de culte privés, aux mains des riches propriétaires terriens et notamment des familles de Pino, de Bagnaia, de Justignani ainsi que des Massa.
Au tout début du XIIe siècle, deux grands lignages sont implantés dans la Marana : les Aschesi de Furiani, qui n'ont pas connu la gloire et la puissance, et les Bagnaia qui, « en 1247, exercent le contrôle de la région qui englobe la basse vallée du Golo et toute la zone délimitée par le Golo, la mer, la crique de Lavasina et la chaîne montagneuse de Stella ».
Le lignage des Bagnaia a sa souche dans l'habitat de Bagnaia, juché sur un immense éperon qui surplombe la vieille cité de Mariana et sa cathédrale : le Borgo Bagnaia, un centre résidentiel constitué d'un palatium, de plusieurs tours et de maisons, mais n'est à aucun moment qualifié de castrum.
En 1358, une partie de la population de l'île se soulève contre l'oppression des grandes familles seigneuriales. Ce mouvement aboutit rapidement à la destruction des châteaux, symboles du pouvoir sur les hommes, et à la dédition officielle de l'île à Gênes. C'est dans ce contexte que naît, dans la moitié nord de l'île, la Terra di u Cumunu ou Commune de Corse.
Pieve d'Ortu
Bastia
Préfecture de la Haute-Corse, Bastia est la deuxième commune de Corse en nombre d'habitants (44 355 habitants en 2015).
Depuis 2000, Bastia possède le label « Ville d'Art et d'Histoire ».
Organisée sur un axe nord-sud relativement étroit, au flanc de la Serra di Pigno, Bastia s'est développée le long de sa façade maritime.
Le Vieux-Port, qui offre une bonne protection naturelle contre les aléas météorologiques de la Méditerranée, a été au cœur du développement initial de la ville (Terra Vecchia) qui n'était à l'origine que la marine de Cardo. La partie haute, « Terra Nova », enserre la citadelle génoise ( « bastiglia ») qui est à l'origine du nom de la ville.
Pieve de Petrabugnu
Ville di Petrabugnu
Pieve de Marana
Furiani
Biguglia
Borgo
Lucciana
Vignale
Pieve de Bigornu
Canavaggia
Bigorno
Campitello
Lento
Scolca
Volpajola
Pieve de Casacconi
Crocicchia
Campile
Olmo
Monte
Prunelli di Casacconi
Penta Acquatella

Capicorsu (Cap Corse)
Pieve de Lota
Santa Maria di Lota
San Martino di Lota
Erbalunga (Erbalonga)
Ce petit village pittoresque, dépendant de la commune de Brando, a été le plus important port de l'île. Il est formé des quartiers de Poggiolo et de Curcianella au sud, de Foce et Sicolu au nord. à l'entrée de la marine se dresse la tour d'Erbalunga, partiellement ruinée et reconstruite à la fin du XVIe siècle. L'église Saint-érasme (saint patron des marins) du XVIIe siècle s'orne d'une façade baroque. La marine abrite également la chapelle du cimetière Madona del Carmine.
Au nord d'Erbalunga, au quartier de Cintolinu, se trouve le monastère des Bénédictines de l'Adoration perpétuelle du Très Saint Sacrement, datant de 1862, avec une église dédiée au Cœur Eucharistique de Jésus. Plus au nord, sur une éminence (201 m) au sud de la tour ruinée de Sagro, la forteresse historique de Tesoro (dite parfois Tresoro) dresse ses murs d'enceinte et ses longues lignes de pierre. .













Pieve de Brandu
Brando
Pietracorbara
Siscu (Sisco)
Sisco occupe une une position stratégique sous le monte Cagnolo. Le panorama y est remarquable sur la mer Tyrrhénienne et les îles de Capraia et d'Elbe, les plus proches de l'archipel toscan. L'île d'Elbe est distante d'une cinquantaine de kilomètres de la côte siscaise.
On peut diviser la commune en trois parties : la Plaine avec la Marine, la Meziana ou partie médiane, et la Montagne.
Marine de Sisco
Il y a un siècle, le site était désert. C'est donc un village récent qui a été construit. Son développement est lié à l'attrait touristique, mais aussi aux facilités de communications avec Bastia. Le village est composé de plusieurs quartiers : Renaghjo, Cudicciu, Campu di a Pace, Molinacciu, Casaiola, Scale-Vecchiu. à un kilomètre au nord de la Marina, au-dessus de la D80, se dresse l'ancien couvent Sainte-Catherine fortifié du XIVe siècle. En contrebas de la route, existe la grotte de Bughjone d'une centaine de mètres de long, fréquentée par les chauves-souris.
La Mezania
La Mezania est la partie médiane de la vallée de Sisco. On y accède par la route D 32. Elle comporte successivement : Balba, jadis appelé Berba, Chioso, Casella, et Teghje.
Montagne de Sisco
En arrivant dans la partie montagneuse par la route D 32, on rencontre successivement :
Poggio (Poghju) qui marque l'entrée du « bourg de Sisco », avec l'imposante église Saint-Martin au haut clocher, récemment restaurée, dominée par le cimetière auquel on accède par un escalier monumental depuis la place de l'église. Formé de quelques « maisons d'américains », Poggio est un hameau situé entre la chapelle Santa Maria Maddalena du XVe siècle au sud-est et l'église Saint-Martin (XIIIe siècle, XVIe siècle) au nord-ouest.
Au nord de Poggio, depuis la place de l'église, la route D 32 se poursuit jusqu'au territoire de Pietracorbara en franchissant le col de Santa Reparata, mais s'y termine en cul-de-sac. De la D 32, au lieu-dit Contra - du nom d'un hameau disparu qui avait une tour carrée, démarre la piste qui permet de rejoindre Olcani par la bocca di San Giuvanni - du nom de la chapelle San Giuvanni Evangelista. Gravement ruiné, ce sanctuaire daterait du XVIe siècle.
Au lieu-dit Pietriconi, se situe la carrière San Michele. Au nord de la carrière, isolée sur un gros rocher noir de prasinites, se situe à flanc de montagne à 380 m d'altitude et à l'orée de la châtaigneraie, la remarquable chapelle romane San Michele du XIe siècle
On trouve encore plus haut Monacaja, vieux village médiéval doté d'une remarquable tour carrée et d'une belle « maison d'américain », Barrigioni, Cipronascu, Busseto, Assalaccia, et enfin Pietrapiana. Situé à 440 m d'altitude sur le flanc oriental du Pinzalone, il offre un vaste panorama sur la mer Tyrrhénienne et des îles de l'archipel toscan.
Pieve de Luri
Cagnano
Luri
Ancienne pieve religieuse du même nom, Luri a appartenu à des seigneuries de la fin du IXe siècle à la fin du XVIe siècle, avant de passer sous l'administration génoise jusqu'à la deuxième moitié du XVIIIe siècle, puis de devenir française.
Meria
Tomino
Ruglianu (Rogliano)
Rogliano, chef lieu historique du Cap Corse, appartient à l'ancienne piève de Luri .
Rogliano comporte plusieurs hameaux, la plupart très anciens, situés sur les hauteurs de la commune. Au Moyen âge, ces habitats étaient proches entre eux et comptaient rarement plus de dix feux.
Ersa
Ersa, dont l'ancien nom latin est Arsia, qui fait certainement référence à certaines crêtes et pentes rocheuses grillées par le soleil présentes sur la commune, regroupe quatre villages (Botticella, Granaggiolo, Cocinco et Poggio) et leurs hameaux (Piazza, Gualdo, Rota, Guadellu, Bonifacio), tous bâtis en piémont, ainsi que deux marines (Barcaggio et Tollare).
Centuri
Située sur la côte nord-ouest du Cap Corse, la commune de Centuri est bordée au nord et à l'est par plusieurs crêtes qui la séparent d'Ersa et Rogliano et formant une vaste vallée côtière.
Le petit port de pêche de Centuri est l'un des rares abris de la côte occidentale du Cap Corse.
Macinaghju (Macinaggio)
Macinaggio est la marine de Rogliano, située sur la pointe orientale du Cap Corse. C'est le premier port de plaisance du Cap Corse avec 585 anneaux, et le deuxième port de pêche après Centuri. Il fut l'un des ports les plus actifs de Corse au XIXe siècle.
Macinaghju se trouve en bordure d'un site Natura 2000 protégé et classé, comprenant les îles de Finocchiarola et le domaine de Capandula.





Morsiglia
Morsiglia est composée de 8 hameaux (quartiers ou lieux-dits) qui sont Mute, Stanti, Baragogna, Pecorile, Mucchieta, Posacce, Sundi et Pruno. Ce village abrite six tours carrées d'époque génoise, anciennes maisons d'habitations des patriciens, dont certaines ont été restaurées.
Pinu (Pino)
Comme dans la plupart des communes à l'ouest de la Serra, on retrouve à Pino le triptyque habituel village-marine-tour. Le village est bâti à flanc de montagne, à une altitude moyenne de 170 mètres.
Pino a compté jusqu'à 591 habitants en 1881. C'est à partir de cette date que bon nombre d'habitants sont partis aux Amériques, plus précisément au Costa Rica, au Venezuela et dans quelques îles des Caraïbes. C'est d'ailleurs l'argent envoyé par les expatriés qui ont permis la construction de bâtisses dites « maisons d'américains » et des nombreuses tombes qui jalonnent les routes de la commune.
Barrettali
La commune de Barrettali possède une façade maritime très déchiquetée et inhospitalière, allant du ravin de Mare Morto jusqu'à la Marine de Giottani, comprenant au nord les pointes Punta di Mare Morto et Punta di Stintinu et au sud un îlot nommé Rocher de Mogliarese. Cet îlot est dominé par la punta dell'Aculaia ou punta di Marchione (222 m d'altitude), couverte de figuiers de Barbarie et tombant à pic dans la mer.
Pieve de Canari
Canari
Cànari est composé de onze hameaux : Pieve, Vignale, Chine, Piazza, Marinca, Longa, Olmi, Pinzuta, Solaro, Ercuna et Imiza, tous accrochés aux pentes des vallées ouvertes sur la mer, ainsi que deux marines : Scala et Canelle.
Ogliastru (Ogliastro)
Le village actuel d'Ogliastro succède à deux anciens villages, Cocollu Supranu et Cocollu Suttanu, tous deux localisés au nord du village actuel.
Ogliastro a été construit beaucoup plus bas que les anciens puisqu'à 100 m d'altitude en moyenne seulement.
Pieve de Nonza
Nonza
Nonza est une petite commune de 8 km2 sur la côte occidentale du Cap Corse, entourée d'Ogliastro au nord, d'Olcani à l'est et d'Olmeta-du-Cap au sud. à l'ouest, la commune possède une façade maritime délimitée au sud par la tour de Negru (Olmeta-di-Capocorso) et au nord par l'église San Michele ruinée (Ogliastro). Toute la côte au nord du village de Nonza est constituée d'une immense plage de sable et de galets noirs issus des rejets d'exploitation de l'ancienne carrière d'amiante de Canari-Abro qui a été fermée en 1965.
Olcani
Olmeta di Capicorsu

Castagniccia
La Castagniccia est composée des territoires de cinq pièves pour un total de 50 communes :
- Casabianca ;
- Casalta ;
- Croce ;
- Ficaja ;
- Giocatojo ;
- Piano ;
- Poggio-Marinaccio ;
- Polveroso ;
- La Porta ;
- Pruno ;
- Quercitello ;
- San-Damiano ;
- San-Gavino-d'Ampugnani ;
- Scata ;
- Silvareccio.
- Campile ;
- Crocicchia ;
- Monte ;
- Olmo ;
- Ortiporio ;
- Penta-Acquatella ;
- Prunelli-di-Casacconi.
- Campana ;
- Carcheto-Brustico ;
- Carpineto ;
- Monacia-d'Orezza ;
- Nocario ;
- Parata ;
- Piazzole ;
- Piedicroce ;
- Piedipartino ;
- Pie-d'Orezza ;
- Rapaggio ;
- Stazzona ;
- Valle-d'Orezza ;
- Verdèse.
Pieve d'Alisgiani
La Pieve d'Alisgiani comprend les villages de L'Ortale, E Valle d'Alisgiani, Felge, Piupeta, I Piazzali, U Petricaghju, I Perelli et Novale.
Pieve d'Ampugnani
La Pieve d'Ampugnani comprend les villages de A Casabianca, A Casalta, Ghjucatoghju, A Croce, Ficaghja, A Porta, Ortiporiu, U Pianu, U Poghju Marinacciu, U Polverosu, Porri, U PrunuU Quercitellu, San Damianu, San Gavinu d'Ampugnani, et Scata.
Pieve d'Orezza
La Pieve d'Orezza regroupe les villages de Carpinetu, Carcheto-Brusticu, U Pedipartinu,Pe d'Orezza, Pedicroce, A Campana, Nucariu, A Monacia d'Orezza, A Parata, E Piazzole, Rapaghju, A Stazzona, E Valle d'Orezza et A Verdese.
Pieve de Rustinu
Valle di Rustinu
La création du village de Valle di Rostino (Valle di Rustinu, en langue corse)
se situerait dans le troisième quart du XVIème siècle. Les différents hameaux se
seraient développés à cette époque, à la suite de l'émigration des
habitants du village aujourd'hui disparu de Rescamone.
Castellu di Rustinu (Castello di Rostino)
La page WikipediaCe village tient son nom d’un château médiéval aujourd’hui en ruine situé sur un éperon rocheux dominant la vallée du Golu et ancienne demeure des marquis De Massa. Il s’étage de la vallée du Golu (100 m) au mont San’ Paulu (1100 m) et compte plusieurs hameaux : Ponte Novu, a Pughjola, Frassu, e Ghjalghe, Pianu supranu, Pianu suttanu, Barinciasche, u Gustalbiu et Pastureccia. Chacun des hameaux avait, ou ont encore pour certains, son lavoir, son four, sa fontaine et sa chapelle.
Ponte Nuovo (en Corse Ponte Novu) est un bourg de Castellu di Rustinu situé sur la RN 193 entre Bastia et Corte. En ce lieu, le 9 mai 1769, lors de la bataille de Ponte Novu, les troupes corses menées par le Général Pascal Paoli sont vaincues par l'armée envoyée par Louis XV. Cet évènement met fin à la jeune République Corse, née en 1755 malgré une suzeraineté prétendue par la Republique de Gênes. Cette suzeraineté fut vendue à la France. Après plusieurs victoires des Corses, notamment à Borgu, le 5 octobre 1768, leur défaite à Ponte Novu mit fin à l'indépendance de l'île.
Bisinchi
Castineta
Gavignanu
Merusaglia
U Salgetu (Saliceto)
Bisinchi
Bisinchi
Pieve de Vallerustie
Cette pieve comprend Aiti, Lanu, Carticasi, Erone, Rusiu, San Lurenzu.
Curtinese
- Soveria (Suveria)
- Alando (Alandu)
- Alzi (Alzi)
- Casanova (Casanova)
- Castellare-di-Mercurio (U Castellà di Mercuriu)
- Favalello (U Favalellu)
- Lano (Lanu)
- Mazzola (A Mazzola)
- Muracciole (E Muracciole)
- Noceta (Nuceta)
- Poggio-di-Venaco (U Poghju di Venacu)
- Riventosa (A Riventosa)
- Santo-Pietro-di-Venaco (San Petru di Venacu)
- Sant'Andréa-di-Bozio (Sant'Andria di Boziu)
- Sermano (Sermanu)
- Venaco (Venacu)
- Vivario (Vivariu)

Ellerata
L'Ellerata est une région de Corse située dans le centre-est de l'île, entre la Castagniccia et le Fiumorbu. Elle regroupe les pieve de Serra, d'Opino, de Verde et de Rogna.
Pieve de Serra
La piève de Serra correspond au territoire des actuelles communes de :
Opino était une pieve qui se situait au nord du cours du Tavignano, vers son embouchure, englobant à l'époque le Stagno di Diana.Pieve de Verde
La piève de Verde correspond au territoire des actuelles communes de :
- Pietra-di-Verde ;
- Chiatra ;
- Canale-di-Verde ;
- Linguizzetta ;
- Tox ;
- Campi.
Pieve du Rogna
La piève du Rogna correspond au territoire des actuelles communes de :
- Corte (Corti)
- Erbajolo ;
- Focicchia ;
- Altiani ;
- Piedicorte-di-Gaggio ;
- Pietraserena ;
- Giuncaggio ;
- Pancheraccia ;
- Antisanti ;
- Rospigliani ;
- Noceta ;
- Muracciole ;
- Vivario.
- Santa-Lucia-di-Mercurio (Santa Lucia di Mercuriu)
- Tralonca (Tralonca)
- Castirla (Castirla)
Corti (Corte)
Corte occupe une position centrale dans l’île à 68 kilomètres de Bastia et 80 kilomètres d’Ajaccio. Elle y est reliée par la route nationale 193 et par la voie ferrée Bastia-Ajaccio (Réseau des Chemins de fer de la Corse). C’est la principale agglomération de l’intérieur de l’île..
Corte est la capitale historique et culturelle de la Corse. La « cité paoline » fut en effet choisie par Pascal Paoli comme capitale de la Corse indépendante (entre 1755 et 1769).
Sa citadelle abrite depuis 1997 le musée de la Corse.
La cité est également le siège de l’université de Corse Pascal-Paoli, rouverte en 1981, qui accueille environ 4 000 étudiants.
Corte est implantée au confluent du Tavignano et de la Restonica à 450 mètres d’altitude, au pied d’une citadelle perchée sur un piton rocheux.








Castirla
Castirla: la chapelle San Michele ouvre ses portes au numérique
Par: Pierre-Manuel Pescetti
Publié le: 27 octobre 2022
Dans: Histoire / Patrimoine

Construite au cours du IXe siècle, la chapelle San Michele trône dans le cimetière du village de Castirla. L'édifice à l'architecture préromane abrite un trésor particulier. Derrière l'autel, une fresque datée du XVe siècle orne l'abside en cul-de-four dans la tradition picturale byzantine mélangée à une touche artistique locale. Complètement restaurée en 2012, la chapelle joue un double rôle : religieux, puisque chaque année la messe des défunts y est célébrée, et touristique car l'édifice se visite.
"De mai à septembre nous avons minimum deux visites par jour", se réjouit le maire, Jacques-André Tomasini. Jusqu'alors, les visiteurs devaient se rendre en mairie pour demander les clefs et déverrouiller la porte de bois rénovée. Sauf en été, période durant laquelle la mairie "ouvre le matin et laisse l'accès libre jusqu'au soir", précise Jacques-André Tomasini.
Mais bientôt, "peut-être d'ici fin novembre", selon le maire, la petite chapelle vivra un peu plus "avec son temps".
Pour y entrer, les visiteurs devront se rendre sur un site internet dont l'adresse sera indiquée sur place et s'y enregistrer. Il fournira un code unique pour déverrouiller le digicode de la porte d'entrée et cela sept jours sur sept à des horaires définis. L'installation est énergétiquement autonome. La borne wifi installée sur place pour accéder au site internet et les équipements électriques sont alimentés par un panneau photovoltaïque situé à proximité.
Dans l'objectif des étudiants

à l'intérieur, une nouveauté attendra les visiteurs : "Ils pourront flasher un QR Code qui les enverra vers un documentaire vidéo en français, en corse ou en anglais qui leur contera l'histoire du lieu et ses particularités", explique Jacques-André Tomasini.
Tourné le 20 octobre dernier par sept étudiants de la filière cinéma et audiovisuel de l'Université de Corse, le documentaire de cinq minutes met en scène les explications du maire et d'Elizabeth Pardon, organiste et animatrice du patrimoine spécialiste des chapelles à fresque.
Une première réalisation et "un projet pratique très formateur et créateur de liens" pour Emma Lacaze et ses camarades étudiants qui se sont rencontrés pour la première fois il y a tout juste un mois. Mais au-delà de l'aspect professionnel, l'exercice permet à la jeunesse de découvrir des facettes d'un territoire qui leur est parfois étranger. "J'habite Castirla et cet exercice m'a permis de mieux comprendre l'importance de la chapelle pour les habitants ", explique Emma, qui n'est pas originaire du village.
L'Histoire pour tous
"L'objectif est de rendre accessible à tous la compréhension de la fresque via la présentation en plusieurs langues", souligne le maire. De quoi attirer des visiteurs étrangers et insulaires hors des sentiers battus du tourisme historique et culturel corse. "Nous avons déjà pas mal de touristes étrangers", s'étonne presque Jacques-André Tomasini sans pouvoir avancer de chiffres précis. "L'inscription via le site internet va permettre d'affiner les données sur les visiteurs", ajoute le maire.
Pour commencer, l'accès à la chapelle restera gratuit. "On verra pour la suite", confie l'édile. Il en est conscient, augmenter la visibilité de la chapelle et faciliter l'accès à son histoire peut permettre des retombées positives pour le village et ses commerces.

Nebbiu
Le Nebbio se compose du canton de la Conca-d'Oro et du canton du Haut-Nebbio excepté les communes de Lama, Pietralba et Urtaca :Pieve de Patrimonio
Patrimonio,
Ferringule (Farinole)
Muratu (Murato)
Le village de Murato, chef-lieu du canton du Haut-Nebbiu, se situe dans un chapelet de villages formant un demi-cercle surplombant la plaine de la Conca d'Oru et le golfe de Saint Florent. La commune est traversée par la rivière du Bevinco. Sur le versant le plus ensoleillé de sa vallée a été construit le village.
Rapale
Rapale est un village du Nebbio situé à une même altitude (350 mètres) que ses voisins Sorio, Piève et Vallecalle, tous construits en hauteur sur des sites défensifs. Il est situé sur une arête, à flanc d'une moyenne montagne dont les plus hauts sommets sur la commune ne dépassent pas 700 mètres. Village « balcon », il domine la plaine d'Oletta appelée Conca d'Oro.
Son territoire s'étend depuis les pentes du Monte Pietesco (702 m - Murato) au Sud, s'étale autour du village et se poursuit par une longue bande dirigée Nord-Nord-ouest jusqu'à l'entrée orientale des Agriates. Il présente des paysages très variés, depuis les hauteurs du village qui sont verts mais peu boisés en passant par le village, nid de fraîcheur, la fertile plaine de l'Aliso jusqu'aux premières collines de l'aride désert des Agriates lui appartenant.
Le bâti est ancien, avec des maisons aux façades austères sans balcon, aux toits couverts en alternance de lauzes et de tuiles rouges.
San Cesariu
Située à 15 minutes de marche au-dessus du village de Rapale, la chapelle ruinée San Cesareo offre une vue magnifique sur toute la plaine du Nebbiu.
Cet édifice du 13e siècle, de 12,40 m x 4,40 m, est bâti à flanc de colline sur une petite plate-forme dont le mur nord sert de mur de soutènement (près de 1 m) pour combler la déclivité du terrain. Il présente beaucoup de similitude avec San Nicolao de Pieve, situé non loin. Les sculptures du bandeau placé sous le toit de l'abside semble être d'ailleurs dûs au même sculpteur. Encore relativement en bon ètat en 1920 (date des deux premières photos) elle a subi depuis de très sérieuses dégradations.
Ses murs polychromes font penser à l'église San Michele de Murato toute proche. Sa construction est certainement du début du XIIIeme siècle. L'édifice est inscrit depuis 1840 et classé depuis 1875.
Les dalles de schiste vert foncé alternant d’une façon aléatoire avec des blocs de calcaire gris blanc donnent un subtil jeu de polychromie surtout sensible sur la façade occidentale. Celle-ci est percée d’une porte surmontée d’un arc à claveaux vert foncé souligné par de petits claveaux blancs et d’un tympan reposant sur un linteau mouluré. Une croix ajourée a été reconstituée dans le sommet du fronton.
Chacun des murs latéraux est percé de deux fenêtres meurtrières ; celles-ci présentent une archivolte échancrée en arc légèrement brisé. Seul le mur nord est doté d’une porte surmontée d’un simple linteau rectangulaire à l’intérieur et en bâtière à l’extérieur.
L’abside est particulièrement dégradée : sa fenêtre centrale a perdu son parement comme tout le côté sud d’ailleurs. Elle est ornée d’une arcature sur modillons moulurés et d’une corniche sculptée. Un décor en cordelette surmonte une série de motifs : palmettes, dragon à deux têtes, rinceaux stylisés. Mais de nombreux morceaux ont disparu.
La nef se termine par une abside dont la voûte en cul de four est construite de petites pierres. Le traditionnel arc triomphal est ici formé de petits claveaux bien réguliers.
Malgré quelques velléités de restauration, la chapelle est aujourd’hui fort dégradée car elle a été en partie pillée par des récupérateurs de matériaux. Une photo de 1920 montre qu’une intervention à ce moment était possible et aurait pu la sauver.
Piève
Sorio
vPieve d'Olmeta
Olmeta di Tuda
Oletta
U Poghju d'Oletta
Barbaghju (Barbaggio)
Pieve de San Quilico
Rutali
Vallecalle
Pieve
Soriu
Pieve de Santu Petru
San Gavinu di Tenda
Santu Petru di Tenda
San Fiurenzu (Saint Florent)

Fiumorbu
La région du Fiumorbo est située au sud de la Plaine orientale, sur la côte intérieure de la Corse. Elle est composée des anciennes pievi de Cursa et de Coasina. Elle tient son nom du fleuve Fiumorbo qui prend naissance au sud du Monte Renoso, arrose la piève voisine de Castello avant de se jeter dans la mer Tyrrhénienne à Serra-di-Fiumorbo.
Le territoire s'étend de la ligne de partage des eaux jusqu'à la mer Tyrrhénienne. Il est délimité à l'est par une façade maritime, à l'ouest et au sud par un relief montagneux (avec ses 2 134 m, le Monte Incudine en est le point culminant), et est ouvert au nord vers la Costa Serena.
La délimitation de la région a largement varié au cours des siècles. Ainsi, la pieve de Fiumorbo créée par l'administration française vers la fin du XVIIIe siècle correspond à l'actuel canton de Prunelli-di-Fiumorbo, occupant la vallée de l'Abatesco, fait d'autant plus surprenant que le fleuve Fiumorbo qui y a donné son nom irrigue exclusivement la piève de Castello (soit le canton de Ghisoni). Les communes de Ventiseri, Chisa et Solaro, isolées dans la vallée du Travo, forment géographiquement un ensemble quelque peu à part du reste de la région.
De nos jours, la région du Fiumorbo est, pour le Parc naturel régional de Corse, un « territoire de vie » composé des communes adhérentes de :
- Prunelli-di-Fiumorbo
- Isolaccio-di-Fiumorbo
- Chisa
- San-Gavino-di-Fiumorbo
- Serra-di-Fiumorbo
- Solaro
- Ghisoni
- Lugo-di-Nazza
- Poggio-di-Nazza
- Sari-Solenzara

Taravu
Le Taravo est composé des territoires de trois pièves pour un total de 33 communes :
- Albitreccia ;
- Azilone-Ampaza ;
- Campo ;
- Cardo-Torgia ;
- Cognocoli-Monticchi ;
- Coti-Chiavari ;
- Forciolo ;
- Frasseto ;
- Grosseto-Prugna ;
- Guargualé ;
- Pietrosella ;
- Pila-Canale ;
- Quasquara ;
- Santa-Maria-Siché ;
- Serra-di-Ferro ;
- Urbalacone ;
- Zigliara.
- Ciamannacce ;
- Corrano ;
- Cozzano ;
- Guitera-les-Bains ;
- Palneca ;
- Sampolo ;
- Tasso ;
- Zévaco ;
- Zicavo.
Palleca (Palneca)
Palleca tandu – C’était Palleca.
Ce documentaire de création, réalisé par Rina Sherman et vécu par Abel Gény et Rina Sherman est produit par k éditeur dans le cadre de la collection :
Gran’ ritratti : I tistimonii di u nosciu tempu – Grands portraits : Témoins de notre Temps,
avec le soutien de la Cullittività di Corsica – Collectivité de Corse en partenariat avec le CNC.
Le film est présenté en version bilingue sous-titré : Virsioni corsa & francesi – Version française & corse.
Pour ce travail de sous-titrage, réalisé sur une période de plusieurs mois (transcriptions, traductions, adaptation et réalisation), nous sommes particulièrement heureux d’avoir pu bénéficier du concours de connaisseurs et de linguistes de l’expression locale de Palleca, de ses environs et du Haut-Taravu, notamment Thérèse Ferri-Santoni, notre référente pour la langue corse.
Pour répondre à cette question, nous avons retrouvé les anciens, à Paris, à Ajaccio, à Palleca et dans quelques villages environnants. Chacun d'entre eux, à sa façon, relate les joies et les épreuves de son enfance dans le village, à la plage, en famille ; les codes, les interdits, l’entraide et les inimitiés, le travail, la cuisine, les récoltes, la politique, la culture, la vie aux colonies, la transhumance entre la montagne et plage. Et ainsi est sculptée, phrase par phrase, par un regard, un rire, une hésitation, leur identité de pallecais et de Corse ;
Ce sont des conversations libres filmées, la mise en scène de la parole.
Ce film s'inscrit dans un attachement à la transmission, la continuation et la restitution : de la langue, de la mémoire, des traditions, des lieux, d'une façon de vivre et d'une manière de penser.
Notre collecte de données s’étendait sur la trajectoire de la transhumance, le paysage, la photographie, la toponymie des lieux, les lieux marqueurs tels que présents dans la mémoire, les raccourcis de bergers, la chanson, et rare pour un film d'anthropographie, la poésie.
Afin d'assurer à ce film, réalisé sur plusieurs années, la plus grande visibilité et utilité possible, nous cherchons à prendre attache avec différents réseaux éducatifs et de distribution pouvant l'inclure dans les curricula d'enseignement des langues corses et française, ainsi que des activités culturelles ayant pour but de promouvoir la langue et la culture corse.
Le film est disponible en DVD, pour usage privée ou institutionnelle, directement depuis la page dédiée sur le site de k éditeur, ou en HD pour une projection publique, en présence de la réalisatrice, ou encore sur les différentes plateformes de distribution éducationnelle. Vous pouvez également faire une proposition ou une demande d’acquisition d’une licence institutionnelle du film auprès de votre bibliothèque universitaire, médiathèque ou bibliothèque locale.
Bien cordialement,
Rina Sherman k éditeur
“It was Palleca,” a film that bears witness to the village’s memory
"C'était Palleca", film témoin de la mémoire du village
Par: Laure Filippi
Publié le: 09 novembre 2021 à 08:15
Dans: Culture - Loisirs

Durant plus de six ans, la réalisatrice et anthropographe multimédia, Rina Sherman, a tourné sa caméra vers les habitants de Palneca, sur les traces du passé, guidée par Abel Gény, lui-même originaire du village du Haut-Taravo et coauteur de ce documentaire sous-titré en corse
Comment était la vie autrefois à Palneca ? Dans un monde en perpétuel mouvement, tandis que les témoins des débuts et milieu du siècle dernier disparaissent peu à peu, Rina Sherman et Abel Gény ont choisi de répondre à cette question et de capturer une part de cette mémoire insulaire, avant qu'elle ne s'éteigne. Avec le documentaire de création Palleca tandu - C'était Palleca, le passé de ce village du Haut-Taravo reprend ainsi vie et épaisseur, à travers les récits des anciens, relatant les joies et les épreuves de leur enfance.

Un film tourné durant plus de six ans, entre 2014 et 2021, telle une quête de transmission et de restitution de l'histoire, des traditions, des lieux, de l'identité et de la langue. Présenté en version bilingue sous-titrée française et corse, ce long-métrage de 83 minutes a bénéficié d'un important travail de plusieurs mois de transcriptions, traductions, adaptation et réalisation, mené par des connaisseurs et linguistes de l'expression locale de Palneca et de ses environs - et notamment de la poétesse et référente pour la langue corse, Thérèse Ferri-Santoni.
Un sous-titrage effectué selon la méthode transmise par Jean Rouch à Rina Sherman, que celle-ci avait déjà adoptée dans le cadre de son œuvre Ma vie avec les Ovahimba et des sept années passées avec des communautés de langue otjiherero, en Namibie et en Angola.

"Il s'agit d'un travail de transcription complexe, qui part de la traduction mot à mot de la langue cible, sans conjugaison ou syntaxe, avant de réaliser les sous-titres pour entrer dans l'espace-temps du film, explique l'auteur, réalisatrice et anthropographe du multimédia (cinéma, photographie, son). Une importante recherche a été faite sur la toponymie, avec un relevé détaillé de la langue locale et des vérifications sur plusieurs mois, pour la traiter sur le même plan que la langue française. Au final, cet outil technique est très efficace pour rendre compréhensible la parole d'origine aux générations à venir. Il fera ainsi référence", ajoute Rina Sherman, également productrice du documentaire avec k éditeur, dans le cadre de la collection Gran' ritratti : I tistimonii di u nosciu tempu - Grands portraits : témoins de notre temps.

En coproduction avec The Prod, soutenu par la Collectivité de Corse et déposé à la Cinémathèque de Corse, en partenariat avec le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), Palleca tandu - C'était Palleca a par ailleurs été coécrit par Abel Gény, lui-même Palnecais et auteur du livre Palleca (Palneca) - Une communauté agropastorale du Haut Taravu, paru en 2019 aux éditions Albania. C'est d'ailleurs par l'intermédiaire de son fils, ami de Rina Sherman, que le projet de film a vu le jour.

"Lorsque Rina s'est intéressée à Palneca, j'ai contacté des personnes du village qui y avaient vécu au moment de la Seconde Guerre mondiale ou après, relate Abel Gény, retraité de l'industrie pharmaceutique et originaire par sa mère du village où il a passé son enfance, et où il conserve des attaches très fortes. J'avais de mon côté commencé à recueillir des données dès les années 2000 en vue de ce travail de mémoire et de transmission. Il me tenait donc à cœur de poursuivre cette entreprise à travers ce film, afin de montrer combien la vie d'autrefois était différente de ce que l'on peut imaginer aujourd'hui. Aussi bien du point de vue de sa rudesse que de l'esprit d'entraide et du sens de la famille qui y régnaient. Une vie aussi très proche de la nature, loin de la vie matérialiste et consumériste actuelle", poursuit-il.

Rina Sherman


Gravona
La Gravona désigne l'ensemble des territoires situés dans le bassin versant de la rivière Gravona, c'est-à-dire le Celavo en haute et moyenne vallées et la Mezzana en basse vallée.
La région de la Gravona comprend deux microrégions, en descendant vers la mer :
Celavo (Cèlavu)
- Bocognano (Bucugnà)
- Tavera (Tavera)
- Ucciani (Auccià)
- Carbuccia (Carbuccia)
- Vero (Veru)
- Tavaco (Tàvacu)
- Peri (I Peri)
- Cuttoli-Corticchiato (Cùttuli è Curtichjatu)
Mezzana (Mizana)
- Sarrola-Carcopino (Sàrrula è Carcupinu)
- Valle-di-Mezzana (I Vaddi di Mizana)
- Appietto (Appiettu)
- Afa (Afà)
- Alata (Alata)
- Villanova (Villanova)
- Ajaccio (Aiacciu).

Dui Sevi
Les Deux-Sevi sont situés sur la façade occidentale de l'île, coincés entre le Filosorma au nord et les Deux-Sorru au sud. Ils occupent les territoires des anciennes pièves de Sevinfuori et de Sevenentro ainsi que le Sia. Les habitants des Deux-Sevi sont appelés Sivinchi en corse. La région des Deux-Sevi est composée des communes de :
- Cargèse ;
- Cristinacce ;
- Evisa ;
- Marignana ;
- Osani ;
- Ota ;
- Partinello ;
- Piana ;
- Serriera.