Libri : Livres
Jérôme Ferrari
D'une famille originaire de Fozzano et de Sartène, Jérôme Ferrari est né en 1968 à Paris. Après avoir enseigné au lycée international d'Alger, au lycée de Porto-Vecchio et au lycée Fesch d'Ajaccio, il a été professeur de philosophie et conseiller pédagogique au lycée français d'Abou Dhabi.
Depuis la rentrée 2015, il enseigne la Philosophie en hypokhâgne, au lycée Giocante de Casabianca de Bastia.

Œuvres :
- Aleph zéro, Ajaccio, France, Albiana, 2002
- Dans le secret, Arles, France, Actes Sud, coll. « Domaine français », 2007
- Balco Atlantico, Arles, France, Actes Sud, coll. « Domaine français », 2008
- Un dieu un animal, Arles, France, Actes Sud, coll. « Domaine français », 2009
- Où j'ai laissé mon âme, Arles, France, Actes Sud, coll. « Domaine français », 2010
- Le Sermon sur la chute de Rome, Arles, France, Actes Sud, coll. « Domaine français », 2012, Prix Goncourt 2012
- Le Principe, Arles, Actes Sud, 2015
- A fendre le coeur le plus dur, Inculte/Dernière marge, 2015 et Actes sud (Babel), 2017, Essai écrit avec Oliver Rohe.
- Il se passe quelque chose, Flammarion, 2017, 154 p.
- À son image, Arles, France, Actes Sud, 2018, 224 p, Prix littéraire "Le Monde" 2018
« Les mondes possibles de Jérôme Ferrari »

Le prix Méditerranée à Jérôme Ferrari pour À son image

le prix littéraire du Monde pour ce roman en forme de requiem sur nos illusions perdues.
Le romancier Jérôme Ferrari et l'écrivain italien Marco Balzano ont reçu mercredi le prix Méditerranée pour respectivement À son image et Je reste ici. Lauréat du prix Goncourt en 2012, Jérôme Ferrari avait déjà reçu en septembre le prix littéraire du Monde pour ce roman en forme de requiem sur nos illusions perdues. A son image (Actes Sud) dresse le portrait d'une photographe corse, Antonia, morte dans un accident de voiture à l'âge de 38 ans.
Je reste ici (Philippe Rey), traduit de l'italien par Nathalie Bauer, raconte l'histoire d'une femme ballottée par l'Histoire, une germanophone du Haut Adige annexée par l'Italie au début des annés 1920. La narratrice est privée de sa langue (les nouvelles autorités italiennes ont interdit la pratique de l'allemand) et bientôt c'est son village même qui est menacé par un projet de barrage pharaonique décidé par Mussolini...
Fondé en 1985 à Perpignan, le prix Méditerranée est organisé par le Centre Méditerranéen de Littérature et ses partenaires (ville de Perpignan, Conseil départemental des Pyrénées-Orientales, Région Occitanie et la Caisse d'Épargne Languedoc-Roussillon). L'an dernier, c'est le romancier algérien Kamel Daoud qui avait reçu le prix pour Zabor et les psaumes (Actes Sud) tandis que l'écrivain américain Daniel Mendelsohn avait décroché le prix étranger pour Une odyssée (Flammarion).
Jérôme Ferrari : "La distinction, spécialement en littérature, entre la forme et le fond est une distinction totalement abstraite"
Pour la parution de son livre "À son image" aux éditions Actes Sud. Dans ce roman, consacré à une photographe décédée, l’écrivain aborde le nationalisme corse, la violence des conflits contemporains et les liens troubles entre l'image, la photographie, le réel et la mort.

Dans ce roman c’est un prêtre qui parle et qui cherche une messe impossible à prononcer, une messe à l'image de sa nièce, morte accidentellement, et qui avait pour passion la photographie.
J’ai mis beaucoup de temps à penser au roman avant de commencer à l’écrire. J’écris toujours des romans où il y a plusieurs fils narratifs, donc les questions de structures et d’agencements sont essentielles : je suis incapable de partir au fil de la plume à cause de la nature des textes que je fais.
J’ai toujours eu l’impression que dans les moments de deuil, on peut considérer le défunt comme quelqu’un qui est revenu à la radicale faiblesse de l’enfance, quel que soit son âge.
La facilité de l’exercice de la violence, et comment traiter cette violence dans la représentation, c’est quelque chose que je n’arrive pas à épuiser.
Je m’intéresse aux instants décisifs visibles, il y en a plusieurs dans le roman, et je m’intéresse encore plus aux moments décisifs absolument invisibles, qui sont pour moi la charnière à partir de laquelle tout se met à toute vitesse à tourner très mal.
Je ne voulais pas mettre d’images, parce qu’un roman ça se fait uniquement avec les ressources du langage.
Les possibilités de falsification sont nombreuses, les possibilités de justesse sont moins nombreuses et bien plus compliquées à trouver.
Entretien avec l’écrivain et professeur de philosophie Jérôme. Il nous présente son nouvel ouvrage, « À son image » (Actes Sud, 2018). Conversation sur la littérature, la photographie et l’indépendantisme corse.
05.09.2018
« Le Monde » remet son prix littéraire à Jérôme Ferrari pour « À son image »
Le sixième prix littéraire « Le Monde » a été attribué mercredi à l’écrivain pour son roman qui retrace l’histoire d’une photoreporter corse.
Par Raphaëlle Leyris, Jean Birnbaum
Nous avons hésité à faire figurer A son image parmi les romans en lice pour le prix littéraire Le Monde. Non que nous ayons eu des doutes sur la beauté sombre et la force de cette histoire retraçant l’histoire d’une photoreporter corse. Mais parce que, six ans après le Goncourt du Sermon sur la chute de Rome (Actes Sud), nous nous interrogions sur le sens qu’il y aurait à attribuer une récompense à celui qui avait déjà reçu le plus convoité des prix.
Des questions balayées par l’enthousiasme du jury, présidé par Jérôme Fenoglio, directeur du Monde, et composé de journalistes travaillant au « Monde des livres » (Jean Birnbaum, Florent Georgesco, Raphaëlle Leyris, Florence Noiville et Macha Séry) et aux quatre « coins » du Monde : François Bougon (Economie), Denis Cosnard (Economie), Emmanuel Davidenkoff (Développement éditorial), Clara Georges (« L’Epoque ») et Raphaëlle Rérolle (« Grands reporters »). En dépit des grandes qualités des autres textes sélectionnés, c’est donc A son image qui succède à L’Art de perdre, d’Alice Zeniter (Flammarion).
Quel rapport entreteniez-vous avec les prix littéraires avant le Goncourt, et ce dernier a-t-il modifié votre regard sur eux ?
Comme lecteur, je n’ai jamais choisi un livre en fonction des prix, et il ne m’a jamais semblé que ceux-ci étaient un critère de qualité littéraire infaillible. Et pourtant je me rappelle très bien à quel point, en 2012, la semaine avant l’attribution du Goncourt, j’avais du mal à penser à autre chose.
Aujourd’hui, j’entretiens un rapport moins détaché que je ne le pensais, moi qui étais convaincu d’en avoir fini avec les prix. Celui du Monde me fait très plaisir. Sans doute parce que j’ai une relation particulière avec votre journal depuis 2012. [Plus de deux mois avant de recevoir le prix Goncourt, Jérôme Ferrari avait fait la « une » du « Monde des livres » et du Monde pour Le Sermon sur la chute de Rome.]
Avez-vous un lien plus lointain, familial par exemple, avec « Le Monde » ?
Cela fait des années que je suis abonné au Monde. Dans ma famille, il n’y avait pas de quotidien à la maison, mais j’ai tout de même un lien familial avec le journal, grâce à un cousin qui travaillait à l’imprimerie du Monde, et qui a donné à mon père la plaque d’impression de cette fameuse « une » du Monde d’août 2012 !
Votre œuvre semble revenir constamment à la première phrase d’« Un dieu un animal » (Actes Sud, 2009) : « Bien sûr, les choses tournent mal. » L’expression est récurrente dans « A son image »…
Je m’en suis aperçu à la relecture ! J’ai fait un travail d’enquête en Serbie avant d’écrire, et ce qui revenait constamment dans les discussions avec les gens était leur consternation face à la rapidité avec laquelle, oui, les choses tournaient mal. Le fait qu’ils pensaient moins vite que l’événement. L’expression s’est imposée. Mais peut-être que cela m’a frappé parce que cela rencontrait, chez moi, un certain tropisme.
Plus le roman avance, plus on a l’impression que la photo est ce qui montre ce qui n’aurait pas dû être montré. Et l’on se demande si, au fond, la conclusion à en tirer ne serait pas celle d’une « supériorité » morale de la littérature…
C’est un problème qui est abordé, en effet, mais ça n’est pas du tout ce que je pense. Le piège de l’obscénité est là, dans n’importe quel type de représentation. Cette question m’intéresse, y compris d’un point de vue philosophique, depuis longtemps.
Personnellement, je pense que les photos qui montrent ce qu’on devrait cacher doivent le montrer – même si j’ai conscience que l’impact du photo-reportage de guerre est inférieur à ce qu’il a pu être, parce que l’on est noyé sous les images.
Attester d’un événement reste une chose très importante. Je ne pense pas que la littérature, face à l’obscénité, puisse se placer en position de supériorité par rapport à la photographie. Il faut voir au cas par cas. Quand j’écrivais Où j’ai laissé mon âme [Actes Sud, 2010], cette question me travaillait particulièrement – et avec elle cette idée qu’on peut être obscène avec les meilleures intentions du monde.
Est-ce que ces interrogations sur l’obscénité et la complaisance ont un lien avec la relative sobriété de votre écriture dans « A son image » ?
Non, ça, c’est vraiment une chose entre moi et moi, à cause de laquelle j’ai recommencé le roman vingt fois. J’ai toujours eu peur du moment où l’on maîtrise une forme si bien que l’on finit, sans s’en rendre compte, par reproduire un « algorithme » inconscient d’écriture… Au risque de s’autoparodier. C’est une chose que je craignais, et c’est de cela que procède ce changement. Je voulais un peu échapper à moi-même.
La thématique religieuse est très forte ici, comme elle l’était dans « Le Sermon sur la chute de Rome », entre autres. Vous dites n’être pas croyant, mais est-ce que, de livre en livre, vous n’approfondissez pas ce que le philosophe, théologien et prêtre Michel de Certeau (1925-1986) appelait une « écriture croyante » ?
Cette expression est très belle ! Je veux bien me l’approprier. Il est sûr que je ne suis pas croyant, et tout aussi sûr qu’il y a là-dedans beaucoup de choses qui me touchent, sans quoi je ne me lancerais pas dans un exercice simplement intellectuel ou esthétique.
Pour écrire un personnage de prêtre, comme il y en a un dans A son image, il faut que je me sente au moins la capacité de me faire une représentation intime de ce que peut être cette expérience. Je ne sais pas si j’aurais ressenti cette proximité si je n’avais pas connu les messes d’enterrement corses – c’est une série de gestes, de prières et de devoirs qui sont accomplis dans une solennité encore augmentée quand la messe est chantée en polyphonie. Peut-être que j’y suis d’abord venu par émotion esthétique.
Par Raphaëlle Leyris, Jean Birnbaum
Publié Le 05.09.2018 à 19h33



Jérôme Ferrari : “A son image”, le retour en Corse du fils prodige

Trois ans après Le Principe, Jérôme Ferrari revient sur l’île avec un nouveau roman, A son image. Son héroïne, Antonia, une jeune photographe, sillonne les zones de guerre de la fin du siècle dernier, de la Yougoslavie qui vole en éclats à la Corse nationaliste qui s’entretue.
Par Sébastien Bonifay / France 3 Corse ViaStella - Publié le 20/08/2018
La photographie, quiconque a déjà lu Jérôme Ferrari le sait, est un art qui fascine l’auteur du Sermon sur la Chute de Rome, lauréat du Goncourt 2012. Il y avait même consacré un livre, en 2015, avec Oliver Rohe, A Fendre le Coeur le plus dur.
Mais elle n’avait jamais été au cœur d’un de ses romans. C’est désormais chose faite avec A son image (Actes sud).
Une jeune femme, Antonia, rentre chez elle après avoir passé une partie de la journée à Calvi, où elle avait immortalisé sur pellicule un nouveau mariage. Elle n’arrivera jamais à bon port. Une sortie de route, et Antonia est tuée sur le coup.
Intervenants - Jérôme Ferrari, Ecrivain Equipe - Sébastien Bonifay ; Marc-Antoine Renucci ; Dominique Lameta.
C’est ainsi que débute le nouveau roman de Ferrari. Qui va s’articuler autour de l’office funèbre célébré par son parrain, prêtre de la paroisse, qui est à l’origine de sa vocation. Il lui avait offert un appareil photo pour ses quinze ans.
Au fil de la cérémonie, des souvenirs, des confidences, des récits vont retracer le parcours d’Antonia. Un parcours qui débute sur l’île, où elle fait ses premières armes au sein de la rédaction du quotidien régional. Elle y est confrontée à la dure réalité de la profession. La jeune fille, fascinée par la photographie, par cet instant fugitif où l’on est témoin d’un moment que l’on peut immortaliser, est aussi consciente de la responsabilité qui en résulte.
Désabusée par son expérience journalistique, elle délaisse les faits divers pour partir couvrir le conflit qui met à feu et à sang les Balkans au coeur des années 90. Une expérience, dans un pays étranger, où elle va enfin faire connaissance avec le pire et le meilleur de ce métier…
Intervenants - Jérôme Ferrari, écrivain Equipe - Sébastien Bonifay
Les souvenirs de son parrain, égrenés au fil du livre, vont également nous dévoiler une autre facette d’Antonia. A travers son attirance, puis sa relation amoureuse avec un militant nationaliste avec qui elle a grandi, au village. Un militant qui n’hésite pas à troquer les tracts électoraux pour la cagoule une fois la nuit venue. Et qui va se retrouver emporté par le déchaînement de violences qui, loin de la Croatie et de la Bosnie, va également s’abattre sur la Corse.
Témoignage d'une époqueToute sa vie, Antonia a essayé de lutter contre les compromissions, contre les médiocrités. Contre les puissants liens familiaux et sociaux d’une île où l’on est jamais moins libre que lorsque l’on pense le devenir. Pour rester fidèle à la vocation qu’elle s’était choisie. En vain. Elle apprendra, de la plus cruelle des manières, que l’on ne peut regarder sa propre vie comme l’on a appris à regarder le reste du monde. A travers l’objectif d’un appareil photo.
C’est un magnifique et poignant roman que livre Ferrari avec A son image. Un roman où l’auteur fait preuve d’une maîtrise narrative éblouissante, entremêlant les époques, les voix et les lieux avec brio. Un roman où la guerre entre nationalistes, déjà au cœur de Balco Atlantico, l’un de ses précédents romans, occupe une place de choix.
Mais où Jérôme Ferrari s’interroge également longuement sur la force de la photographie. La représentation d’un instant qui, à notre époque, fait figure de témoignage, de preuve incontestable, mais qui pourtant, peine à capturer toute la complexité du réel. "Ce que nous montre une photo est à chaque fois figé pour toujours dans la permanence du présent et a pourtant, dès le déclenchement de l’obturateur, déjà disparu".
Jérôme Ferrari : "La Corse, une source d'inspiration inépuisable" (L'Obs)

Par Renée Greusard
Publié le 18 août 2018 à 11h11Élevé en banlieue parisienne, Jérôme Ferrari est retourné vivre en Corse après des études de philo à la Sorbonne. D'abord à Porto-Vecchio puis à Bastia, où il enseigne la philosophie en classe d'hypokhâgne au lycée Giocante-de-Casabianca.
Alors qu'il préparait la sortie de son nouveau roman, (A son image, éd. Actes Sud) où l'île est une fois de plus omniprésente, l'auteur a accepté de nous guider à travers le maquis… et de nous livrer ses meilleures adresses.
Vous dites avoir mis sept ans à comprendre la complexité de la culture corse, à sortir des clichés locaux. Les vacanciers, qui n'y passent que quelques jours, peuvent-ils s'en faire une idée ?
- Je pense d'abord qu'il y a une majorité de gens qui ne viennent que pour le soleil. La journée, ils vont à la plage et la nuit, ils vont danser en boîte. Pour ceux-là, être en Corse ou ailleurs, ça revient un peu au même. En revanche, pour ceux qui ont envie de découvertes, ce n'est pas si difficile que ça.
Il suffit d'aller vers les gens qui connaissent les lieux. Il faut aller en montagne, se promener dans le maquis, entrer dans les bars, discuter avec les Corses. On a une réputation épouvantable, mais je ne pense pas qu'elle soit vraiment méritée !
La Corse est-elle toujours un "bronze-cul", ainsi que vous l'écriviez dans un texte hilarant, en 2011 dans "Libération" ? Que vouliez-vous dire ?
- Oui, c'est encore le cas. Quand j'ai écrit ce texte, j'habitais à Porto-Vecchio, où j'ai exercé huit ans comme professeur de philo. J'ai habité dans le centre, près de la place de l'Eglise, où se concentre toute l'activité en été alors que jusqu'à la fin du printemps, ça reste rigoureusement vide. Et tout d'un coup, un jour de juin, on ne peut plus ni bouger, ni dormir, ni se garer. Comme une bonne partie du sud de l'Europe, la Corse devient alors une terre de bronzage que plébiscitent "de très nombreux culs, anonymes ou célèbres" ; c'est ce que j'écrivais dans ce texte.
Selon moi, ce fait si trivial décrit une réalité fondamentale de l'île. D'autant que l'on se réveille un matin d'octobre et tous les bars, les cafés, les restaurants, ont subitement fermé, il n'y a plus rien. Bref, ici on n'est jamais content ; soit il n'y a pas assez de monde, soit il y en a beaucoup trop. C'est une schizophrénie brutale.
Vous évoquez aussi les clichés, très forts, sur la culture corse…
- Il y a une image de l'extérieur, très forte, intériorisée par les Corses eux-mêmes, qui date du XIXe siècle et de la période de fascination romantique pour l'île. Romantique et dramatique.
J'étais moi-même assez attaché à cette image. Mon village, c'est Fozzano, celui où Mérimée a rencontré son héroïne Colomba. Forcément, ça peut faire rêver, on peut se raconter une belle histoire. Mais cette image ne correspond pas du tout à la réalité et je m'en suis détaché.
D'ailleurs dans mes livres, je cherche justement à mettre en avant le côté contemporain, touristique, frénétique de la Corse, qui n'a pas grand-chose de romantique. C'est plus authentique, plus dur probablement, mais aussi plus intéressant.
Avez-vous l'impression, à travers vos livres, d'incarner le renouveau de la culture corse ?
- Ce que l'on a appelé le renouveau de la culture corse date plutôt de la fin des années 1970. A Corte, il y avait à cette époque un vrai bouillonnement, tout le monde faisait de la musique, avec des artistes de grande qualité. Mais en vérité, seuls I Muvrini et A Filetta sont sortis de Corse. Sur le plan littéraire, il y avait aussi pas mal d'éditeurs locaux. Et la production de textes est toujours assez foisonnante. Mais les réseaux de distribution sont tels que si on est publié ici, on ne sera lu qu'ici.
Aujourd'hui, avec mon ami l'écrivain Marc Biancarelli et d'autres auteurs corses, nous essayons d'écrire sur des thèmes propres à la Corse, mais dans une version contemporaine, inscrite dans la réalité et non fantasmée.
Diriez-vous que l'insularité de la Corse peut être un facteur "d'empêchement culturel" ?
- Ce n'est pas complètement faux, même si ce n'est pas une fatalité. Par exemple, à Bastia, il y a soixante-dix ans, il y avait une très grosse activité culturelle, tournée vers l'Italie, avec notamment l'opéra qui était une pratique hyper populaire. Aujourd'hui, c'est complètement sclérosé, mais aussi parce que la Corse souffre d'une image sulfureuse.
On est plus facilement identifié comme corse si l'on est directeur de casino ou proxénète que si l'on est artiste ou écrivain. Moi-même, quand j'ai commencé à écrire, mes textes étaient lus avec plusieurs paires de lunettes, il y avait peut-être une forme de suspicion.
Pourriez-vous envisager de ne pas parler de la Corse dans l'un de vos livres ?
- La Corse est une source d'inspiration inépuisable. Il y a ici une histoire politique riche, un lourd passé colonial. Et puis, il y a des confrontations improbables. Les villages, par exemple, sont des lieux où se côtoient des gens très différents. Dans un petit bar isolé en montagne, on peut ainsi trouver un mec qui sort de prison, un berger et un prof d'université. Le seul point commun de ces gens, c'est qu'ils sont originaires du même village. A cette diversité, s'ajoutent encore les touristes en été. Tout cela crée des minichocs culturels très intéressants, et de la matière littéraire.
Avez-vous eu envie, comme les personnages de votre livre " le Sermon sur la Chute de Rome ", de reprendre un bar de village pour le faire revivre ?
- Non, jamais. Chez moi, le bar du village a disparu. Mais il en reste quand même pas mal, ce sont des lieux importants. Aller dans certains petits bars de villages de montagne un samedi soir de février, ça peut être aussi intense que d'aller dans un bar underground de Manhattan !
Interview de Jérôme Ferrari par Renée Greusard


Jérôme Ferrari : « Si le lien des mots à leur référence est coupé, toutes les manipulations sont possibles »
De janvier à juillet 2016, Jérôme Ferrari, prix Goncourt 2012 pour le Sermon sur la chute de Rome, a tenu une chronique hebdomadaire dans la Croix. Déchéance de nationalité, terrorisme, montée des populismes en Europe ou réforme de l’orthographe : un commentaire éclairé de l’actualité avec les outils de la philosophie et une attention particulière portée au langage. Il les publie aujourd’hui sous le titre Il se passe quelque chose.
Pourquoi avez-vous accepté de sortir de votre position de retrait pour écrire ces chroniques ? Vous l’avez fait avec les outils de l’écrivain mais surtout du professeur de philosophie…
Jérôme Ferrari Je ne crois pas à une réserve nécessaire de l’écrivain. C’était la mienne, en tant qu’individu. Si on me l’avait demandé un an avant, j’aurais dit non. Mais je commençais à être vraiment heurté par la situation sociale et politique. Avant cette demande, j’avais fait une chronique dans Corse-Matin à la suite des agressions racistes dans le quartier des Jardins de l’Empereur à Ajaccio en décembre 2015 (1). Une série de mouvements similaires en Europe m’ont incité à prendre la parole. Je ne voulais pas le faire n’importe comment, je trouve que les billets d’humeur n’ont aucun intérêt, sauf s’ils sont drôles. J’ai donc essayé d’écrire mes chroniques avec les outils dont je disposais : ma pratique de la philosophie.
Ces chroniques sont-elles une tentative d’élucider, de mettre au jour les contradictions, notamment dans le langage?
Jérôme Ferrari Avec mes élèves de lettres supérieures, j’avais choisi de traiter le thème du Mal. J’ai beaucoup travaillé Hannah Arendt et les questions du langage me paraissaient déterminantes. Les développements récents de l’actualité ne font que confirmer une tendance catastrophique dont le summum a été atteint par les « alternative facts », la postvérité. La nouveauté est l’extraordinaire naïveté avec laquelle ce mot sort de la bouche de la porte-parole de Donald Trump. Ce n’est pas seulement un problème ontologique, c’est un problème politique très grave. Si le lien des mots à leur référence est coupé, toutes les manipulations sont possibles. Plus rien ne veut rien dire. En 1951, Hannah Arendt a écrit: « Le citoyen idéal d’un régime totalitaire n’est pas un militant convaincu, c’est quelqu’un pour qui la distinction entre vérité et mensonge n’a plus aucun sens.» Nous y sommes : c’est François Fillon parlant d’assassinat politique, un sympathisant pro-Fillon qui, face à un reporter de l’émission Quotidien, compare les journalistes aux nazis qui conduisaient les juifs à Auschwitz. L’espace politique est dynamité. Il y a des fans et leur idole.
En tant que professeur de philosophie, comment parlez-vous de cette situation à vos élèves ? Peut-on encore penser avec les outils anciens ?
Jérôme Ferrari C’est une question que je me pose de manière très urgente. Avec des collègues, nous tentons de faire des interventions sur les théories du complot et de les analyser. Je suis obligé de revenir à la logique formelle élémentaire : qu’est-ce qu’une inférence valide, qu’est-ce que le statut d’une preuve, qu’est ce qu’une interprétation valide en sciences sociales ? Pour permettre la pluralité des interprétations, il faut se mettre d’accord sur ce que sont les faits.
Vous parlez d’une vision utilitaire, utilitariste, de certaines disciplines. Est-il difficile d’enseigner la philosophie aujourd’hui?
Jérôme Ferrari Je pense que c’est fichu. Aujourd’hui, on conçoit uniquement l’enseignement comme une préparation au monde du travail. Cette conception n’est plus considérée comme une prise de position idéologique mais comme un fait. Selon moi, la philosophie est enseignée en classe de terminale pour que les élèves acquièrent une autonomie de la pensée. Je ne suis pas là pour leur donner des compétences mais des apprentissages. Le but est politique, au sens noble du terme, et n’a pas à voir avec le monde de l’entreprise. L’entreprise n’a rien à faire dans les murs d’une école.
La première chronique est consacrée à la Corse, alors que vous vous étiez promis de ne jamais écrire sur ce sujet dans la presse nationale.Quel a été le déclencheur ?
Jérôme FerrariI J’ai écrit sur les événements des Jardins de l’Empereur dans Corse-Matin. Si je dois attaquer un événement survenu en Corse, je le fais dans la presse corse ou pas du tout, c’est la règle. Mais si je dois défendre quelque chose, je veux bien le faire dans la presse nationale. Au moment où j’ai commencé mes chroniques, les nationalistes avaient gagné les élections. Le président de l’exécutif, Gilles Simeoni, et le président de l’Assemblée, Jean-Guy Talamoni, avaient fait scandale en prononçant un discours en langue corse qui a donné lieu, sur le continent, à des éditoriaux hallucinants. Comment peut-on s’effarer que quelqu’un qui est élu sur un programme nationaliste tienne un discours nationaliste dans une langue dont il réclame la co-officialité ? La politique centraliste française sur les langues régionales est catastrophique, on place une charge symbolique, comme si on manipulait de la dynamite, sur des choses triviales et sans aucun danger.
À l’âge de 20 ans, vous avez milité dans les mouvements pour l’autodétermination. Quelle a été votre évolution politique ?
Jérôme Ferrari Je suis rentré en Corse à 20 ans, j’ai milité dans le mouvement nationaliste, j’ai écrit dans l’hebdomadaire du MPA (Mouvement pour l’autodétermination), qui était une des deux branches principales du nationalisme dans les années 1990. J’ai toujours été dans une démarche de défense de la culture et de la langue. Sur ces questions, je n’ai pas changé d’avis. Maintenant, je ne crois plus du tout à la pertinence de la violence politique et je ne suis pas indépendantiste. Mon expérience m’a guéri du militantisme. Il conduit, selon moi, à une grégarisation de la pensée. Je parle d’un conformisme social qui imprègne les individus et n’a rien à voir avec leur intelligence.
Au sujet de l’Europe, vous faites référence à Considérations actuelles sur la guerre et la mort, de Freud, qui parlait à l’imparfait de l’Europe « musée ». Sommes-nous aveugles et coupables de vouloir vivre dans une Europe qui n’existe plus, en refusant de voir ce qu’il se passe ?
Jérôme Ferrari J’ai lu Histoire d’un Allemand, de Sebastian Haffner (2). Il faisait ses études au début des années 1930, a vu ses amis, issus d’une bourgeoisie conservatrice berlinoise, devenir nazis. Il a écrit: « Je possède un flair intellectuel assez développé ou, autrement dit, un sens de valeurs (et des antivaleurs !) esthétiques d’une tendance ou d’une opinion humaine, morale ou politique. (…) En ce qui concerne les nazis, mon nez n’hésita pas.» Et il est parti en Angleterre. Je ne suis ni prophète ni devin, mais, en ce moment, cela sent très mauvais. On est quasiment au moment marxiste où les superstructures ne correspondent plus à la réalité sociale. Peut-être qu’en France l’explosion de la droite et de la gauche, pour des raisons assez symétriques, est le signe de cette crise. Avec des choses inacceptables : être un homme politique, voir les tentations identitaires, le gros danger qui guette, et trouver que c’est une bonne idée d’en jouer, c’est criminel, indigne.
Dans l’Enracinement (1943), Simone Weil imagine ce que sera la République française, une fois la guerre terminée, et en élabore les principes fondateurs. Elle parle de la notion de proportion, particulièrement éclairante aujourd’hui…
Jérôme Ferrari L’Enracinement est un texte magnifique et politiquement très pertinent. Simone Weil pense qu’une société entièrement égalitaire est impossible et qu’il faut donc une correction proportionnelle des inégalités. Ceux qui ont des privilèges ont plus de comptes à rendre que les autres. Tout subordonné doit savoir que sa faute sera moins sévèrement punie que celle de son supérieur. Par exemple, il faudrait qu’un patron incapable ou coupable d’une faute envers ses ouvriers ait beaucoup plus à souffrir, dans son âme et dans sa chair, qu’un manœuvre incapable, ou coupable d’une faute envers son patron. Elle pointe aussi la responsabilité maximale incombant à ceux qui ont une charge publique. Elle décrit une situation tout à fait juste et à l’exact opposé de la situation réelle. Ce que dit Simone Weil devrait être les fondements de la vie politique.
Vous avez vécu et enseigné en Algérie et à Abu Dhabi, que vous a apporté cette expérience ?
Jérôme Ferrari Avoir vécu dans des pays arabes à majorité musulmane permet de faire l’expérience de la pluralité de l’islam, de constater que, de fait, c’est la version fondamentaliste qui tend à se répandre majoritairement. C’est inquiétant parce que cela tend à valider l’identification qui est faite ici entre islam et fondamentalisme. Je connais beaucoup de femmes musulmanes qui ne jugent pas abominable de sortir sans porter un voile. Ce n’est pas un impératif qui s’impose, c’est une certaine pratique de l’islam. Le problème du voile n’a aucun sens.
Avez-vous toujours écrit depuis la périphérie?
Jérôme Ferrari Oui. En tant que romancier, la multiplication des perspectives contradictoires est nécessaire pour saisir une complexité qui, aujourd’hui, n’est pas vraiment à l’honneur. Nous sommes tous prisonniers de dichotomies stupides et souveraines. Dans l’une de mes chroniques, je parle de l’analyse géniale que fait Schopenhauer dans l’Art d’avoir toujours raison. Je défends A et je fais en sorte que B soit inacceptable pour tout le monde. Donc si ce n’est pas B ce sera forcément A. C’est l’un des effets de rhétorique éristique (dans le débat) les plus employés aujourd’hui. Je cite deux exemples surutilisés par le premier ministre Manuel Valls d’une manière que je juge indigne. Vous êtes contre la déchéance de nationalité, donc vous ne voulez pas lutter contre le terrorisme. Vous ne soutenez pas la politique d’Israël, donc vous êtes antisémite. C’est une honte. C’est dangereux et contre-productif.
Le Cheval blême, de Boris Savinkov (1909), inspiré de la figure de Kaliaïev, le révolutionnaire russe qui a commis un attentat contre le grand-duc de Russie, est un livre très important pour vous. Sa problématique, reprise par Camus dans les Justes, est : le terrorisme peut-il avoir une justification éthique ? Comment lire ce roman aujourd’hui?
Jérôme Ferrari Camus reprend le sujet parce qu’il est fasciné, à juste titre, par l’enfer moral dans lequel se trouvent ces gens. Kaliaïev, dans sa conception de chrétien et de terroriste, sait que le meurtre demeure un péché mortel. Ce qui est magnifique, c’est qu’il ne pense pas qu’un péché cesse de l’être parce qu’il devient affreusement nécessaire. C’est le contraire du fait de se donner bonne conscience. Aujourd’hui, on est dans une vision comptable de la religion.
Vous citez souvent une famille d’écrivains qui vous sont chers, Savinkov, Dostoïevski, Styron, Bernanos. Qu’est-ce qui vous rattache à eux ?
Jérôme Ferrari C’est un penchant coupable pour le mysticisme. Je n’en connais pas l’origine car je ne suis pas croyant. Je pense que certains concepts religieux ont une pertinence en dehors de la croyance. Cette analyse du péché chez Kaliaïev me paraît très juste : une faute irrémissible dont on ne peut pas s’extraire. Pour Bernanos, je pense, comme beaucoup de gens, que les Grands Cimetières sous la lune est un monument à l’honneur du genre humain. Il écrit : « Il est dur de voir s’avilir ce qu’on était né pour aimer.» C’est la phrase la plus honnête, la plus admirable qui soit.
(1) « Au-delà de la haine, rien », Corse-Matin, 3 janvier 2015.
(2) Histoire d’un Allemand. Souvenirs 1914-1933. Actes Sud.
24 mars 2017
Interview de Jérôme Ferrari dans Libération:
Le Prix Goncourt 2012 s’interroge sur le décalage grandissant entre langage et réalité en politique. Et sur la contagion du cynisme et de la bêtise dans un monde qui n’admet plus que des raisonnements simplistes.
Rien ne lui ôtera son plaisir d’enseigner la philosophie à ses élèves de classe préparatoire et terminale. Pas même les trois heures de route à travers la Corse qui séparent Ajaccio de Bastia, où il alterne ses cours durant la semaine. Ni la littérature qui lui valut le prix Goncourt en 2012, pour le Sermon sur la chute de Rome (Actes Sud).
Jérôme Ferrari était de passage à Paris à l’occasion de la parution d’un recueil de chroniques publiées de janvier à juin 2016 dans le quotidien la Croix. Il se passe quelque chose est le titre donné à ces textes qui paraissent sous forme d’essai. Car on s’aperçoit au fil des pages que tout est lié par un regard critique constant posé sur l’usage du langage et le délitement des mots avec la réalité. L’occasion pour le romancier d’introduire Hannah Arendt, Simone Weil, Boris Savinkov ou Arthur Schopenhauer et de répondre à la prédominance des «passions tristes» chères à Spinoza : le ressentiment, la peur.
Durant six mois, il s’est permis de, sinon commenter et donner son avis personnel, du moins tenter de saisir l’actualité chaque semaine sans rien épargner ni personne. Un exercice auquel il s’était toujours refusé, assure-t-il, pour ne pas tomber dans la platitude ambiante des opinions qui ne font l’objet d’aucune élaboration critique. Mais c’était avant que le terrorisme, l’état d’urgence et la violence populiste ne plongent la France dans un climat nauséabond. L’écrivain et traducteur de langue corse ne s’étend pas, il va à l’essentiel, instinctif.
Vous n’étiez pas enthousiaste à l’idée de publier des articles dans un journal et pourtant vous semblez y avoir pris du plaisir. Comment l’expliquez-vous ?Il y a une contradiction que je n’explique pas. Avoir publié des romans ne confère aucune autorité pour juger du cours du monde. Mais en dehors de toute considération d’efficacité, il est des moments où se taire, quand on a le privilège de pouvoir s’exprimer, devient une faute. J’ai voulu y aborder des sujets métaphysiques sans sombrer dans l’invective hystérique, ni dans la cuistrerie. C’est un travail délicat et au rythme soutenu. Je crois que si l’on s’acharne, on court le risque de se forger au fil des semaines un avis sur tout et de se persuader de cet avis. Cette perspective m’épouvante.
Les politiques ont finalement réussi à vous faire sortir de vos propres convictions. Ce qui n’est pas une mince affaire…Depuis les attentats de Charlie Hebdo, notre classe politique témoigne d’une incapacité pathologique à agir et à penser. Ce qui me frappe et me désespère depuis des mois est la façon dont tous les débats sont pris au piège du principe de réduction dichotomique où les problèmes sont posés de façon à interdire toute réponse complexe.
Pensez-vous à une controverse en particulier ?Le débat sur la déchéance de nationalité, par exemple, a été posé en ces termes : «Etes-vous favorable à la déchéance de nationalité ou pensez-vous que les terroristes ne devraient pas être punis ?» Cette mesure réalise quand même l’exploit d’être à la fois douteuse sur le plan juridique et inefficace, pour ne pas dire contre-productive. Quoi qu’on pense, quoi qu’on dise, on est rejeté vers l’un ou l’autre des pôles extrêmes de l’alternative. Poser la question de cette manière, c’est tendre un piège auquel on ne peut échapper qu’en récusant la pertinence de l’alternative. Ce procédé, s’il n’est pas nouveau, je doute qu’il ait jamais été utilisé dans de telles proportions. Cette attitude fut accompagnée d’une réaction hostile envers les sciences sociales de la part des politiques - dont Manuel Valls n’est qu’un représentant. Il est mystérieux qu’on puisse confondre «expliquer» et «excuser», quoique cette confusion ne cesse d’être faite, voire revendiquée depuis les attentats. Je crains qu’elle semble être un symptôme du règne hégémonique de l’émotion. Que l’ancien Premier ministre la reprenne à son compte, en invalidant a priori tout travail universitaire, pire en accusant implicitement les chercheurs de complaisance avec les terroristes, est sidérant. On en vient à nier l’existence de contradicteurs de bonne foi, on criminalise le débat politique qui est réduit à une opposition binaire et radicale à laquelle il devient impossible d’échapper et dans laquelle l’espace du désaccord vital en démocratie se transforme en plaidoirie pour la bêtise.
Les scandales qui empoisonnent la campagne présidentielle aggravent ce climat…L’affaire Fillon en est évidemment un exemple. Quand j’entends dire qu’il est temps de passer à autre chose au prétexte qu’il faut discuter des programmes, je suis outré. C’est le rapport même des gens à la vie politique qui est en jeu, plus que la question de savoir si François Fillon a une morale ou non. Quoi qu’il arrive, il semble qu’il fera toujours au moins 17 % à l’élection présidentielle. Dans ce contexte, que devient la croyance en des principes et des idées ? Rien. Si la vie politique était dominée par les valeurs, alors pourquoi ce noyau dur qui persiste à soutenir François Fillon n’est-il pas allé voir ailleurs ? Le philosophe Clément Rosset soulève bien ce paradoxe : les sympathisants les plus enragés vis-à-vis de leurs positions sont ceux qui ne croient en rien.
C’était mieux avant ?Non. Durant l’Antiquité, les Grecs présentaient déjà la politique de façon très partisane. Les questions de rhétorique ont toujours fait partie des discours politiques. Cependant, un pas supplémentaire a été franchi ces derniers temps : le lien entre les mots et les choses s’est assoupli, voire il n’existe plus.
L’utilisation du langage tisse justement un lien entre vos chroniques…La diversité des sujets que j’ai abordés n’est peut-être qu’apparente car ces articles s’intéressent tous à un certain usage de la langue et, plus exactement, à la façon dont les mots perdent tout contact avec la réalité. Cette déconnexion pose un problème d’éthique et de politique auquel il n’est pas absurde qu’un romancier s’intéresse. L’expression de «faits alternatifs», utilisée par l’équipe de Trump, est la marque même de cette dangereuse évolution. Ce mépris de plus en plus assumé pour les faits rend l’exercice démocratique périlleux car il corrompt notre rapport aux choses.
Quel rapport entre politique et vérité ?La vérité ne doit pas être une norme directrice de l’action politique. L’inverse reviendrait justement à s’opposer à la démocratie. Mais pour discuter de ce qui doit être envisagé sur le plan politique, il est préférable de se mettre d’accord sur un noyau commun de faits. Une certaine adéquation entre la parole et le fait doit servir de support à la démocratie.
Les réseaux sociaux bouleversent cette adéquation…La transformation profonde des canaux de transmission a signé l’acte de divorce définitif entre les mots et le monde. Facebook, Twitter, tous ces modes de communication et d’expression polarisent de façon hystérique le débat en créant des lieux de grégarisation. A partir du moment où le slogan «je suis Charlie» a été partagé, plus aucun espace entre le soutien total, quelque peu ostentatoire, voire indécent au journal et la critique de sa ligne éditoriale a été impossible, rendant la moindre observation complice des terroristes. Cette dualité immodérée qu’impose un réseau social, ce fait de prendre nécessairement parti, constitue une entrave au débat.
Vous parlez de décomplexion pour décrire cette évolution…Jusqu’à une époque récente, des mécanismes d’inhibition pouvaient agir à tout moment pour empêcher d’aller jusqu’à dire des inepties, mais l’avènement de la décomplexion généralisée les a rendus inopérants. Il est sidérant que, lorsqu’une nouvelle information très compromettante sur un candidat à l’élection présidentielle paraît dans la presse, l’intéressé persiste et réponde : «Et alors ?» l’air de dire «oui, je suis un enfoiré, et alors ?» Voilà où nous en sommes. On pensait avoir tout connu avec Nicolas Sarkozy ou Jean-François Copé alors qu’en fait, ils n’ont fait qu’ouvrir la voie à leur ancien Premier ministre. Le pire, peut-être, étant que cette forme de décomplexion est travestie sous forme d’honnêteté. Avant, les journalistes qui n’avaient pas lu mon livre ne me l’avouaient pas. Dorénavant, on me prévient éhonté et souriant : «Je n’ai pas lu votre livre, je préfère vous le dire.» Le cynisme est manifeste, évident. Encore une fois, en matière de contagion de la bêtise, Internet a pulvérisé tous les records précédemment établis. Mais il faut toujours s’incliner devant les faits.
Recueilli par Cécile Daumas et Simon Blin Illustration Syvlie SerprixSource : http://www.liberation.fr/
Jérôme Ferrari :
"Il se passe quelque chose"
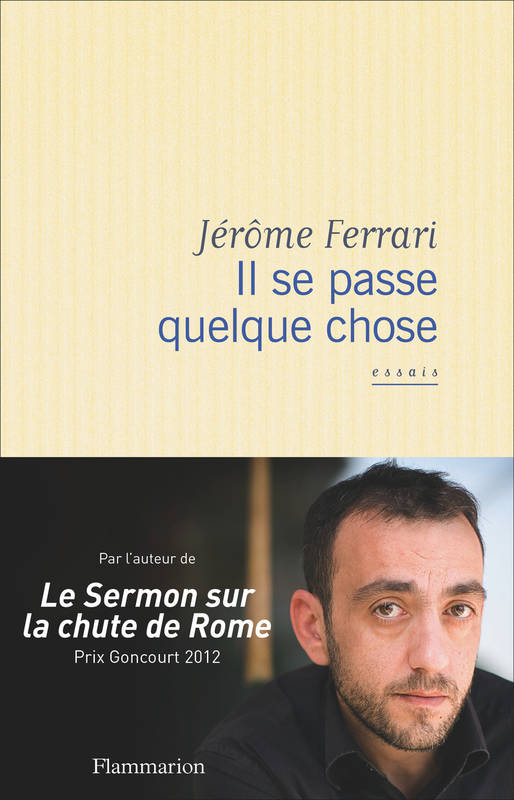
Réunies en recueil, voici les 22 chroniques rédigées par Jérôme Ferrari dans le journal La Croix entre janvier et juillet 2016. éminemment politiques, souvent très drôles, parfois appuyés sur la pensée de grands auteurs passés et présents, ces chroniques abordent des sujets divers, de la déchéance de nationalité à la liberté d’expression, de la réforme de l’orthographe à la rhétorique des hommes politiques.
Ce n’est qu’à distance, souligne Jérôme Ferrari en préface, qu’il a per�u ce qui faisait la cohérence de ses chroniques : elles « s’intéressent toutes à un certain usage du langage et, plus exactement, à la fa�on dont les mots perdent tout contact avec la réalité ».
On lit (ou relit) ces textes avec jubilation. Quel style ! Et quelle intelligence !
Le Principe

Avril 2015
Jérôme Ferrari sur Via Stella
Le principe : Jérôme Ferrari revisite le "principe d'incertitude" d'Heisenberg
Le huitième roman de Jérôme Ferrari, Le principe est sorti il y a quelques semaines, deux ans après son prix Goncourt. Un roman dont le titre se réfère au célèbre "principe d'incertitude" inventé par le physicien allemand, Werner Heisenberg (1901-1976), fondateur de la mécanique quantique.
Par Grégoire Bézie - 08/04/2015
Un petit livre de 160 pages et une gageure incroyable : embarquer le plus de lecteurs possible dans le monde très fermé de l'électron et de la physique quantique. C'est le pari de Jérôme Ferrari avec Le principe.
Le récit se déroule entre 1930 et 1946 quand l'Europe est en proie à la montée du nazisme, lors de la Seconde Guerre Mondiale.
Werner Heisenberg, personnage central du roman, pose les bases de la physique atomique qui rend la bombe envisageable, le célèbre principe d'incertitude. En 1932, il obtient le prix Nobel de physique. En 1933, Adolf Hitler a tous les pouvoirs ; les savants juifs quittent l'Allemagne et les non juifs avec eux.
Mais Heisenberg reste. Rien ne prouve qu'il renforcera les recherches nazies sur l'atome. Rien ne dit non plus qu'il les empêchera. Jérôme Ferrari joue avec cette "incertitude" et comme à son habitude, l'écrivain propose plusieurs niveaux de lecture pour comprendre l'Homme et le monde.
Jérôme Ferrari bientôt sur France 2...
Un reportage sur Jérôme Ferrari, tourné à la Librairie « Les Cordeliers » de Romans passera dans le courant du mois de juin, dans le cadre d'une série de documentaires consacrés à la culture diffusés en 2ème partie de soirée sur France 2.
... et dans Corse Matin

Février 2015

Près de trois ans après son prix Goncourt, Jérôme Ferrari reviendra en mars, toujours chez Actes Sud, avec un nouveau roman intitulé «Le Principe».
On sera cette fois-ci très loin des bars corses de son «Sermon sur la chute de Rome»: Ferrari s’intéresse au «principe d’incertitude» et à son père, Werner Heisenberg, fondateur de la mécanique quantique.
Il sera notamment question du rapport ambigu que Heisenberg entretenait avec le régime nazi. Le physicien, qui travaillait au programme nucléaire du Reich, a affirmé, après la guerre, qu’il était déterminé à le freiner s’il aboutissait.
Certains historiens mettent en doute la sincérité de ce «résistant passif» autoproclamé. D’autres le croient. Ferrari, qui a longuement enquêté, pourrait bien mettre fin à l’incertitude.


Le Sermon sur la chute de Rome
«The Sermon on the fall of Rome»

Pas de Femina pour Jérôme Ferrari... mais le Goncourt !

Dernier verre avant un prix
Par Robert Colonna d'Istria
Il se trouve que d’Abu Dhabi, où il est en poste depuis l’été dernier, le romancier philosophe originaire de Fozzano est venu quelques jours à Paris, non loin du quartier où se distribuent les plus hautes récompenses littéraires. Son livre figure précisément parmi les sélections des prix les plus prestigieux. C’était l’occasion de lui demander ce qu’il en pense, et de l’interroger sur la fin du monde, sur la Corse et sur d'autres sujets de moindre importance. Conversation avec Jérôme Ferrari
corsica : Assassinat, le meurtre d’Antoine Sollacaro, ou suicide collectif d’une société qui ne sait ni qui elle est ni où elle veut aller ?
Jérôme Ferrari : Chaque fois qu’un événement de cet ordre se produit, je me sens atteint et meurtri. Et j’ai l’impression qu’on ne s’en sortira pas. Comme beaucoup, je suis atterré, consterné. Cela n’a pas l’air de déboucher sur grand-chose. Je partage cette idée de « suicide collectif » et d’une Corse « qui ne sait ni qui elle est ni où elle veut aller ». C’est le constat le plus triste.
corsica : L’idée, l’obsession du retour chez tout Corse, qu’en pensez-vous ? Vous-même, êtes-vous concerné ?
Jérôme Ferrari : C’est un des plus vieux thèmes de l’histoire de la littérature, partir, revenir… En Corse, c’est une notion essentielle, pour ainsi dire constitutive de l’île elle-même. Bien sûr que je suis concerné ! Cela a été mon obsession, à peu près exclusive, jusqu’à ce que je puisse revenir en Corse. J’ai fait de ce « retour », au demeurant toujours couplé avec l’obsession de « départ », le thème d’au moins deux romans, Un Dieu un animal et Le Sermon sur la chute de Rome. Dans ce dernier livre les deux personnages, symétriques, sont en réalité les mêmes : il y a celui qui veut partir, et celui qui veut revenir…
corsica : Y aurait-il un absurde corse, au sens de l’absurde philosophique ?
Jérôme Ferrari : Je ne suis pas très sensible à la notion d’absurde. Mais je crois pouvoir dire que si l’idée d’un absurde métaphysique veut dire quelque chose, alors un absurde « corse » ne veut rien dire parce que l’absurde concerne la condition humaine et pas particulièrement la Corse. Mais je préfère la notion de tragique. C’est Nietzsche, je crois, qui l’a définie comme le fait de « ployer sous un fardeau qu’on ne peut ni porter, ni rejeter »…
corsica : On disait volontiers que La Renfermée, la Corse, ouvrage détonant et courageux de Marie Susini, ne correspondait plus à la réalité d’aujourd’hui. Est-ce si sûr ?
Jérôme Ferrari : Je n’ai pas lu le livre de Marie Susini.
corsica : Finalement, à quoi correspond votre passé de militant nationaliste corse ?
Jérôme Ferrari : Il est difficile de répondre à cette question. Rétrospectivement, mon engagement semble avoir correspondu à une nécessité. Je n’ai pas l’intention de le renier. Il a été la traduction de quelque chose, quelque chose d’important à un moment donné. Le désir, sans doute, et entre autres, de prouver que je faisais partie de cette île, d’y jouer pleinement ma partie. Aujourd’hui, je ne me sens plus contraint à prouver quoi que ce soit.
corsica : Changeons de sujet. L’Europe, quand on a pris pied sur les rives du golfe arabo-persique, société décadente et triste, ou dernier rempart de l’esprit, de la qualité, du raffinement ?
Jérôme Ferrari : Ni l’un ni l’autre. Je n’ai aucune haine ni aucun amour exclusif pour l’Europe – et si c’était le cas, il aurait fallu que je sois masochiste pour demander ce poste aux Émirats. Et je ne crois pas que l’Europe ait le privilège de l’esprit. Il y a beaucoup de projets culturels importants à Abu Dhabi. Le monde est toujours un peu moins simple que ce qu’on s’en imagine, et c’est pour ça qu’il est intéressant.
corsica : L’effondrement su système financier qui porte le monde économique depuis quelques décennies, naufrage qui va tout emporter ou chance d’enfin pouvoir repartir d’un bon pied ?
Jérôme Ferrari : Mes connaissances en économie sont à peu près égales à zéro… Je ne me fonde donc que sur des informations générales… Je n’ai pas l’impression que le monde occidental se vit comme un ensemble qui va repartir du bon pied… J’ai l’impression qu’il y a beaucoup d’inquiétude, de nostalgie, de pessimisme, le sentiment qu’on arrive au bout de quelque chose. Ça se perçoit très bien dans les romans contemporains, à commencer par les miens.
corsica : Mauvaise gestion de jeunes gens inexpérimentés, la débâcle des personnages de votre dernier roman, qui ont voulu reprendre le bistrot du village de leurs origines, ou bien fin d’un monde où l’homme avait encore un peu d’importance ?
Jérôme Ferrari : Le roman est construit sur des mécanismes qui ne sont absolument pas psychologiques. L’enchaînement des choses ne dépend pas de l’action des personnages, qui sont les jouets de phénomènes qui les dépassent… S’il s’agit de la fin d’un monde, celui qui disparaît ne me semble pas se caractériser par le fait que « l’homme avait encore un peu d’importance ». C’était un monde cruel, dur, que beaucoup voulaient quitter. Si j’en crois ce que disaient mes grands-parents, personne n’avait l’impression d’habiter un éden. Ils n’étaient pas nostalgiques.
corsica : Admettons que la civilisation n’ait été qu’une parenthèse, ouverte avec la révolution néolithique et fermée avec la révolution industrielle - cette définition en vaut d’autres… Quelle place méritent les prix littéraires dans la déréliction qui a suivi la chute ; sont-ils une résistance de l’esprit, ou un signe, au contraire, d’une catastrophe fatale ?
Jérôme Ferrari : C’est un phénomène complexe. Il y a bien sûr une logique économique mais c’est en même temps cette logique qui permet que la littérature, une fois par an, soit sous les feux de l’actualité. Que révèlent-ils, ces prix ? Une corruption de la littérature par l’esprit marchand ? Ou bien constituent-ils un utile moyen d’élever la littérature vers le public, et donc de la faire vivre ?
Corsica : Si on vous demandait votre avis, quel prix aurait votre préférence ?
Jérôme Ferrari : Permettez-moi, à la veille de la distribution des prix, de ne pas répondre à cette question… Si j’avais un prix, quel qu’il soit, je serais content…
corsica : Que seriez-vous prêt à sacrifier pour obtenir le Goncourt ?
Jérôme Ferrari : Rien. Ni pour avoir le Goncourt, ni pour avoir davantage de lecteurs. J’ai la chance de pouvoir écrire les romans que j’ai à écrire, que ces romans soient publiés, lus, et donc de ne rien sacrifier du tout…
corsica : Qu’est-ce qui vous paraît le plus important, devenir riche ou célèbre ?
Jérôme Ferrari : Si un romancier vous répondait l’un ou l’autre, il faudrait lui conseiller de change de métier… L’important, encore une fois, c’est d’avoir le luxe de publier des livres et de rencontrer des lecteurs. La célébrité comporte, je suppose, pas mal d’inconvénients ; elle agace beaucoup de monde, et je n’arrive pas à imaginer quel genre de satisfactions elle peut procurer.
Robert Colonna d'Istria
WWW.CLUB-CORSICA.COM
Copyright Corsica

U premiu Goncourt à Jérôme Ferrari
Jérôme Ferrari hè statu laureatu di u premiu Goncourt 2012. Sta marca di stima hè una vittoria literaria per a Corsica. Cun stu scrittu di Ghjacumu Fusina, l’Adecec rende omagiu à u laureatu :
Vistu a quantità d’articuli di prisentazione bona di l’ultimu libru di Jérôme Ferrari, tantu in a stampa naziunale chè quella lucale, senza scurdassi di u furore scatinatu di i bloghi d’Internet, ùn m’hè mancu venuta à l’idea di aghjunghjemi à u core di tante lode : mi sò cuntentatu di cumprà è di leghje cun piacè u Sermon sur la chute de Rome. D’altronde m’era assai piaciutu Où j’ai laissé mon âme esciutu in u 2010 è ne avia scrittu una cronaca assai pusitiva in corsu pè u settimanale La Corse (« Anima à l’addisperu ») è a so versione in francese pè u situ Musanostra. Dicia digià eo tandu : « opera cumpita assai, tondula è chjosa cum’è una tragedia classica, cù a so messa in scena travagliata fine, a so lingua tagliva è ghjusta, duv’ellu dimostra l’autore una bella maturità ammaistrendu in modu raru un sugettu quantunque cumplessu ».
Mi si pare d’avè vistu cusì l’essenziale, avendu capitu ch’ella era in traccia d’edificassi tandu un’opera intera di qualità : hè cusì chì u premiu Goncourt chì l’hè statu attribuitu cù u so Sermone di quist’annu mancu m’hà smaravigliatu tantu, postu ch’ellu si trattava non solu torna d’un travagliu assestatu benissimu cù una scrittura persunale piacente è leghjitoghja, di stile à listessu tempu appimpatu è abbastanza amudernatu pè u publicu largu ch’ellu suppone u premiu maiò di a literatura francese. In quant’à u sugettu, diceraghju chì a storia scelta ch’ellu arremba à un caffè di paese ripigliatu da dui giuvanotti corsi in cerca d’assulutu, à mè ùn mi paria micca un sprupositu d’imaginazione, vistu ciò ch’o sapia di l’opere digià publicate è di u clima particulare ch’elle purtavanu une poche di e prove di a nova literatura corsa. Un credia mancu chì a spezia d’esutisimu ch’ellu pudia mandà un sugettu simile à una ghjuria parigina pudessi esse ricevuta benissimu : d’altronde ind’una intervista recente, Ferrari palisava ellu stessu listessu timore chì li si paria ch’ellu fussi più adattu u sugettu precedente chè quellu di quist’annu pè un cuncorsu simile. Ma pensu ch’ella hà ragiunatu a ghjurìa cù a visione d’un’opera generale più chè cù quella d’un rumanzu solu è hà avutu a ragiò.
A riescita di Ferrari hè difatti quella d’un cumpunimentu à parechji gradi duv’ellu riprisenta l’ultimu libru un incurunamentu pè l’inseme di l’altri. Da issu puntu di vista si pò dì chì u Goncourt hà distintu una literatura corsa di spressione francese chì pare d’avè trovu u livellu aspettatu da tanti anni : Ferrari hè un giuvanottu mudestu, cultivatu è travagliuscu chì hà sappiutu mette in valore non solu un decoru paisanu isulanu, cuntegni è manere nustrali, mitifichenduli una cria in una finzione assestata cumu si deve, aghjunghjenduli issu zinzicu di filusufia alta chì ne impone sempre à ogni lettore. U famosu « Sermone » d’Augustinu hè un testu anticu cunnisciutu da i sperti chì sanu ch’ellu ragiunava quellu nant’à a caduta à a longa d’ogni putenza creduta, fussi a Roma eterna di a storia. Purtendulu quì nant’à un caffè d’un paisolu corsu è i so persunaghji vani, Ferrari facia una scumessa risicata è di sicuru una cria artificiosa, ma viaghja cusì a finzione literaria : ùn ci vole forse micca sempre à misuralla à e nostre realità cutidiane.
Rallegremuci tutti di issa vittoria literaria, chì ci permette di mustrà di a Corsica altre cose chè ciò ch’ella mostra pè u più, sapendu ch’ella hè u risultatu di u travagliu persunale d’un giuvanottu attalentatu assai, è d’una casa d’edizione Actes Sud chì sà prumove cumu si deve i so autori. Un credu micca ch’ella venga a riescita da u rimusciu solu ch’ellu pò fà un publicu di lettori ammirativi cum’è quellu di i sustenitori di e squatre di pallò. Ramintenduci dinù chì u primu premiu Goncourt fubbe datu in u 1903 à u rumanzu Force ennemie di John Antoine Nau chì stete dinù ellu qualchì tempu in Portivechju è li piacia assai dinù à ellu di viaghjà luntanu è di spustà locu à spessu.
Ghjacumu Fusina (nuvembre 2012)
Source : Nutiziale culturale di l'Adecec
Reproduit avec l'autorisation de l'auteur.
Goncourt : Ferrari sacré pour son "Sermon"
Jérôme Ferrari en était convaincu : ce roman allait entraîner sa chute - littéraire s'entend. "Je l'ai écrit consciemment, consciencieusement, en pensant que j'allais à la dégringolade", confie-t-il au Monde. Son précédent livre, Où j'ai laissé mon âme (Actes Sud 2010), suffocante et superbe évocation de la guerre d'Algérie, lui avait valu, entre autres, le prix France Télévisions et une reconnaissance critique et publique relativement large.
Jérôme Ferrari se disait que personne ne le suivrait depuis les caves algéroises où deux officiers français se perdaient en pratiquant la torture, vers le bar corse dont il voulait faire le décor du Sermon sur la chute de Rome." Je pensais que le roman serait un échec, mais j'étais prêt à l'affronter", dit l'écrivain de 44 ans. Ce septième livre lui a, au contraire, permis d'obtenir le prix Goncourt, le deuxième attribué à l'éditeur Actes Sud, par cinq voix contre quatre à Patrick Deville pour Peste & Choléra (Seuil). Etaient également finalistes Linda Lê (Lame de fond, Christian Bourgois) et Joël Dicker (La Vérité sur l'affaire Harry Quebert, De Fallois/L'Age d'homme).
Au centre du Sermon sur la chute de Rome se trouve donc un modeste bistrot de montagne, repris par deux jeunes gens du coin, qui abandonnent leurs études de philosophie à Paris pour édifier là, entre zinc et banquettes, "le meilleur des mondes possibles" cher à Leibniz. L'histoire des personnages, Matthieu et Libero, jusqu'à la destruction de leur univers miniature, s'entremêle avec le souvenir de l'empire colonial français qu'a connu le grand-père du premier avant de revenir ruminer ses échecs au village, ainsi qu'avec des passages sur la chute de Rome en 410, telle qu'évoquée par saint Augustin. Ces fils narratifs se tissent entre eux grâce à une phrase tirée des sermons de l'évêque d'Hippone : "Le monde est comme un homme : il naît, il grandit et il meurt."
Une écriture d'une ample beauté
Ce livre sur la finitude de toute chose organise ainsi la collision romanesque entre le quotidien d'un bistrot (jolies serveuses, beuveries, parties de cartes, défis en virilité...), la philosophie (saint Augustin versus Leibniz) et un pan de l'histoire coloniale. Cela aurait pu être absurde et indigeste - pompeux aussi. Le Sermon sur la chute de Rome est au contraire intelligent, sombre et drôle. Aussi caustique que dense.
Sans aucun doute grâce à l'écriture étonnante de Jérôme Ferrari, d'une ample beauté jamais académique, à ses phrases admirablement longues qui peuvent tout se permettre, la solennité comme l'ironie, la cocasserie comme la puissance, et qui l'autorisent à embrasser tous les sujets.
Celui qui commençait le très singulier Un dieu un animal (Actes Sud, 2009) en affirmant "Bien sûr, les choses tournent mal" s'amuse et s'étonne qu'elles aient si bien tourné pour lui, cette fois-ci. Il cite en riant le texto que lui a adressé une éditrice d'Actes Sud quand est parue la dernière liste de romans en lice pour le Goncourt : "D'accord, les mondes meurent, mais entre-temps..." Entre-temps, il n'est pas interdit d'en profiter.
Entre-temps aussi, comme Jérôme Ferrari l'écrit dans le Sermon..., "toutes nos vies sont parsemées de cadavres de mondes trahis". Il précise, quand on l'interroge, que le verbe trahir ne comporte en l'occurrence "aucune dimension morale" : "Cela signifie seulement que l'on passe sans cesse d'un monde à l'autre, en faisant des choix."
Lui-même a construit sa vie sur une succession de bifurcations. Né en 1968 en région parisienne, dans une famille corse qui retournait sur l'île à chaque vacance ou presque, il s'y installe pour de bon en 1988, maîtrise de philosophie en poche. Il fréquente avec enthousiasme la mouvance indépendantiste, avant de choisir la rupture, puis d'être envoyé au service militaire - "une époque où la lecture était ma seule joie", dit cet amoureux de Dostoïevski.
Devenu professeur de philosophie sur l'île, il change de cap en 2003, et part enseigner au lycée français d'Alger. Après un bref retour en Corse, il repart, direction l'émirat d'Abou Dhabi, où il est, depuis la rentrée, professeur de philosophie et conseiller pédagogique au lycée français. Ce nouveau départ a coïncidé avec la parution du Sermon..., et le début du tourbillon que celle-ci a immédiatement déclenché - le roman ayant été remarqué et salué dès sa parution comme l'un des meilleurs de la rentrée littéraire (Le Monde des livres du 23 août) : "Je pense, dit-il, qu'il a été sain pour moi d'être loin, de devoir organiser mon installation, corriger des copies..."
L'île de Beauté pour épicentre
Plus largement, ce que l'écrivain professeur aime dans la vie à des milliers de kilomètres de chez lui, c'est "le sentiment d'étrangeté, la possibilité de [se] sentir à la périphérie". L'exploration de possibles qui lui seraient autrement inaccessibles. C'est aussi, bien sûr, cela qu'autorise la fiction - élaborer des mondes, les habiter, en changer... Jérôme Ferrari construit ainsi une oeuvre littéraire ayant l'île de Beauté pour épicentre, où se côtoient le tragique et le grotesque, et dont les personnages ressurgissent subrepticement d'un texte à l'autre, inversant les perspectives, tandis que l'auteur évoque leurs espérances déçues.
Que les siennes, concernant l'accueil du Sermon, aient été plus que comblées - avant le Goncourt, 85 000 exemplaires du roman s'étaient déjà écoulés, selon Actes Sud - ne lasse pas d'étonner Jérôme Ferrari. Il y voit un phénomène "qui relève de l'aléatoire pur", la rencontre fortuite entre le thème de son roman et un air du temps obsédé par la fin du monde - au sens apocalyptique du terme - qui n'est pas son sujet.
Du Goncourt, il veut d'abord retenir, assurait-il mercredi soir, "la dimension de réussite collective" ; il se dit "content de pouvoir rendre quelque chose à Actes Sud qui [lui] a beaucoup donné". Emu de voir tant de monde, contre toute attente, se presser sur les banquettes de son drôle de bistrot.
LE MONDE le 08.11.2012
Par Raphaëlle Leyris
Prix Goncourt für Jérôme Ferrari
Der aus Korsika stammende Philosophie-Lehrer erhält den wichtigsten französischen Literaturpreis
Jérôme Ferrari stand in diesem Jahr auf fast allen Shortlists der großen französischen Literaturpreise. Nun erhält er für seinen sechsten Roman "Le sermon sur la chute de Rome" den wichtigsten Preis, den das literarische Frankreich zu vergeben hat. Barbara Wahlster stellt den 44-Jährigen vor.
Frei übersetzt bedeutet der Titel von Ferraris Buch in etwa "Der Eid auf den Niedergang Roms" - und stellt somit die Verbindung zum Heiligen Augustin dar, der im Jahr 410 den Römern geschworen hatte: "Die Welt ist wie ein Mensch: Sie wird geboren, sie wächst und sie stirbt."
Im Zentrum der Handlung steht ein junger Korse, der sein Studium aufgibt, um gemeinsam mit einem Jugendfreund eine Bar in einem korsischen Dorf zu übernehmen. Die beiden wollen aus der Kneipe "die beste aller möglichen Welten" machen, jedoch werden sie ziemlich schnell von Enttäuschungen und Streitereien eingeholt. Ferrari habe durch seine Sprache und durch seinen Stil überzeugt, befand die Jury in ihrem Urteil.
Ferrari hat Philosophie studiert und ist derzeit als Lehrer in Abu Dhabi beschäftigt. Der jetzt ausgezeichnete Roman, rund 200 Seiten stark, sei sein sechster, ein siebter sei bereits fertiggestellt, berichtete Barbara Wahlster, Literaturkritikerin von Deutschlandradio Kultur. 1968 geboren, gehöre Ferrari zu jenen französischen Autoren, die in den letzten Jahren entdeckt hätten,
"was dieses große 20. Jahrhundert eigentlich an Traumata in sich birgt, an Schuld in sich birgt, an Nicht-Ausgesprochenem in sich birgt. Wir kennen das ja zum Teil ein bisschen, die deutsche Seite der Aufarbeitung oder des Versuchs zu verstehen, was da war. In Frankreich ist es wirklich diese jüngere Schriftsteller-Generation, die sich jetzt in den letzten Jahren damit befasst hat."
Ferrari, so Wahlster, interessiere sich für die "Verflüchtigung von Sinn" und für die "Brüchigkeit der Welt ohne Bewusstsein davon". Immer wieder würden die Kriege thematisiert, die Frankreich im 20. Jahrhundert geführt habe, vom Zweiten Weltkrieg, über den Indochina-Krieg bis hin zum Algerien-Krieg. Im Interview habe ihr Ferrari gesagt:
"Fast könnte man sagen, ich bin besessen vom Verhältnis der Menschen zum Krieg. Es taucht in vielen meiner Romane auf, auch aus familiären Gründen. Meine Großeltern sind um die Jahrhundertwende geboren und haben das gesamte 20. Jahrhundert erlebt, einige davon beständig im Krieg, weil sie in der Kolonialarmee waren."
Das vollständige Gespräch mit Barbara Wahlster können Sie mindestens bis zum 06.05.2013 als MP3-Audio in unserem Audio-on-Demand-Player nachhören.
NOTE du webmaster :
Le titre du livre, traduit en allemand, n'est pas "Der Eid auf den Niedergang Roms" mais serait plutôt "Der Predigt auf den Niedergang Roms". Ne pas confondre le sermon et le serment !
Plus loin dans le texte, il est écrit : “und stellt somit die Verbindung zum Heiligen Augustin dar, der im Jahr 410 den Römern geschworen hatte” Geschworen? Juré? Prêté serment? Non, c'est toujours d'un sermon qu'il est question. La journaliste a t-elle lu le livre jusqu'au bout ?
Jérôme Ferrari, 44 ans, Prix Goncourt 2012
Par Jean CROZIERJérôme Ferrari a été couronné, mercredi 7 novembre, par le prestigieux prix Goncourt pour son roman Le Sermon sur la chute de Rome (Actes Sud), qui fait d'un bar corse l'épicentre d'une fable superbe sur les espérances déçues, les frustrations et l'inéluctable fugacité des mondes. Le lauréat, en lice pour la plupart des prix littéraires cette année, a été choisi au deuxième tour.
Né en 1968 à Paris, Jérôme Ferrari est professeur de philosophie et conseiller pédagogique au Lycée français d'Abou Dhabi depuis la rentrée, après avoir enseigné au lycée international d'Alger puis au lycée Fesch d'Ajaccio. Ce quadragénaire à la silhouette juvénile et au regard intense, qui refuse de se dire philosophe, a bâti en six romans une œuvre d'une grande puissance poétique, où alternent la spiritualité, le cocasse et le drame.
Plus encore que dans ses précédents romans, Dans le secret (2007), Balco Atlantico (2008), Un dieu un animal (2009) ou encore Où j'ai laissé mon âme (2010), Prix roman France Télévisions, l'auteur envoûte par la beauté de son écriture, à la fois imprégnée du souffle des sermons antiques et terriblement moderne. Le fameux sermon de saint Augustin a été prononcé en 410, dans la cathédrale disparue d'Hippone, devant des fidèles désemparés après le sac de Rome. Augustin les rassure : "Le monde est comme un homme : il naît, il grandit, il meurt." Ce seul passage et les têtes de chapitre du roman sont extraits du Sermon.
Le livre emporte le lecteur dans la montagne corse. Un vieil habitant, Marcel Antonetti, est rentré au village ruminer ses échecs. A la surprise générale, son petit-fils Matthieu renonce à de brillantes études de philo pour y devenir patron du bar du village, avec son ami d'enfance, Libero. Leur ambition ? Transformer ce modeste troquet en "meilleur des mondes possibles". Les débuts sont prometteurs. Mais bientôt l'utopie vire au cauchemar. Les ex-apprentis philosophes sont frappés par la malédiction qui condamne les hommes à voir s'effondrer les mondes qu'ils édifient.(Source: AFP)
Joie et émotion en Corse
L'attribution du prix Goncourt à l'écrivain corse Jérôme Ferrari a été accueillie avec joie et émotion mercredi dans les milieux littéraires et académiques insulaires. "C'est exceptionnel! C'est un acte fondateur pour la Corse, comme le fut, dans le domaine sportif, la participation de Bastia à la finale de la Coupe d'Europe de football, en 1978", a déclaré à l'AFP le libraire bastiais Sébastien Bonifay. Pour M. Bonifay, qui est aussi chroniqueur de l'émission Via Cultura de France3 Corse-Via Stella, Ferrari est "un écrivain à la carrière exemplaire, toujours à l'écart des coteries littéraires et qui exerce son métier de professeur de philosophie". Meilleure vente de la librairie "Les deux mondes" de Bastia, "Le sermon sur la chute de Rome" rend le "le public content car Ferrari raconte dans ce livre magnifique la Corse telle qu'elle est dans toute sa complexité". M. Bonifay a aussi félicité les éditions Actes Sud "qui ont toujours soutenu Ferrari" et qui "se battent dans un contexte difficile pour le monde de l'édition, sans jamais mettre un genou à terre devant les contraintes commerciales". Pour le journaliste et écrivain ajaccien Jacques Renucci "le talent de Jérôme Ferrari est d'atteindre l'universel à partir d'un environnement microcosmique". "Comme les grands écrivains américains, il entraîne le plus grand nombre à partir de ce qu'il se passe ici, réalisant la difficile synthèse entre identité, spécificité et universalité", a dit M. Rennuci à l'AFP. "Cela, a-t-il ajouté, nous valorise et nous rend humbles. C'est toute la différence entre les livres de Ferrari et Mafiosa", la série télévisée sur le milieu du grand banditisme insulaire. Le recteur de l'Académie de Corse, Michel Barrat, s'est aussi félicité de l'attribution du Goncourt au romancier insulaire. "C'est une très bonne nouvelle pour la Corse. Cela donne une image autre que celle de la violence et je suis très content que ce Goncourt soit attribué à un professeur", a déclaré M. Barrat à l'AFP. "Je connais bien Jérôme Ferrari qui a enseigné la philosophie au lycée Fesch d'Ajaccio. C'est un excellent professeur et un type bien!", a ajouté le recteur, lui-même ancien professeur de philosophie et insulaire par sa mère. "Cela montre que l'on peut être professeur et créateur et j'espère que cela va pousser les jeunes Corses à choisir les filières littéraires", a-t-il indiqué.(Source: AFP)
(France3 Info)
Jérôme Ferrari a été couronné, mercredi 7 novembre, par le prestigieux prix Goncourt pour son roman Le Sermon sur la chute de Rome (Actes Sud), qui fait d'un bar corse l'épicentre d'une fable superbe sur les espérances déçues, les frustrations et l'inéluctable fugacité des mondes. Le lauréat, en lice pour la plupart des prix littéraires cette année, a été choisi au deuxième tour.
Jérôme Ferrari a affirmé avoir ressenti "comme une chute de tension qu'on peut considérer comme une définition correcte de la joie". "Je suis heureux, notamment pour la maison qui me soutient depuis sept ans dans des conditions qui n'ont pas toujours été aussi favorables. Je n'ai pas encore mesuré ce que c'est", a-t-il déclaré. "Vous savez que Barack Obama a été élu aujourd'hui, vous ne manquez pas un peu de sens de la hiérarchie ?", a-t-il également lancé dans un sourire aux dizaines de journalistes qui l'assaillaient de toutes parts. Son ouvrage a jusqu'ici été vendu à près de 90 000 exemplaires, selon Actes Sud.
SOUFFLE DES SERMONS ANTIQUES
Né en 1968 à Paris, Jérôme Ferrari est professeur de philosophie et conseiller pédagogique au lycée français d'Abou Dhabi depuis la rentrée, après avoir enseigné au lycée international d'Alge,r puis au lycée Fesch d'Ajaccio. Ce quadragénaire à la silhouette juvénile et au regard intense, qui refuse de se dire philosophe, a bâti en six romans une œuvre d'une grande puissance poétique, où alternent la spiritualité, le cocasse et le drame.
Plus encore que dans ses précédents romans, Dans le secret (2007), Balco Atlantico (2008), Un dieu un animal (2009) ou encore Où j'ai laissé mon âme (2010), Prix roman France Télévisions, l'auteur envoûte par la beauté de son écriture, à la fois imprégnée du souffle des sermons antiques et terriblement moderne. Le fameux sermon de saint Augustin a été prononcé en 410, dans la cathédrale disparue d'Hippone, devant des fidèles désemparés après le sac de Rome. Augustin les rassure : "Le monde est comme un homme : il naît, il grandit, il meurt." Ce seul passage et les têtes de chapitre du roman sont extraits du sermon.
Le livre emporte le lecteur dans la montagne corse. Un vieil habitant, Marcel Antonetti, est rentré au village ruminer ses échecs. A la surprise générale, son petit-fils Matthieu renonce à de brillantes études de philo pour y devenir patron du bar du village, avec son ami d'enfance, Libero. Leur ambition ? Transformer ce modeste troquet en "meilleur des mondes possibles". Les débuts sont prometteurs. Mais bientôt l'utopie vire au cauchemar. Les ex-apprentis philosophes sont frappés par la malédiction qui condamne les hommes à voir s'effondrer les mondes qu'ils édifient.
Le Monde - 08/11/2011
Ferrari, un Goncourt surprise, mais très mérité
Par Christophe Ono-Dit-Biot
L'écrivain est récompensé pour son "Sermon sur la chute de Rome". Le Dr Jekyll de la littérature mélange le pastis à la philosophie.
À 44 ans, cet écrivain et traducteur, qui fut professeur au lycée Fesch d'Ajaccio, décroche le plus prestigieux prix littéraire français pour un livre qui traite à la fois du destin d'un village corse vu depuis le bar, et de la mystique de saint Augustin.
"Les mondes passent, en vérité, l'un après l'autre, des ténèbres aux ténèbres, et leur succession ne signifie peut-être rien." Voici LA curiosité de la rentrée. Le cinquième roman d'un écrivain de 44 ans déjà distingué, mais en voie de mise sur orbite, et qui semble avoir écrit son dernier livre comme un Dr Jekyll maniant ses éprouvettes. Plus précisément comme on fabrique une chimère, au sens où l'entendaient la mythologie ou la biologiste Nicole Le Douarin : un monstre, composé de deux éléments a priori inconciliables. La chimère conçue en 1969 par l'académicienne provenait d'une greffe de cellules de caille sur des embryons de poulet. Chez Ferrari, la chimère est un roman où le destin d'un village corse est scruté à la lumière des célèbres sermons prononcés en 410 dans la cathédrale d'Hippone par saint Augustin, pour consoler ses ouailles au moment où les Barbares d'Alaric déboulonnent l'Empire romain. "Dieu n'a fait pour toi qu'un monde périssable, et tu es toi-même promis à la mort." Voilà pour le concept.
S'il n'y avait que cela, on se serait lassé assez vite : pas besoin de convoquer Augustin - omniprésent dans le roman, en personne ou via un subtil jeu de clins d'oeil - pour nous convaincre que tous les empires meurent. Mais voilà : Ferrari a la maîtrise de ses deux sujets (il est agrégé de philosophie et a la Corse dans le sang), l'écriture magique et le sens des personnages. Un frère et une soeur : Matthieu et Aurélie Antonetti, persuadés d'avoir réalisé leur rêve. Le frère a abandonné ses études de philosophie à Paris pour revenir en Corse reprendre avec son ami d'enfance (ex-spécialiste d'Augustin) la gérance du bar du village où il a grandi, pour y bâtir, selon la formule de Voltaire se moquant de Leibniz, "le meilleur des mondes possibles". Le pastis, la charcuterie de premier choix et une ex-pute du cru en font bientôt la source à laquelle toute la région vient boire. La soeur, archéologue tendance missionnaire, prétend, elle, "ramener à la lumière les vestiges enfouis" (notamment à Hippone...). Vaine quête. Comme celle de leur grand-père, qui a passé sa vie à courir après l'Histoire sans jamais la rattraper, et dont la mort ne veut même pas.
Qu'est-ce qu'une vie ? Pourquoi on la rate ? Peut-il même en être autrement ? s'interroge ambitieusement Ferrari, porté par une plume aussi mystique qu'animale, constamment balancée entre élans méditatifs et saillies très crues, et la conviction qu'on finit toujours par se prendre méchamment dans la figure la porte du réel. On aime sa gravité apocalyptique, la candeur de martyrs de ses héros enfantins, leurs rêves de pureté même quand ils couchent avec leurs employées sexy, leur idéal d'un monde utopique, sans Barbares, alors que ces derniers finissent toujours par surgir et mettre le feu, prendre les filles, sortir l'épée ou le couteau de chasse pour émasculer les princes. En 410 comme en 2012.
Le Point.fr - 07/11/2012
A lire également, la lecture croisée du Sermon sur la chute de Rome, de l'Ultimu et de Murtoriu, sur Invistita.

23/12/2012
Jérôme Ferrari : « J'aime appartenir à plusieurs mondes »
Propos recueillis Par Hélène Romani
Photo Jean-Pierre Belzit
De retour des Emirats arabes unis où il enseigne désormais, l'auteur du Sermon sur la chute du Rome, auréolé du Prix Goncourt 2012, se livre sans faux fuyants.
De la chute de Rome à une gloire qu'il partage désormais avec toute la Corse dont il est originaire , le parcours d'un écrivain placé sous la protection de Saint-Augustin. à chacun son auréole : lui, c'est le Goncourt au prix d'un sermon.
Saint Augustin, pourquoi lui?
Je ne connaissais pas le sermon, seulement les Confessions qu'on travaille en philosophie. Je suis trèEt êtes-vous personnellement intervè J'avais plusieurs idées flottantes cristallisées par une phrase de saint Augustin et une photo de famille. Et j'ai pillé les récits de guerre de mon grand-oncle Antoine. Mais pour moi, revenir avec l'histoire d'un bar corse en y ajoutant saint Augustin, ce n'était pas gagné...
Pas de grand prix de l'Académie française, pas de Femina. Chaque désillusion ouvrait pourtant un nouvel espoir...
J'étais à Abou Dhabi, ça m'a simplifié les choses. La distance géographique aide à la distance psychologique. Pour avoir une chance d'obtenir le Goncourt, mieux vaut rater les choses avant. Mais on peut aussi tout rater.
Comment subissez-vous la pression médiatique?
Je n'étais pas sous pression tout le temps puisque je n'étais pas en France. J'étais tranquille. Mais il y a eu une montée en puissance. Quand je suis rentré à Paris, j'ai senti un changement. Je n'avais même plus le temps de lire.
Comment rester soi-même après une telle consécration?
Pour ce qui me concerne, rien n'est changé.
Il y a eu beaucoup de commentaires sur votre style. Votre avis?
Ce n'est pas à moi de tenir un discours sur ma manière d'écrire. J'ai un jugement artisanal. Quand on parle de style, on fait à tort une distinction entre le fond et la forme. Le fond nourrit la forme et inversement. J'ai l'impression d'obéir à une nécessité interne. Bien plus que le style, ce qui compte, c'est la singularité de ce qu'on écrit.
La comparaison avec Proust vous agace au lieu de vous flatter...
C'est une connerie monumentale. Faut ne jamais avoir lu Proust pour dire une chose pareille. Le fond de la comparaison, ce sont les phrases longues. Ce n'est pas une nouveauté extraordinaire de faire des phrases longues et ça ne qualifie pas un style.
Qu'avez-vous apporté de nouveau à l'enseignement de la philo?
J'essaie de faire mon travail correctement. Je n'ai pas de points de comparaison, je suis le seul prof de philo que je fréquente. Ma prof de philo de terminale a déterminé assez profondément ma manière de concevoir l'enseignement. Sans elle, je n'aurais pas eu envie de faire de la philosophie.
Vous seriez tenté par une définition philosophique de la notoriété?
La vulgarisation de la philosophie ne me plaît pas du tout. La philosophie est une discipline, ce n'est pas du coaching psychologique, ni une réflexion générale sur l'existence. Je suis d'un très grand classicisme.
Que peut-on savoir du Ferrari intime?
C'est comme pour le style, se définir soi-même est un exercice assez grotesque.
Le militantisme au sein de la famille nationaliste, c'est un passé révolu?
Je ne renie pas cette période, je l'assume et je peux l'expliquer. Le contexte a changé. Je trouve le romantisme de plus en plus dangereux.
Un attachement à la terre qui se conjugue avec le go�t de l'ailleurs...
Je suis binaire. J'aime appartenir à plusieurs mondes en même temps. La curiosité me pousse. Mais j'avais envie de fêter le Goncourt en Corse.
Et sur la manière de vivre avec la bonne fortune?
ça dépend absolument de soi, de la manière dont on gère le succès. Pour moi, c'est simple, je continue mon travail. Je ne change rien. Je fais plus de rencontres qu'avant. C'est une expérience nouvelle. On a quelque devoir vis-à-vis de ce qui s'est passé, car ce prix, on n'est pas obligé de l'accepter.
Quel accueil à votre retour aux Emirats Arabes Unis?
Un excellent accueil. Mes élèves ont mis en scène un bar corse dans la salle de classe et fixé des autocollants à tête-de-maure sur les murs, simulé des joueurs de belote. Ils pensaient que le Goncourt est récompensé par un chèque de 10 ?, et ils ont accroché une banderole disant : � à ce prix-là, mieux vaut faire du baby-sitting �.
L'enfance à Fozzano, encore la fin d'un monde?
Je vais y passer les fêtes. On a notre maison, la seule personne qui l'a habitée à titre permanent un moment, c'est moi, pendant deux ans, été comme hiver.
Vous en avez rêvé un jour de ce prix?
Non. Cela ne me paraissait pas une perspective raisonnable étant donné la manière dont se déroulait la fortune de mes livres depuis le début.
Le titre d'un ouvrage, ça compte?
J'ai toujours le titre en tête avant d'écrire, ça conditionne un peu la manière dont se construit le texte, ça me porte beaucoup.
Risquez-vous d'y perdre votre âme dans l'histoire?
J'espère que non. Abou Dhabi est une très bonne chose. Je n'y vis que depuis quatre mois, je suis encore dans le dépaysement. Je m'installe dans un nouveau poste, avec de nouvelles fonctions, dans un nouveau pays. Cela fait beaucoup de choses à penser. Je m'occupe de la formation des profs de philo sur plusieurs pays, toute la péninsule arabique et la péninsule indienne. Pour ce qui est de perdre mon âme, je ne m'inquiète pas. On peut avoir des surprises sur soi-même, mais je ne crois pas.
Que lisez-vous en ce moment?
Les deux derniers ouvrages que j'ai lus : Les œuvres de miséricorde de Mathieu Riboulet (prix Décembre 2012), et Peste et choléra de Patrick Deville (prix Femina).
Source: http://www.corsematin.com/article/jerome-ferrari-%C2%ABjaime-appartenir-a-plusieurs-mondes%C2%BB.852596.phpl
Publié sur Corse-Matin (http://www.corsematin.com)
Et voici le magazine Via cultura du 21 décembre :
http://corse.france3.fr/emissions/cultura
Jérôme Ferrari à la rencontre de ses lecteurs
L'écrivain Goncourt 2012 pour son dernier roman "Le Sermon sur la chute de Rome" est en Corse pour y rencontrer ses lecteurs. Il sera vendredi à 21h30 l'invité du magazine Via Cultura sur France 3 Corse ViaStella.
Par Grégoire Bézie

"Le Sermon sur la Chute de Rome" � ERIC FEFERBERG /AFP
Accueil triomphal pour le prix Goncourt 2012, de retour en Corse pour quelques jours et une tournée ! Cinq cents personnes se sont pressées mercredi soir au pied de la scène du théâtre de Bastia, pour une soirée événement organisée conjointement par la librairie Les Deux Mondes et la municipalité bastiaise. L'écrivain s'est prêté au jeu des questions-réponses avant une séance de dédicaces bien fournie.
Jérôme Ferrari a poursuivi sa tournée événementielle dans l'île en marquant l'arrêt à la Bibliothèque de l'Université de Corse le jeudi 20 décembre, pour une discussion ouverte. Vendredi 21 décembre, l'écrivain était également à la librairie La Marge à Ajaccio pour une séance d'autographes.
Jérôme Ferrari, invité de Via Cultura
L'écrivain a accepté d'être l'invité de l'émission Via Cultura, le vendredi 21 décembre, à 21h30 sur France 3 Corse ViaStella. Jérome Ferrari reviendra
sur le chemin parcouru depuis son premier opus "Variétés de la mort" paru en 2001 au sacre du "Sermon sur la chute de Rome", édité chez Actes Sud.
L'écrivain évoquera sa vision du monde et de la Corse et nous fera partager l'une de ses dernières expériences, scénariste. Jérome Ferrari a co-signé le
scénario d'un court-métrage, "Suis-je le gardien de mon frère", réalisé par Fréderic Farrucci.

Le Sermon sur la chute de Rome, de Jérôme Ferrari
Jérôme Ferrari est décidément - qui s'en plaindrait ? - très à l'honneur en cette période de rentrée littéraire. Plusieurs pages du Monde des Livres, un article dans Télérama, d'autres encore...
Extraits :
Drôle d'abîme.
Par Raphaëlle Leyris, LE MONDE DES LIVRES, 24.08.2012
Il n'est pas de petite allégorie pour un sermon puissant. Pas d'intrigue trop ténue pour un grand roman. Le Sermon sur la chute de Rome, de Jérôme Ferrari, est les deux à la fois, malgré un fil central qui pourrait sembler dérisoire. Il y est question du bar d'un village corse. De la manière dont Matthieu et Libero, des amis d'enfance, abandonnent leurs études de philosophie pour en reprendre la gérance. De leur certitude d'y créer "le meilleur des mondes possibles" cher à Leibniz - un monde fait de jolies serveuses, d'alcool et de charcuterie du cru. Très tôt, l'écrivain annonce que cela finira mal, par "une nuit de pillage et de sang", qui détruira ce que Matthieu tenait pour "le lieu choisi par Dieu pour expérimenter le règne de l'amour sur terre".
Les ex-aspirants philosophes se verront alors rappeler la leçon de saint Augustin, et de ses sermons sur la chute de Rome, en 410, dont l'évocation structure le roman (lire l'éclairage de Frédéric Boyer page 2) : il n'est pas d'empire qui ne soit mortel. Cela vaut pour la Rome du Ve siècle comme pour un univers aussi étriqué que ce bar de village du XXIe, avec ses parties de cartes où l'on plume les pigeons, ses coucheries médiocres et ses compétitions de virilité stupides. Cela vaut tout autant pour l'empire colonial français dont traite également Le Sermon, à travers un autre fil : la trajectoire de Marcel Antonetti, le grand-père de Matthieu, qui pensait vivre la grande aventure aux colonies, et n'y a connu que le pourrissement. Même pas celui de l'empire, à côté duquel il est passé ; seulement celui que la chaleur infligeait à la chair. Marcel est revenu au village ruminer ses échecs. C'est lui qui, malgré le mépris qu'il voue à son petit-fils, lui donne de quoi reprendre la gérance du bistrot. Pour se payer la joie mauvaise de voir sombrer l'univers d'un autre.
Les lecteurs qui avaient découvert en nombre Jérôme Ferrari avec le suffocant Où j'ai laissé mon âme (Actes Sud, 2010), seront peut-être surpris de le voir quitter les caves algéroises où des officiers français se perdaient en pratiquant la torture, pour gagner le zinc d'un bistrot et y arbitrer le match entre saint Augustin et Leibniz. Mais, au fond, Jérôme Ferrari, professeur de philosophie né en 1968, semble construire toute son oeuvre autour d'une phrase, la première d'Un Dieu, un animal (Actes Sud, 2009) : "Bien sûr, les choses tournent mal." Ce "bien sûr " l'annonce : il ne s'agit pas seulement pour l'écrivain de constater la mortalité des choses. Il faut en examiner les modalités.
Car il y a plusieurs manières d'aller vers l'inéluctable. Et si Matthieu fonce vers l'abîme yeux et oreilles fermés, si Libero le fait en donnant "un assentiment douloureux, total, désespéré à la stupidité du monde", la soeur du premier, une archéologue, incarne une face lumineuse du libre-arbitre cher à saint Augustin. Elle est "prête à assumer tous les échecs pourvu qu'ils fussent les siens". Elle n'a rien contre "l'irrévocable". Elle veut simplement décider de la forme qu'il prendra.
UN MODESTE BISTROT
La phrase extraordinairement travaillée et sinueuse de Jérôme Ferrari s'emploie à explorer les voies que chacun se choisit - plus admirable encore dans Le Sermon qu'elle ne l'était dans ses romans précédents. L'auteur la maîtrise à plein, aussi habile pour l'étirer dans toute sa puissance et sa gravité que pour la gonfler d'ironie, et jouer du contraste entre son déploiement solennel et une pointe finale parfois drolatique sur laquelle elle vient s'éteindre. Il la parsème d'incises qui peuvent embrasser plusieurs temporalités à la fois et semblent servir à rappeler la finitude de tous destins, à la manière des mouches sur les vanités de l'âge baroque.
Alors, vraiment, le meilleur roman de la rentrée littéraire pourrait avoir pour cadre un modeste bistrot ? Vraiment. Toute l'oeuvre de Jérôme Ferrari converge vers ses banquettes. Un café servait déjà de décor à Dans le secret (Actes Sud, 2007), qui s'interrogeait sur les destins que l'on se choisit en mettant en parallèle histoires de zinc et souvenirs coloniaux ; celui, précisément, du Sermon accueillait ses habitués dans Branco Atlantico (2008), qu'il faut lire pour savoir ce qui a rendu Virginie Susini, la fille de la propriétaire, si apathique et désespérée. Autre preuve de la cohérence du Sermon avec le reste de l'oeuvre "ferrarienne" : il est traversé par la silhouette d'André Degorce, l'un des deux officiers d'Où j'ai laissé mon âme, victime devenue bourreau, brisé par ses propres agissements. Il est le beau-frère et le modèle de Marcel Antonetti.
Convaincu que la fin est dans le début, Jérôme Ferrari construit ainsi un ambitieux cycle romanesque qui ne dit pas son nom, dont Le Sermon sur la chute de Rome constitue l'acmé. Il apporte la preuve que, non content d'être un auteur extrêmement original, il est un écrivain à la tête de son propre monde. Un monde minuscule et passionnant, hanté par des personnages dont la dimension tragique n'exclut pas le grotesque. Un monde voué à la destruction ? Forcément. Que cela ne vous empêche surtout pas de l'habiter pleinement.
Le Sermon sur la chute de Rome, de Jérôme Ferrari, Actes Sud, 208 p., 19 €.
Raphaëlle Leyris
Extrait
"(Aurélie) était venue embrasser les siens avant de partir, son grand-père surtout, et profiter de leur présence, et elle assistait tous les soirs après le dîner au numéro de Matthieu, car il était apparemment devenu obligatoire de faire une étape au bar et d'y boire un verre en famille, Matthieu venait s'asseoir à leur table, il parlait de ses projets d'animation pour l'hiver, des combines que Libero et lui avaient imaginées pour s'approvisionner en charcuterie, du logement des serveuses, et l'homme qui partageait alors, pour quelques mois encore, la vie d'Aurélie, semblait trouver tout cela passionnant, il posait des questions pertinentes, il donnait son avis, comme s'il lui fallait gagner absolument l'affection de Matthieu, à moins, comme Aurélie commençait à le soupçonner sérieusement, qu'il ne fût au fond un imbécile qui se réjouissait d'avoir trouvé un autre imbécile avec lequel il pouvait proférer à l'aise toutes sortes d'imbécillités."
Le Sermon sur la chute de Rome, pages 88-89
30 octobre 2012
L'écrivain corse Jérôme Ferrari fait partie de la liste des quatre finalistes toujours en lice pour obtenir, la semaine prochaine, le prix Goncourt 2012, le plus prestigieux des prix littéraires français.
Le sermon sur la chute de Rome (Actes Sud) est ainsi en compétition avec Peste et choléra de Patrick Deville (Seuil), La vérité sur l'affaire Harry Québert de Joël Dicker (Fallois) - déjà primé par le jury du prix de
l'Académie française - et Lame de fond de Linda Lê (Christian Bourgois).
Le jury du Goncourt a fait connaître son ultime sélection depuis Beyrouth, où se déroule le Salon du livre francophone. L'Ajaccien Jérôme Ferrari pourrait également être couronné le 5 novembre par le Femina. Il figure également dans la dernière liste de l'Interallié, décerné le 14 novembre

Rencontre. Jérôme Ferrari: la littérature, "meilleur antidote à la bêtise"
LE MONDE DES LIVRES du 24.08.2012
Par Jean Birnbaum
La bêtise est une force spirituelle. Elle n'a guère à voir avec l'ignorance : certains de ses fidèles les plus zélés ne sont-ils pas des puits d'érudition ? La bêtise relève plutôt d'une perversion de la conscience : un mélange de désinvolture morale et de dégoût vigilant, qui conduit à haïr la liberté. Sans cesse les imbéciles se défilent, partout ils refusent de faire face. Une chose et une seule suscite leur mobilisation : la guerre à l'intelligence. Quand il s'agit d'en finir avec l'esprit critique, la bêtise devient légion métaphysique et matérielle, appuyée par d'innombrables soldats, vieux briscards ou engagés de la dernière heure... Cette lutte à mort traverse toute l'oeuvre de Jérôme Ferrari. Dans son nouveau roman, Le Sermon sur la chute de Rome, elle se trouve orchestrée avec souffle, loyauté et humour, à la manière des contes voltairiens et des chansons de Brel.
La médiocrité comme exaltation mystique, comme rage spirituelle, c'est Bernanos qui en fit pour de bon une affaire d'écrivains. "La colère des imbéciles remplit le monde", résumait-il. En allant à la rencontre de Jérôme Ferrari, nous brûlions donc de lui poser la question : et Bernanos dans tout ça ? "C'est drôle, a-t-il répondu, je ne l'avais jamais lu, mais je viens de le découvrir cet été. Et je comprends pourquoi ses livres me touchent : il ne fait pas de psychologie, chez lui la bêtise comme le péché sont des concepts métaphysiques. Il montre bien l'aspect routinier, non brillant, du Mal : ton péché n'est même pas original, dit-il, tu ne fais que feuilleter un livre aux pages pleines de graisse, déjà tournées mille fois !"
Il en va ainsi du train-train abject qui rythme la vie du bar créé par Matthieu et Libero, les deux jeunes héros du Sermon... Ce qui se joue là, ce n'est pas seulement la fin du monde au quotidien, autrement dit l'accumulation des rendez-vous manqués, des espérances déçues. C'est aussi la confrontation entre deux places fortes : d'un côté, "la citadelle de l'Esprit-Saint", essentiellement défendue par des femmes, à commencer par la figure d'Aurélie, anthropologue et grande soeur de Matthieu ; d'un autre côté, "la citadelle imprenable de (la) bêtise", laquelle se confond avec ce bistrot que les deux jeunes Corses veillent à protéger de tout contact avec l'esprit. "A travers ces personnages, précise Ferrari, j'ai voulu marquer deux attitudes différentes vis-à-vis de la bêtise. Pour Libero, c'est quelque chose d'explicite, il considère qu'il vit dans un monde où il n'y a plus de place pour la pensée ; pour Matthieu, c'est moins réfléchi, la bêtise est une chose qu'il aime spontanément..."
Ces deux postures, Jérôme Ferrari confie les avoir lui-même vécues. D'expérience, il sait que la bêtise n'est "pas un camp extérieur à soi", mais une démission intime, qui nous menace tous à chaque instant. Pour lui, le moment périlleux fut celui des 20 ans. Installé en Corse après une maîtrise de philosophie, ce Parisien de naissance s'enflamme pour le nationalisme et devient rédacteur dans un journal indépendantiste. Avec le recul, il évoque cette période comme celle du conformisme discipliné : "Pendant deux ans, j'ai eu le sentiment d'appartenir à un troupeau et rien ne me faisait plus plaisir ! Plus le temps passait, plus mon écriture se transformait en bouillie infâme. Ça s'est mal passé, et heureusement : ceux qui ont continué ont parfois mal fini... Je pense d'ailleurs que la pérennité du nationalisme corse, du moins dans sa mouvance armée, tient à une mythologie d'autant plus puissante qu'elle est excessivement bête..."
"ACTIVITÉ HONORABLE"
Viré de son journal, paumé, Ferrari se retrouve sans ressources avant de partir au service militaire. C'est alors qu'il se plonge dans les livres, dans la Bible et aussi dans Dostoïevski : "Comme j'étais chômeur, je n'appartenais pas à un contingent d'étudiants. Il y avait là un sergent de 19 ans qui m'a dit : "Je t'ai à l'oeil toi !". Il avait vu mon diplôme de philo et en avait déduit que j'étais anti-militariste... Pour aggraver mon cas, je lisais Dostoïevski dans "La Pléiade" ! Je n'avais pas un rond, pourtant, et je dois rendre hommage à mon père, qui n'a jamais supporté les restrictions à l'égard de la littérature : pour l'achat de livres, j'ai toujours eu un crédit illimité", se souvient l'écrivain.
Aujourd'hui professeur de philosophie, et bientôt conseiller pédagogique à Abou Dhabi, Jérôme Ferrari refuse de se dire philosophe et préfère s'en remettre à la littérature, à une certaine tradition spirituelle aussi. Quand on lui demande ce qui le pousse à mobiliser ainsi un lexique religieux, il avoue qu'il est incapable de s'expliquer là-dessus, que ce vocabulaire lui paraît simplement "le plus adéquat" pour saisir ce qui l'intéresse, et qu'en l'espèce la question de savoir si on croit en Dieu ou non est sans importance. "Ce qui m'a intéressé chez Augustin, par exemple, c'est qu'il a été manichéen. Pour lui, il y a vraiment deux puissances qui s'opposent", dit-il. Le Bien et le Mal, la bêtise et l'esprit... A ceux qui lui reprochent un certain pessimisme, l'écrivain oppose la valeur émancipatrice de la littérature : "Un roman qui a de l'effet sur moi constitue le meilleur antidote à la bêtise. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai immédiatement trouvé que c'était une activité honorable." Ce en quoi Ferrari rejoint encore Bernanos dans son combat contre les forces de la médiocrité : pour l'auteur du Sermon sur la chute de Rome comme pour celui de Sous le soleil de Satan, l'espérance véritable est un désespoir surmonté.
Jean Birnbaum
Keskili ?
Un premier souvenir de lecture ?
Il ne s'agit pas réellement d'un premier souvenir, mais c'était la première fois que je faisais une telle expérience de la beauté : Les Dialogues de Platon que j'ai lus en terminale. Et puis, peu de temps après, Oui, de Thomas Bernhard (Gallimard). J'étais stupéfait de découvrir ce qu'on pouvait faire avec le langage.
Le chef-d'oeuvre inconnu que vous portez aux nues ?
Malacarne, de Giosuè Calaciura (Les Allusifs). Ce livre a changé ma manière d'écrire.
Le chef-d'oeuvre officiel qui vous tombe des mains ?
Belle du Seigneur, d'Albert Cohen (Gallimard). J'ai détesté ce roman quand on me l'a offert, à 20 ans. Puis, quelques années plus tard, je me suis mis à l'adorer, au point de le lire trois fois. Il m'est aujourd'hui impossible de comprendre pourquoi.
L'écrivain que vous aimez lire mais que vous ne voudriez pas rencontrer ?
En voici deux : Léon Bloy et Thomas Bernhard.
Un livre récent que vous avez envie de lire ?
Peste & Choléra, de Patrick Deville (Seuil). J'avais adoré Kampuchéa (Seuil, 2011).
Le livre qui vous a fait rater votre station ?
Le métro n'est plus pour moi qu'un lointain et douloureux souvenir, mais Guerre et Paix m'a valu quelques retards.
Celui qui vous réconcilie avec l'existence ?
Les Démons, de Dostoïevski. Ça peut paraître curieux, mais je l'ai lu pendant mon service militaire, à une époque où la lecture était ma seule joie.
Celui que vous avez envie d'offrir à tout le monde ?
Le Cheval blême, de Boris Savinkov (Phébus). D'ailleurs, je l'offre à tout le monde.
Celui qui vous fait rire ?
Portnoy et son complexe, de Philip Roth (Gallimard). J'ai dû renoncer à le lire devant témoins.
L'auteur que vous aimeriez pouvoir lire dans sa langue ?
Dostoïevski. Je pense que ça restera un rêve.
Le livre que vous voudriez avoir lu avant de mourir ?
A la recherche du temps perdu. Au moins Du côté de chez Swann, pour pouvoir me dire que j'ai lu Proust. J'ai honte. Je ne désespère pas.
Ceci n'est pas un péplum. Mais le récit chaotique et revigorant de la vie des membres d'une famille traversant le xxe siècle comme sur un radeau de survie.
![]()
C'est un roman qui se désagrège à chaque page, et qui pourtant offre un grand sentiment de sécurité. Un livre meuble, fuyant, insaisissable, sur lequel on peut néanmoins prendre appui, pour avancer en confiance. Le titre, déjà, est un faux plancher, un sol qui se dérobe. Détrompez-vous, Jérôme Ferrari n'a pas écrit un péplum, ni une étude sur Tite-Live. Sa brève note d'intention éclaire, puis il éteint la lanterne, pour ne plus revenir dessus, sauf par éclats fugaces. Nul besoin pour lui de s'appesantir sur ce qu'il a énoncé une fois pour toutes, au détour de phrases concises. Le Sermon sur la chute de Rome a donc été prononcé par saint Augustin, en 410, dans la cathédrale disparue d'Hippone, avec le message : « Le monde est comme un homme : il naît, il grandit, il meurt. »
Voilà pour l'explication. Place à l'action. Elle naît, elle grandit, elle meurt, comme les mondes qu'elle traverse. Elle est nerveuse, chaotique, protéiforme. Elle court sur plusieurs générations du xxe siècle, s'évapore dans un coin pour exploser dans l'autre, car les tribus sont à la fois des bombes à retardement et des tremplins. Elle prend naissance sur un portrait de famille en noir et blanc, datant de l'été 1918. Le grain de la photo a absorbé Marcel, comme le trou d'un sablier. L'enfant n'y figure pas. Déjà mort, pas encore né ? Il s'interrogera longtemps sur cette inconcevable inexistence.
Très vite, l'auteur nous happe par son écriture si profonde, proche des émotions, et pourtant pleine de recul. Ce Marcel réapparaîtra, fils blessé, mari fataliste, père absent, grand-père injuste, jonglant avec les patates chaudes que le destin a le chic de maintenir en combustion. Il disparaîtra, éclipsé par d'autres vies venues de la sienne, effacé par des descendants qui auront comme lui à repousser de leurs poings les murs invisibles qui emprisonnent tout individu. Perché en bout de branche de cet arbre généalogique sec et noueux, son petit-fils Mathieu cherchera lui aussi sa place dans le monde, en ouvrant un bar avec un copain, dans un coin perdu de Corse, après ses études de philo. A l'instar de son grand-père, le jeune homme fait surface dans le récit, puis replonge, ressort la tête, et sombre à nouveau. Pour Jérôme Ferrari, la vie est une noyade, et son livre, un magnifique radeau de survie.
Comme dans ses romans précédents, aux titres déjà énigmatiques et forts (Un dieu un animal, Où j'ai laissé mon âme), Jérôme Ferrari saisit cet instant où tout bascule, où la bulle du rêve et de l'ambition éclate pour laisser place au vide abyssal. Mais pour lui, le vide est un espace qu'il y a toujours moyen d'occuper, une terre vierge qu'il faut cultiver pour la faire renaître. Dommage que l'écrivain américain Don DeLillo ait déjà pris le titre d'Outremonde, parce qu'il aurait parfaitement convenu à ce livre bref si fourmillant, à la recherche d'un ailleurs, si intérieur soit-il. D'oeuvre en oeuvre, Jérôme Ferrari bâtit un outremonde sans pareil, intimiste et puissant. — Marine Landrot pour Télérama
Un dieu un animal
Actes Sud (2009)
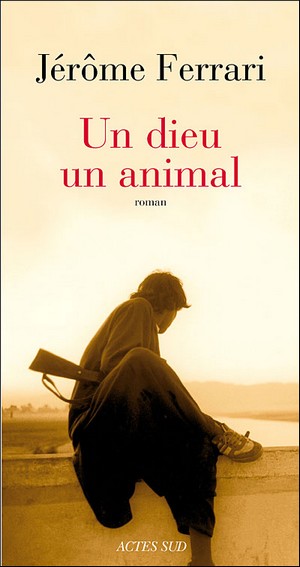
J'ai découvert seulement récemment ce livre magnifique de Jérôme Ferrari qui date de 2009.
Dans ce roman, Jérôme Ferrari met en scène un soldat égaré dans le culte de la défaite et dans son amour d'enfance.
Le héros semble avoir vécu jusqu'à l'adolescence une vie «normale» : un ami d'enfance, Jean-Do, et un premier amour à peine ébauché avec Magali, une jeune touriste passant ses étés au village. Mais il n'arrive pas à devenir adulte. Engagé volontaire, il a sillonné le monde des nouvelles guerres. On le retrouve errant dans son village corse comme dans un cimetière. Le narrateur suit l'errance de cet homme revenu de tout, désespéré par la mort accidentelle de son ami d'enfance. En parallèle on suit son amour d'enfance, Magali, étudiante en psychologie devenue chasseuse de têtes dans le monde sans pitié de l'entreprise néolibérale.
Chacun de leur côté, ils dérivent vers le désespoir, face aux nouvelles divinités que sont la guerre et l'entreprise. Un récit emblématique d'une certaine jeunesse perdue, soumise à la violente emprise de ces multinationales économiques et guerrières, une jeunesse dépersonnalisée, déshumanisée, incapable de trouver en soi le courage de conduire sa vie.
L'intérêt du livre réside dans le parallèle fait par l'auteur entre la folie meurtrière de la guerre et la cruauté du monde de l'entreprise ainsi que dans le regard mystique porté sur cette violence.
Les passages évoquant la vie professionnelle de Magali sont une virulente dénonciation de la dépersonnalisation de l'individu par le monde de l'entreprise, cet «être mystérieux mais tangible appartenant à un ordre supérieur immuable». Une entreprise qui extirpe jusqu'à «la dernière parcelle d'individualité», si bien que ses membres en sont réduits à s'assurer sur Internet «des preuves tangibles de leur existence», ne parvenant qu'à bâtir «un temple vide dédié au culte d'un fantôme».
Ce livre glaçant s'ouvre sur une certitude : « Bien sûr, les choses tournent mal » et se ferme sur sa confirmation.
J'ai reproduit l'entretien donné par Jérôme Ferrari à Mediapart.
Un dieu un animal est votre cinquième livre, le troisième à être publié par une maison d'édition nationale ( Actes Sud) , mais seulement le premier a obtenir une certaine visibilité dans la presse nationale et surtout dans la blogosphère littéraire.
Qu'apporte à l'écrivain que vous êtes cette rencontre avec un public de lecteurs plus large ?
J.F.
L’existence effective d’un roman en dépend. Sans lecteurs, un roman n’est rien. Et il est inévitable qu’un énorme pourcentage de la production littéraire passe totalement inaperçu. Aucun être humain ne peut lire l’ensemble des nouveautés d’une rentrée littéraire. C’est un fait déplaisant qu’il faut accepter. Mais je crois que si on pouvait être certain, absolument certain, de ne jamais rencontrer aucun lecteur, il deviendrait impossible d’écrire. Heureusement, on ne peut pas l’être. J’ai appris cette année que certains libraires avaient été amenés vers Un dieu un animal par leur lecture de Balco Atlantico, qui n’avait pourtant bénéficié d’aucune recension dans la presse. On ne sait pas ce qui rendra une rencontre avec les lecteurs possible.
E.C.
Vous êtes professeur de philosophie mais vous vous défendez d'être un philosophe. Votre dernier livre interroge néanmoins notre monde moderne en tentant de lui donner un sens, ou plutôt du sens.
L'écriture est-elle, pour vous, aussi une manière de pratiquer la philosophie ?
J.F.
Je dis, malgré mon amour de la philosophie, que je ne suis pas philosophe parce que c’est la stricte vérité, dans un sens précis : je suis incapable de créer des concepts. Il ne suffit pas d’avoir des opinions rationnelles sur le monde ou de s’engager pour être philosophe.
Mon mode d’expression est littéraire : je pense avec des histoires et des personnages singuliers. Il me semble qu’on ne peut pas concevoir un bon roman dans lequel les personnages ne seraient que le masque d’un concept ou d’une conviction idéologique, morale, etc.
Par contre, les thèmes qui me touchent sont les mêmes en philosophie et en littérature. J’aime les romans métaphysiques et c’est sans doute pourquoi j’adore Dostoievski et Styron, par exemple. Oui, il y a un fond commun, quelque chose comme la réalité de l’âme humaine et du monde, et plusieurs chemins différents qui y mènent. Le chemin romanesque a, à mes yeux, un avantage sur le chemin philosophique. Il rend mieux compte de la complexité de la réalité parce qu’il n’a pas besoin de s’embarrasser des exigences de la logique.
E.C
Votre héros part à l'étranger, quitte sa famille et son village natal, sans pour autant réussir à devenir un adulte libre. Quelles conditions aurait-il fallu pour que la rupture, l'exil, devienne facteur d'émancipation ?
J.F.
Sans doute aurait-il fallu qu’il soit à la recherche d’un objet réel, que son désir porte sur la réalité. Mais ce n’est jamais le cas chez mon personnage, ni quand il s’engage à l’armée, ni quand il cherche à revoir Magali. Il cherche quelque chose qui n’existe pas. Qu’est-ce qui nous manque, en fait ? Que désire-t-on vraiment ? Peut-être rien du tout. Ce sont des questions qui m’intéressent beaucoup.
E.C.
Cet amour adolescent entre vos deux héros est réinvesti et idéalisé par ces derniers. Pourtant, il fut à peine ébauché et vite oublié. La mémoire est-elle toujours remodelée, réinventée ?
J.F.
Le thème de la mémoire réinventée est central dans Balco Atlantico. Dans Un dieu un animal, ce n’est pas tant la mémoire qui m’intéressait que le souvenir lui-même. Bien sûr, le personnage masculin idéalise le souvenir de Magali, il se persuade qu’il n’a jamais pu l’oublier, ce qui est, en l’occurrence, une illusion. Mais la persistance du passé, sa participation à une forme d’éternité, son autonomie, en quelque sorte, voilà des idées qui ne me paraissent pas illusoires et qui me touchent beaucoup d’un point de vue esthétique.
E.C.
Vos deux héros se fondent dans des groupes et s'y dépouillent d'eux-mêmes au profit d'une entité extérieure, supérieure. Vous poussez loin l'analyse de ce processus de dépersonnalisation et évoquez les liens complexes qui se tissent entre abandon de soi, griserie et volupté.
La «griserie» est-elle l'élément moteur de ce processus ?
J.F.
On ne peut pas vivre sans appartenir à des groupes. Le problème commence, à mon avis, quand le groupe atteint une certaine taille et s’organise autour d’éléments abstraits qui finissent par devenir plus réels que les individus qu’ils fédèrent. Sans griserie, sans volupté, de tels groupes ne pourraient jamais se constituer. La perte de soi a quelque chose de voluptueux.
Mais je ne crois pas qu’elle soit vécue comme telle ; on a plutôt l’impression qu’on est vraiment devenu soi-même, au moment précis où on a perdu jusqu’à la faculté de juger, on a l’impression de vivre des relations humaines solides. Il y a là un mensonge, un mensonge explicite : « chacun de nous est important », « nous nous aimons », « nous sommes frères ». Et tout ça s’accompagne d’une débauche de sentimentalisme d’autant plus dégoulinant qu’il dissimule la violence la plus dure et la plus cynique.
E.C.
Dans votre livre, le rapport de vos personnages à la violence est ambigu. Il y a une sorte de sacralisation de cette violence associant l'amour à la souffrance, une approche difficile à comprendre. Pouvez-vous éclairer ce point ?
J.F.
C’est ce qui caractérise la vision mystique, l’union des contraires, non leur disparition, au sein d’une unité mystérieuse. Hallâj, qui joue un rôle très important dans le roman, explicite constamment cela dans ses magnifiques poèmes. Dans l’un d’eux, il parle d’un hôte qui accueille son invité avec une grande bienveillance et le fait exécuter au matin. J’ai la conviction intime que Hallâj a compris sa propre exécution comme l’expression la plus haute de l’amour de Dieu. L’étreinte d’un être qui nous dépasse infiniment ne peut que nous détruire. Je ne suis pas moi-même mystique mais c’est vraiment quelque chose que je respecte beaucoup. J’y vois une tentative désespérée et magnifique de voir le monde tel qu’il est et de préserver malgré tout la possibilité de l’amour.
E.C.
L'originalité de votre roman qui fait un parallèle entre l'entreprise et la guerre tient justement au regard mystique porté sur leur violence.
Ce regard a-t-il été initié par ces quatre années passées en Algérie, dans une société imprégnée par la religion ?
J.F.
La société algérienne est bien plus religieuse que la nôtre, c’est vrai, mais ça ne veut pas dire qu’elle soit mystique. C’est quand même en Algérie que j’ai découvert le mysticisme. Mon ami Ryad Girod m’y a fait découvrir la poésie de Hallâj, d’Ibn Arabi, une poésie somptueuse qui m’a bouleversé.
C’est aussi en Algérie que j’ai vraiment compris, au travers de beaucoup de témoignages d’élèves et d’amis sur la période du terrorisme, à quel point le monde était violent, plus violent que nous pouvons l’imaginer et je crois que je ne pourrai plus l’oublier, ni écrire comme s’il en était autrement.
E.C.
Outre la beauté des images, votre style séduit par sa fluidité, sa limpidité mystérieuse, sa concision. Il y a une grande adéquation de la forme au contenu, obtenue avec une belle économie de moyens, ce qui donne une impression de facilité. Le «tu» permet ainsi un glissement naturel et, paradoxalement, presque magique d'un personnage à l'autre, d'un lieu à l'autre...
Cette narration à la deuxième personne, déjà amorcée dans une précédente nouvelle, a-t-elle seulement été motivée par le sujet de votre roman ou annonce-t-elle une évolution de votre style ?
J.F.
La narration à la deuxième personne fait partie du projet initial du roman, elle en est indissociable. Elle ouvrait les perspectives stylistiques dont j’avais besoin, un certain ton, solennel et liturgique, la possibilité d’exprimer immédiatement la bienveillance et la cruauté et elle résolvait (cela, je l’ai découvert en écrivant) le problème du passage en continu d’un personnage à l’autre. Je suis absolument incapable d’écrire un roman si je ne dispose pas de quelque chose de radicalement nouveau par rapport au précédent. C’est la mise en œuvre de cette nouveauté qui me permet d’avancer et j’espère ne jamais être condamné à répéter les mêmes recettes. Avant chaque roman, je me demande : pourquoi ce livre devrait-il exister ? J’espère donc que mon style continuera à évoluer, deuxième personne ou pas.
E.C.
Votre récit est exempt de dialogues, votre héros ne s'appelle pas et, d'ailleurs, il n'a pas de nom. L'utilisation du «tu», contrairement à celle du «je» qui donne chair, permet au narrateur de pénétrer totalement le héros et de le dépouiller de ses pensées, de ses sentiments et de ses sensations.
Cette utilisation du «tu» était-elle aussi destinée à souligner l'aliénation de votre héros ?
J.F.
Non, je n’avais pas pensé à cet aspect des choses. Mais bon, si l’intention de l’auteur peut être intéressante, elle me semble inessentielle. L’objectivité d’un roman ne peut se dévoiler que sous le regard des lecteurs et j’ai toujours beaucoup aimé l’idée qu’ils puissent trouver dans mes textes des choses auxquelles je n’avais pas pensé du tout. Plus généralement, je crois que la force d’un roman se mesure au nombre de ses lectures pertinentes possibles. Mais il doit y avoir des contre-exemples. En littérature, il y a toujours des contre-exemples.
E.C. Sens de l'image, «flash-back», mais aussi écriture en plan serré, au plus près des personnages. Sens de l'ellipse et du fondu des enchaînements, qui m'ont évoqué Michel Deville , notamment dans un film assez mystérieux, Peril en la demeure (ex : ce gros plan sur les essuie-glace en marche , fondu , puis gros plan sur le métronome : le héros passe de sa voiture à son séjour où il joue de la guitare ...)
Votre écriture est-elle influencée par le cinéma ?
J.F.
Je dois au cinéma des émotions inoubliables. Apocalypse Now a joué un grand rôle dans la composition de Un dieu un animal. Mais dans l’écriture même, je ne sens pas l’influence du cinéma – ce qui ne signifie d’ailleurs pas qu’elle ne soit pas présente. Il peut y avoir des parallèles, bien sûr, et vous en citez un tout à fait pertinent, mais on ne peut pas transposer telles quelles les idées d’un domaine à l’autre. Par contre, je sais que l’aspect visuel est très important pour moi. Il faut que je voie les scènes que je décris.
E.C.
Vous êtes corse mais avez vécu votre enfance dans la région parisienne et n'avez appris le Corse que sur le tard. Vous traduisez les œuvres d'auteurs s'exprimant en langue corse.
Votre désir est-il de faire émerger une «littérature corse», avec le risque réducteur que comporte ce terme, ou tout simplement que la littérature prenne enfin en compte les écrivains corses ?
J.F.
La question serait plus facile s’il était possible de savoir avec précision ce que signifie littérature « corse ». Il est d’ailleurs tout aussi délicat de savoir de quoi on parle quand on se réfère à la littérature « française ». S’il s’agissait d’une simple question de localisation, il n’y aurait pas de problèmes mais ce n’est bien sûr pas le cas. L’adjectif « corse » a généralement, en Corse comme sur le Continent, des connotations qui me déplaisent et qui, bien que sans rapport avec un projet littéraire, peuvent lui nuire énormément en le faisant disparaître sous des controverses idéologiques sans intérêt. Il m’est arrivé de souhaiter être Albanais ou Bouriate.
D’un autre côté, je ne peux pas faire comme si la Corse n’était pas un élément constitutif de mes romans. Mais je refuse l’alternative qui consisterait soit à ne plus se référer à la Corse, soit à vouloir faire de la littérature régionale. L’idée même de littérature régionale me paraît grotesque. Tout roman naît dans une région particulière, il le faut bien, mais son monde est, en droit, celui de la littérature tout court, sans adjectif. C’est là, et là seulement, qu’il doit être jugé. Je souscris totalement aux analyses de Milan Kundera sur ce point. J’ai traduit la plupart des œuvres de Marco Biancarelli non parce qu’il est Corse mais parce que la brutalité et la puissance de son style me paraissent uniques. Voici donc mon désir : que les romans soient lus pour ce qu’ils sont. Si tel était le cas, je suis certain que la littérature prendrait naturellement en compte certains écrivains corses et j’en serais ravi. Mais je crains de ne pas être exaucé avant longtemps.
Où j'ai laissé mon âme
éditions Actes Sud (2010)
05/11/2010 : Le Prix du Roman France Télévisons a été attribué à Jérôme Ferrari pour son roman « Où j'ai laissé mon âme » (Actes sud).

A travers trois personnages inoubliables, rassemblés dans la douleur par les injonctions de l'Histoire, Jérôme Ferrari, avec une magnifique intransigeance et dans une écriture somptueuse, invite le lecteur à affronter l'intimidante souveraineté de l'épreuve au prix de laquelle se conquiert toute liberté digne de ce nom.
Jérôme Ferrari : "La littérature comme une loupe sur la vérité de l'Homme"
Dans "Où j'ai laissé mon âme", Jérôme Ferrari met ses lecteurs face aux impasses morales de ses personnages, plongés en pleine guerre d'Algérie.
Pierre-Antoine Fournil
Avec son air de ne pas y toucher, Jérôme Ferrari est passé maître dans l'art d'asséner des claques. Son arme ? La plume, qu'il manie méthodiquement dans le brouet des passions troubles agitant ses contemporains. Surtout, ne pas se fier à son air vaguement absent lorsqu'on le croise à Ajaccio sur le cours Napoléon ou à la sortie du lycée Fesch, devisant paisiblement avec quelques-uns des élèves auxquels il enseigne la philosophie.
Au fil de ses romans, cet auteur de 42 ans dessine les contours d'une oeuvre fascinante qui a retenu l'attention de l'éditeur Actes Sud. Et celle des jurys. Le prix France Télévisions vient de lui être décerné pour Où j'ai laissé mon âme. La veille, celui de la Société des gens de lettres lui avait été attribué. Et il est encore en lice pour le prix du style (résultat lundi), pour le prix Wepler (22 novembre) et le prix des libraires (en mars prochain). Rencontre avec un écrivain qui a su donner à sa prose insulaire un relief qui touche à l'universel.
Ce prix France Télévisions, vous vous y attendiez ?
C'est un prix de lecteurs. Autrement dit, rien n'est jamais sûr. Je figurais parmi six finalistes, dont Eric Faye qui venait de recevoir le prix de l'Académie française... Ça a été une surprise complète. Annoncée en direct devant les caméras (sourire gêné).
Il s'agit de votre 3e prix littéraire (Jérôme Ferrari a reçu le prix Landerneau pour Un Dieu un animal en 2009, ndlr). Comment appréhendez-vous toutes ces distinctions ?
C'est bizarre. Il y a bien sûr la notion de reconnaissance du travail accompli. Je suis fier de ce qui m'arrive, c'est évident. On dit souvent qu'il faut être détaché vis-à-vis des prix. Je ne le suis peut-être pas assez... L'intérêt de ces récompenses, c'est aussi de prolonger la vie d'un livre, qui n'est désormais plus très longue.
Le choix de la guerre d'Algérie comme cadre de votre dernier roman résulte-t-il de votre expérience d'enseignant, durant quatre ans, au lycée international d'Alger ?
Je ne l'aurais sans doute pas fait si je n'avais pas été là-bas. Mais, ce sont surtout les témoignages du documentaire de Patrick Rotman, L'ennemi intime, qui ont joué le rôle de déclencheur. A travers les propos d'un ancien officier français ayant participé à l'arrestation du chef de l'ALN Larbi Ben M'hidi, on est immergé dans la relation complexe qui peut se nouer entre deux adversaires.
La guerre d'Algérie suscite toujours les passions. Vous n'avez pas craint de vous y frotter ?
La fiction s'en est emparée depuis peu. Cela remonte en fait à la précédente rentrée littéraire, avec Des Hommes, le magnifique roman de Laurent Mauvignier. Ma crainte était effectivement que Où j'ai laissé mon âme soit accueilli sur un mode uniquement politico-idéologique. Ça n'a pas été le cas. Le temps commence à faire son ouvrage.
Et le fait de « refiler » le rôle du partisan de la méthode dure à un Corse, le lieutenant Andreani, cela vous est venu naturellement ?
En quelque sorte. Pour rentrer dans une histoire qui m'est étrangère, celle de la guerre d'Algérie, il fallait que j'utilise quelques éléments qui me sont familiers. De plus, ce personnage s'exprime à la première personne du singulier. Ses origines corses m'ont aidé à le saisir plus profondément. Même s'il ne s'agit pas de la personne la plus recommandable qui soit...
Votre précédent roman, Un Dieu un animal, évoquait déjà la guerre. C'est devenu votre thème favori ?
La guerre fait office de décor, mais elle n'est pas le thème de ces romans. Un Dieu un animal traite du mysticisme et il est question d'impasse morale dans Où j'ai laissé mon âme. Peut-être ai-je un goût pour la guerre... Ou en tout cas pour les situations extrêmes qui nous permettent d'en apprendre davantage sur les hommes. L'Homme est au centre de tout. Est-ce un hasard si le plus grand livre sur la guerre et les camps s'intitule Si c'est un homme ? Ainsi, qu'on le veuille ou non, la pratique de la torture révèle l'un des visages de l'humanité.
Et le divin ? C'est une notion qui, d'un livre à l'autre, semble aussi vous préoccuper...
Oui, beaucoup. Pourquoi ? Je ne saurais le dire. Le capitaine de mon roman est confronté à des problèmes moraux d'autant plus vifs qu'il est chrétien. Par ailleurs, le récit s'articule autour de trois jours en référence aux trois jours de la Passion. Mon officier et son prisonnier algérien sont plongés dans un face-à-face qui évoque celui de Pilate et du Christ. Pas celui des Évangiles, mais celui de Mikhaïl Boulgakov, dans Le Maître et la Marguerite, que je cite en exergue. Notamment cette phrase : « Il dit que même en présence de la lune il ne connaît pas de repos, et qu'il fait un vilain métier. »
Vos élèves de terminale du lycée Fesch vous lisent-ils ?
Aucune idée. Nous n'en parlons pas. J'essaye de séparer les choses. Au Fesch, je suis leur professeur de philo. Le sujet, c'est eux et non pas moi.
Davantage enseignant ou écrivain désormais ?
Les deux. Même si, cette année, avec la parution de Où j'ai laissé mon âme, mon activité d'écrivain a pris une place plus importante. Depuis septembre, la promotion de ce roman m'oblige à monter à Paris environ une fois par semaine.
Un nouveau projet littéraire en préparation ?
Aucun en ce moment. Mon travail d'enseignant, le roman et ma vie de famille me prennent 128 % de mon temps. J'y reviendrai quand ça se calmera. Ce qui ne devrait pas tarder.
Comme un divertissement en somme ?
Je n'ai jamais envisagé la littérature comme un divertissement, même en tant que lecteur. Elle est une loupe sur la vérité du monde et de l'Homme, comme l'art en général.
Propos recueillis par Sébastien Pisani, Corse Matin, 13 novembre 2010
Balco Atlantico
Sur la place d’un village de Corse, Stéphane Campana, ardent nationaliste, connu de tous, vient de s’effondrer, fauché par deux balles tirées à bout portant. Sur son corps inanimé est venue se jeter Virginie, la jeune fille qui n’a cessé de vivre dans la vénération de cet homme que, tout enfant déjà, elle s’était choisi pour héros au point de s’abandonner, corps et âme, à ses plus étranges désirs.
De l’engagement politique de celui qui baigne à présent dans son sang, le roman reconstitue alors la genèse erratique jusqu’au point, périlleux, où la trajectoire insulaire rencontre celle de deux jeunes Marocains – Khaled et sa soeur Hayet – échoués en Corse à la recherche d’un improbable monde meilleur, celui que, sur la corniche de leur ville natale, près de Tanger, faisait miroiter à leurs yeux l’inoubliable et merveilleuse promenade connue sous le nom de “Balco Atlantico”…
D’une rive à l’autre, de mémoires qui ne passent ni ne se partagent, entre les âpres routes de l’exil et l’esprit d’un lieu singulier, Jérôme Ferrari jette le pont d’un roman solaire, érigé dans une langue ouverte sur toutes les mers où, de naufrages en éblouissements, passé et avenir naviguent de concert dans le rêve des hommes.
Dans le secret
Actes Sud/Babel, 2007

Quelques paroles chuchotées au creux de l'oreille d'Antoine, qu'il n'est même pas sûr d'avoir bien comprises, font naître le doute dans son esprit. Sa femme Lucille aurait-elle un amant ? Troublé, Antoine perd ses repères, et plonge dans un monde où ses maigres certitudes sont réduites à néant.
Propriétaire avec Batti d'un bar en Corse, Antoine s'étourdit entre alcool, drogue et sexe..Il se coupe du monde et de ses amis Batti et José. Mais parallèlement il retrouve son frère Paul, avec qui il avait coupé les ponts. Le bon élève de la famille parti à Paris était revenu en Corse vivre au village, seul.
L'ouvrage ne se limite pas à cette chronique d'une famille en déliquescence et d'un homme en proie au doute. Jérôme Ferrari ancre son roman dans une histoire plus large, celle d'un territoire marqué par la violence, par l'exil, le départ et l'échec.
Aleph zéro
Albiana, 2002

Le premier roman de Jérôme Ferrari, paru en 2002 chez Albiana, met en scène un jeune professeur perdu dans ses contradictions. Victime consentante d’une société déréglée, pour ne pas dire dérangée, où l’individu se doit de vivre à cent à l’heure, écartelé entre les réseaux sociaux et l’information en continue, oubliant de prendre le temps de vivre et de construire sa vie. Lovecraft l’avait d’ailleurs signalé, affirmant que l’homme sensé devrait souhaiter être un imbécile ou un chien. À défaut d’être un Aleph Zéro, puisque seul cet être mathématique parvient à demeurer intact quels que soient les éléments qu’on lui soustraie…
Le narrateur collectionne les conquêtes sans même se souvenir de ses nuits d’amour puisqu’il n’en est, finalement, jamais question. De sexe, peut-être, quoiqu’il semble que cela ne soit qu’une partie de gymnastique : point d’érotisme, ni de sensualité ni de plaisir… Le coït par conformisme ?
Pour oublier ce cul de sac, il va se balader en forêt mais ses visions le pourchassent. Il se laisserait bien tenter par le suicide, marchant alors sur les pas de sa collègue qui s’est jetée par la fenêtre après son ablation du sein. Mais il se souvient que Schopenhauer fut clairvoyant en certifiant que la vie ne cesse pas. "Le seul problème éthique auquel nous soyons confrontés, la seule question qui fasse sens est donc celle-ci : comment s’arracher à la vie, comment faire pour qu’elle cesse ?"
Partir alors ? Fuir tout ce cirque (...) ? Il y a bien Anna qui semble être la seule à le comprendre, à l’écouter narrer ses plongées dans les abysses de son esprit sans parvenir concrètement à comprendre de quoi il en retourne. Doit-il se livrer aux seuls caprices du hasard qui décidera alors de son destin ? "Mais peut-être Leibniz ne défend-il rien, et surtout pas l’ordre. Peut-être veut-il seulement montrer que la magnificence de Dieu, le Maître du kaïros, le Seigneur des Mondes, Lui permet toujours de suivre, au cœur inconcevable du chaos, la trace légère de la beauté." Anna serait alors l’élue ? Mais qui décide, qui choisit ?
Étonnante langue, déjà admirablement maîtrisée à la quasi perfection pour nous peindre les dérives psychiques qu’un être humain trop sensible peut ressentir à l’approche du grand amour. Sans même savoir qu’il flirte avec l’infini. Tout comme le lecteur qui se laisse emporter par le tourbillon d’une prose étincelante qui conduira Ferrari vers la reconnaissance d’un public de lecteurs que l’on espère toujours plus nombreux.
François Xavier, Salon Litt�raire






